L'humanisme, une nouvelle vision du monde
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
- Connaitre les origines de la philosophie humaniste.
- Comprendre comment la philosophie humaniste s'est diffusée.
- La philosophie humaniste souscrit largement à l'adage d'Érasme, selon lequel « on ne naît pas homme, on le devient. ».
- La philosophie humaniste place toute sa confiance dans l'homme.
- Elle préconise de nouvelles méthodes d'éducation, insiste sur la nécessité d'une réflexion personnelle et encourage les recherches dans des domaines aussi variés que l'astronomie ou la théologie.
Si l'activité intellectuelle ne s'est pas arrêtée au Moyen Âge, le milieu du XVe siècle marque toutefois une rupture dans l'histoire culturelle de l'Europe.
L'année 1453 voit la fin du conflit franco-anglais qui a contrarié et appauvri les relations entre intellectuels.
La même année, le flux de réfugiés de l'Empire byzantin fuyant l'avance des Turcs devient de plus en plus important en Italie. Ces réfugiés apportent avec eux les textes des philosophes antiques, oubliés depuis des siècles en Occident.
Les conditions politiques nécessaires au renouveau des idées intellectuelles semblent assurées. Elles s'ajoutent à des conditions techniques favorables : en 1453, Gutenberg publie sa première Bible.
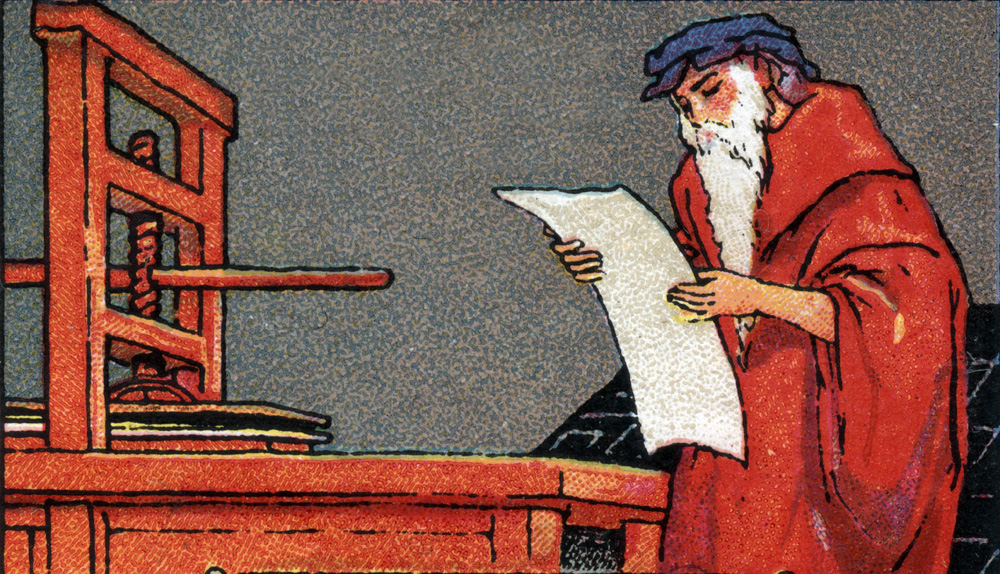 Gutenberg utilisant sa presse
pour l'impression de sa Bible.
Gutenberg utilisant sa presse
pour l'impression de sa Bible.
La multiplication des ateliers typographiques va
de pair avec celle des ouvrages imprimés. Les
écrivains antiques et contemporains
acquièrent alors une audience plus large qui
dépasse le lectorat traditionnel des clercs.
Sensibles à ces innovations, certains princes
(François Ier, Henri VIII), de
riches bourgeois commerçants (Laurent de
Médicis) ou encore de puissants
ecclésiastiques (le pape Jules II)
s'entourent de philosophes et d'artistes qu'ils aident
par une politique de mécénat
très active.
Ainsi la communauté humaniste est hétéroclite. Unie par une même révérence pour les auteurs antiques et une curiosité pour tous les domaines de la science, elle utilise le latin pour échanger à travers toute l'Europe.
Certains savants humanistes orientent leurs recherches vers les sciences de la nature.
La médecine progresse alors grâce à une meilleure compréhension du corps humain, rendue possible par la multiplication des dissections. André Vésale est ainsi le premier à se livrer à une dissection publique, en 1543.
D'autres s'intéressent à l'organisation de l'univers : c'est le cas de Copernic qui soutient l'héliocentrisme. Il est soutenu par l'Italien Giordano Bruno, qui envisage par ailleurs un univers infini. S'opposant ainsi aux théories admises par l’Église, Giordano Bruno est condamné au bûcher.
 Carte du ciel
représentant le système de Nicolas
Copernic, avec le Soleil au centre du système
solaire.
Carte du ciel
représentant le système de Nicolas
Copernic, avec le Soleil au centre du système
solaire.
L'éducation est à la base de la philosophie humaniste de Français Rabelais ou Montaigne : ces savants considèrent que toutes les facultés humaines méritent d'être valorisées.
Aussi préconisent-ils un dosage
équilibré entre l'acquisition de
connaissances, le travail de réflexion et
l'exercice physique. Ainsi devient-on
« honnête homme »,
l'idéal humaniste.
Cette valorisation de la réflexion personnelle
remet en cause la mainmise traditionnelle de
l’Église sur les champs du savoir et n'est
pas sans rapport avec les tentatives de
réformes religieuses qui se
succèdent alors (protestantisme).
Certains théoriciens comme
Nicolas Machiavel ou Thomas
More utilisent leur connaissance intime des cours
européennes pour élaborer des ouvrages
politiques :
- Machiavel cherche à conseiller au mieux les princes sur la manière de conserver le pouvoir, dans son œuvre Le Prince (1532) ;
- Thomas More imagine un État utopique ou communauté des biens et tolérance religieuse seraient un gage de paix perpétuelle, dans L'Utopie (1516).
 Thomas More
Thomas More

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !










