Renaissance et humanisme en Europe
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
À cette époque apparaît également le courant humaniste : une pensée qui donne une place centrale à l’être humain. Il se caractérise par un retour aux arts de l’Antiquité grecque et romaine, par la modification des modèles de vie, d’écriture et de pensée.
En France, l’administration est réorganisée et centralisée grâce à l’unification des codes de lois locaux, jusque-là rédigés en latin, en un seul code rédigé en français, reconnu par tout le royaume : l’édit de Villers-Cotterêts. La langue française s’impose. Ce nouveau sentiment pèse dans les querelles religieuses : le pouvoir de l’Église, prédominant au Moyen âge, est contesté par des pouvoirs politiques forts. Et pendant une partie du 16e siècle, l’Europe, et la France en particulier, est déchirée par des guerres continuelles, notamment des guerres de religions.
Les transformations dans les domaines scientifiques et techniques sont considérables et annoncent un nouveau type d’organisation économique. Des avancées capitales sont faites en chirurgie, cartographie, astronomie, en 1543, Copernic affirme que la Terre tourne autour du soleil.

|
| Doc. 1. Carte du ciel représentant le système de Nicolas Copernic avec le Soleil au centre du système solaire |
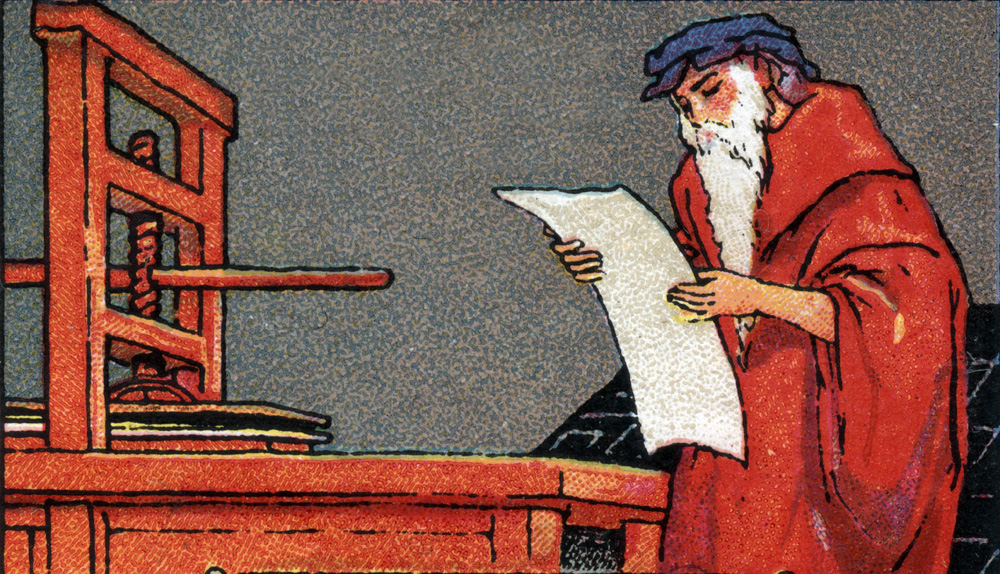
|
| Doc. 2. Gutenberg, imprimeur allemand et inventeur de l'imprimerie, utilisant sa presse pour l'impression |
• Connu pour sa prodigieuse mémoire et son érudition exceptionnelle, Pic de la Mirandole fut l'un des plus typiques représentants de l'humanisme italien. Il apprit notamment l'hébreu, l'araméen et l'arabe. Il affirmait que l'Homme a été placé par Dieu au centre de l'Univers avec le devoir d'étudier le monde pour comprendre les lois qui le régissent.
• Thomas More est l'une des personnalités les plus remarquables de son temps. Chancelier du roi d'Angleterre Henri VIII. Son nom est lié à son ouvrage en latin, l'Utopie (1516). S'inspirant de Platon, il y décrit une société idéale, installée sur une île imaginaire, organisée selon les règles de cohabitation pacifique et de tolérance entre hommes de croyance diverses.
• Guillaume Budé, ami d’Érasme, de Rabelais de More est un helléniste, théologien. Il fonde le Collège de France à la demande de François Ier. (1530)
• François Rabelais, écrivain français : ses romans Pantagruel puis Gargantua allient truculence et érudition, il développe un humanisme optimiste qui croit en l’homme et en son libre-arbitre sans cesser de croire en Dieu.

|
| Doc. 3. Portrait de Francois Rabelais (1494-1553), écrivain et médecin francais |
• Michel de Montaigne, écrivain français, philosophe, auteur des Essais. Il formule les principes humanistes : justice, liberté, droit au bonheur, mais exprime son scepticisme car il ne comprend pas les querelles entre protestants et catholiques.
La réflexion pédagogique tient une place importante. Il faut faire progresser l’élève à son rythme par le dialogue avec le maître, en respectant l’équilibre entre les disciplines intellectuelles, physiques, morales et sociales.
La confiance en l’être humain est primordiale, elle va de pair avec les idées de cosmopolitisme et de pacifisme.
Les voyages et échanges sont encouragés. Les humanistes sont réformateurs et non révolutionnaires.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









