Les communautés paysannes au Moyen Âge
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
C’est une société tripartite : trois groupes ou ordres se distinguent, le Clergé, la Noblesse et le troisième état de la société qui constitue le bas de la pyramide : les paysans.
• Les paysans forment ce troisième état avec tous ceux qui travaillent de leurs mains. Ils mettent en valeur les terres et doivent produire pour nourrir la société.
La paysannerie est dominée par les deux autres ordres : les seigneurs et le Clergé.
• Les paysans sont tout d’abord dominés par les seigneurs ou nobles qui sont le plus souvent propriétaires de leurs terres et à qui ils sont redevables. Ils leur doivent des redevances et exercent donc un pouvoir économique et financier.
Parmi celles-ci on trouve : la taille, impôt en argent fixé par la coutume et très variable d’une région à une autre, ainsi que le cens, une redevance fixe due au seigneur par le paysan pour les terres qu’il tient de lui. Les redevances peuvent être payées en nature comme le champart qui est l’obligation de verser au seigneur une partie de la récolte.
Le paysan doit enfin un temps de travail au seigneur pour entretenir ses terres ou ses biens, c’est la corvée.
Ces communautés sont aussi dépendantes des seigneurs sur le plan juridique. La justice seigneuriale s’impose à elles car en cette période l’autorité royale décline (voir fiche La féodalité), c’est ce que l’on nomme le ban, le pouvoir de faire des règlements et de rendre justice. Par le ban, le seigneur s’attribue également le monopole d’installations telles que le four, la forge, les pressoirs, les moulins… que les paysans utilisent contre des redevances.
• Enfin, les paysans sont dominés par le Clergé à qui ils doivent aussi des redevances en nature ou en argent et portant sur les revenus agricoles : c’est la dîme. La dîme sert à entretenir le Clergé pour rétribuer ses membres, entretenir les lieux du culte et pour permettre de fournir assistance aux plus pauvres.
Le statut de servage implique des obligations : une partie des récoltes est donc due au seigneur tout comme le paiement des taxes. Le serf doit participer aux corvées, labours, récoltes sur les terres du maître, réparations d’un pont, creusement d’un puits ou travaux sur le château seigneurial… Mais les serfs ne sont pas des esclaves pour autant, ils peuvent s’affranchir des corvées contre argent versé.
Au 13e siècle, on passe ainsi du servage au fermage, c'est-à-dire que la terre devient louée par le paysan au propriétaire et il l’exploite à son compte. Par ailleurs, les serfs ont aussi des droits. Ils peuvent quitter le domaine à tout moment, ils ont un droit d’usage sur les terres du seigneur : droit de faire paître leurs bêtes sur les champs non cultivés, d’utiliser les bois ou encore les landes du domaine.
Le travail est pénible et laborieux. Longtemps les attelages de chevaux et de bœufs restent un luxe réservé aux plus riches des paysans. Dans beaucoup de régions, notamment dans le centre ou dans l’est de la France, les serfs s’attèlent eux-mêmes à la herse ou à la charrue. Ce travail reste aussi soumis à de nombreuses contraintes comme les prélèvements et droits seigneuriaux ou les aléas climatiques. Les récoltes ne sont jamais garanties.
La population paysanne est une population fragile soumise aux disettes fréquentes et aux épidémies. Cependant, on assiste sur cette période à une amélioration du travail effectué et à une augmentation des quantités produites. Cette amélioration permise par une évolution des techniques offre un meilleur niveau de vie et une production suffisante pour nourrir la population des villes qui augmente.
L’utilisation du métal se généralise pour les socs des charrues autorisant un labour plus profond, pour les herses ou encore l’outillage à main (houe, faucille…). La productivité est plus importante grâce aux conseils des agronomes qui rendent le travail plus efficace. On passe aussi d’un système de rotation biennal à un assolement triennal.
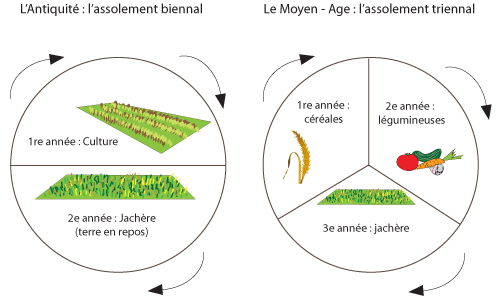
Pour éviter l’épuisement trop rapide des terres, les agriculteurs de l’Antiquité avaient institué le système de rotation biennal : un champ semé en céréales est laissé au repos -jachère- l’année suivante. Il est labouré mais non semé et sert de pâturage.
Au Moyen âge, la rotation devient triennale : seul un champ sur trois reste au repos et l’introduction de la culture des légumes permet d’enrichir la terre. La production agricole augmente donc fortement au 13e siècle. Les surfaces cultivées gagnent sur les espaces boisés : commencés dès le 10e siècle les grands défrichements s’accélèrent au 12e siècle.
La vie s’organise autour de lieux centraux : le château, l’Église et la place centrale. Le rythme de vie est guidé par l’impératif des travaux agricoles et par les messes, les moments de communion annoncés par le son des cloches.
Il existe cependant des moments particuliers où les rencontres sont possibles, où le village s’ouvre sur l’extérieur. Ainsi, les foires et les marchés redonnent du dynamisme à la vie sociale. On vient y vendre ses surplus agricoles, du bétail et on trouve l’occasion d’élargir son cercle de relations.
Il existe également des loisirs avec des spectacles itinérants : saltimbanques, jongleurs, conteurs, lanceurs de couteaux… viennent égayer des communautés dont les possibilités de divertissements sont rares au quotidien. Les fêtes religieuses se multiplient et offrent aussi des moments où toute la communauté se retrouve.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









