Etude de cas : le développement d'un territoire ultramarin, la Guyane
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
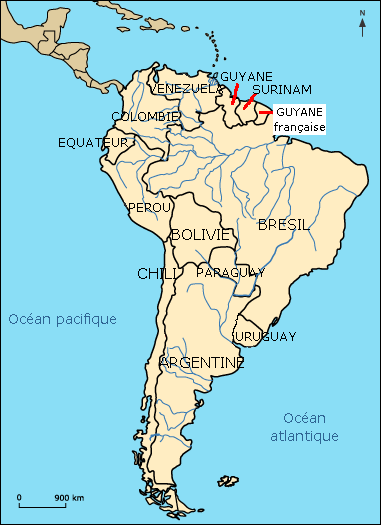
|
| Doc. 1. Localisation de la Guyane Française |
Outre la distance avec sa métropole, la Guyane se caractérise également par un enclavement du territoire qui permet de la comparer à une île au sein d'un continent. L'organisation spatiale fait apparaître des contrastes forts entre la Guyane littorale, interface maritime avec l'UE et les territoires voisins, et la « Guyane verte », domaine de la forêt équatoriale. La bande littorale, qui ne couvre que 6% du territoire, concentre la majeure partie de la vie et des activités guyanaises. On y trouve l'essentiel des réseaux routiers et urbains. Les villes principales, Cayenne, capitale régionale et Kourou, centre historique, ainsi que les villes secondaires de St Laurent du Maroni, Mana, Matoury, Macouria et Sinnamary se localisent sur cet espace. Cayenne concentre également les principales infrastructures de communication assurant l'ouverture du territoire sur l'extérieur : il s'agit de la principale place portuaire et on y trouve également l'aéroport international.
Par opposition, l'intérieur du territoire est le domaine de la forêt équatoriale dense : elle couvre plus de 90% de l'espace. Le parc national amazonien occupe toute la moitié sud de l'espace guyanais. On y rencontre peu de villes hormis St Georges, sur l'Oyapock, qui marque la frontière avec le Brésil et qui offre une porte d'entrée sur ce pays ainsi que Maripasoula sur la frontière avec le Surinam à l'ouest. Outre l'organisation spatiale et la dualité du territoire, les similitudes avec les espaces insulaires se retrouvent par certaines spécificités socio-économiques.
Elle cache logiquement des contrastes forts : puisque 87% de la population est urbanisée, les densités sont plus fortes sur la bande littorale (40 habitants par km2 en moyenne), que dans l'intérieur forestier qui n'abrite que 10% de la population. Cet espace est un quasi désert humain où se trouvent principalement les Bushi-Nenghe ou « Bush negroes » c'est-à-dire les « nègres des bois » qui désignent les descendants d'anciens esclaves surinamiens ayant fui vers la forêt et vivant sur les rives du fleuve Maroni, ainsi que les Amérindiens et Brésiliens.
Cette population guyanaise est également une population jeune, les moins de 15 ans représentent 35% de la population totale. Elle connaît une forte vitalité démographique et bénéficie de l'apport de flux migratoires externes. Aussi, le taux de croissance annuel de la population est sensible avec 3,4% (contre 0,3% pour le voisin du Suriname). Cependant, certains indicateurs révèlent les difficultés de développement : on note ainsi un fort taux de mortalité infantile, de 29‰ alors qu'il n'est que de 3,5‰ en France.
C'est dans cette ville que se situe en particulier le pôle du Centre Spatial Guyanais (CSG) dépendant de l'Agence Spatiale européenne. Cette plateforme, créée en 1964, constitue une vitrine technologique pour la Guyane et la France. Elle confère au territoire un statut stratégique puisque c'est à partir de Kourou que décollent les lanceurs de satellites Ariane. L'activité économique du territoire est très dépendante de ce centre. Celui-ci représente 16% du PIB et 23% de l'emploi salarié de la Guyane. Il masque d'importantes difficultés structurelles, que l'on retrouve dans d'autres territoires ultramarins comme la faiblesse du secteur privé et le poids important de la fonction publique.
Le taux de chômage important, qui représente 21% de la population active, est un révélateur de ces difficultés. Le développement économique lié à l'intérieur du territoire est très réduit. On y retrouve quelques zones aurifères avec des sites d’orpaillage, c’est-à-dire de recherche et d’exploitation artisanale de l’or, quelques mines de bauxite à l’est, à proximité du fleuve Approuague ou de l’exploitation forestière, mais ces activités sont peu productives de richesses.
L’espoir réside en un développement de l’activité touristique qui, jusqu’à présen,t était peu marquée. Avec un peu moins de 130 000 touristes en 2009 la Guyane est avec les Açores le territoire des RUP qui a accueilli le moins de personnes. Le passé douloureux du territoire, la réputation d’enfer vert liée à l’ancien bagne de Cayenne n’y sont pas étrangers. Mais se développe depuis peu un écotourisme qui permet la promotion de la région tout en protégeant la nature et veillant au bien-être des populations. Il se développe grâce à la forêt qui permet l’essor d’un nouveau tourisme basé sur la découverte et l’aventure.
Si les frontières sont de plus en plus perméables aux flux humains, les flux économiques avec les territoires voisins sont plus distendus. La Guyane exporte par exemple trois fois moins en valeur vers la Martinique que la Guadeloupe. Des partenariats initiés par l’UE sont cependant créés pour mieux insérer le territoire dans son bassin régional. Le Programme Opérationnel Amazonie est ainsi un programme de coopération avec le Surinam et le Brésil. Il cherche à développer des projets liés au développement durable (exploitation de la forêt, tourisme…).
Le programme transfrontalier « INTERREGIV Caraïbes 2007-2013 » concerne lui l’ensemble des États d’Amérique centrale et des Caraïbes. La Guyane y participe mais ce programme dispose de peu de crédits. Il est vrai que les liens demeurent avant tout basés sur les échanges avec la métropole et dépendent des aides européennes.
Les liens étroits se manifestent également par les aides financières octroyées par l’UE qui sont liées au statut de RUP du territoire. Il bénéficie donc des financements et programmes spécifiques par l’intermédiaire du FEDER ou FSE (Cf. fiche Discontinuités, distances, insularité, spécificités socio-économiques). Le statut de RUP permet aussi d’adapter certains textes législatifs pour aider économiquement la Guyane : la TVA n’y est pas applicable et l’impôt sur le revenu est réduit de 30%.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









