Mécanismes de transfert thermique- Première- SVT
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Comprendre comment l’énergie interne est dissipée à la surface de la Terre.
- Les roches sont des matériaux présentant une faible conductivité thermique. Ainsi, lors de son échauffement dans le manteau, la roche va devenir ductile (malléable). La matière chaude va remonter à la surface où elle va se refroidir pour ensuite redescendre. Elle est donc animée d’un mouvement de convection.
- La remontée de matière se fait à l’aplomb des dorsales tandis que la descente de matière se fait au niveau des zones de subduction.
- Une fois à la surface, la chaleur se dissipe par conduction.
- Le flux géothermique rend compte de cette dissipation hétérogène : elle est maximale au niveau des dorsales et des points chauds. Elle est élevée au niveau des zones où la croûte continentale est la plus mince (bassin sédimentaire, fossés d’effondrement).
Il existe deux modes de transfert d’énergie thermique : la convection et la conduction.
À l’échelle du globe, la
lithosphère est le siège de
phénomènes de conduction rendant compte
du flux géothermique observé. La limite
noyau-manteau libère aussi de
l’énergie par conduction en direction du
manteau.
Le géotherme dépend du mode de transfert
thermique. Dans le cas de la conduction, la
température augmente proportionnellement avec la
profondeur. Mais le géotherme dépend
aussi des propriétés conductrices et de
la composition des roches. Les variations de
géotherme observables à la surface de la
planète sont donc directement liées aux
différences de conductivité des
roches.
La péridotite, roche constituant le manteau,
présente une conductivité plus
élevée (4,2 à 5,8
W.m-1.K-1) que le granite (2,5
à 3,8 W.m-1.K-1) et les
roches de la croûte océanique, comme le
gabbro et le basalte (1,7 à 2,5
W.m-1.K-1) ou les roches
sédimentaires comme le calcaire (1,7 à
3,3 W.m-1.K-1).
Toutefois, les roches terrestres présentent des
conductivités thermiques plutôt faibles
(conductivité thermique de l’argent : 420
W.m-1.K-1, de l’eau : 6
W.m-1.K-1) qui limitent les
transferts d’énergie et favorisent le
stockage de la chaleur.
Comparé à une roche sédimentaire
aura des propriétés bien plus isolantes
qu'une roche magmatique comme la péridotite.
Le mouvement de convection est un phénomène
facilement observable lorsqu'on chauffe de l'eau.
Si on chauffe un récipient rempli d’eau par
sa base et qu'on suit l’évolution de la
température de l’eau en bas et en haut du
récipient, on constate que la température
augmente de la même façon aux deux niveaux.
Il y a donc un transfert de chaleur de la base vers la
surface du volume d’eau.
Dans ce cas, l’eau chauffée à la base
remonte à la surface où elle se refroidit
en libérant la chaleur. Une fois refroidie, elle
redescend à la base ; elle décrit ainsi
un mouvement de convection.
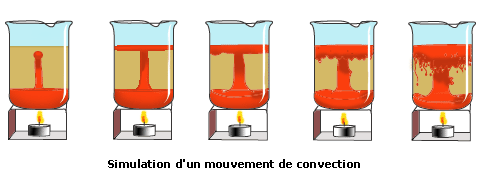
Ce mouvement tend à homogénéiser les températures.
C'est la couche inférieure du manteau qui
va être animée de mouvements de convection
permettant la remontée à la surface de
l’énergie interne. Cette dynamique permet le
mouvement des plaques lithosphériques.
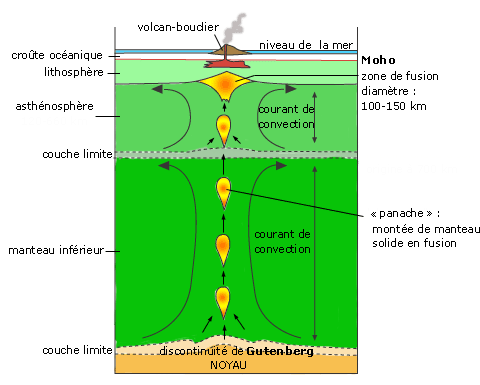
Les dorsales océaniques sont le siège de
la remontée de l’énergie interne
par convection alors que les zones de subduction sont
le siège de la descente de la matière
refroidie. Ces mouvements sont visibles grâce
à la tomographie sismique qui permet de
distinguer les zones chaudes des zones froides à
l’intérieur du globe.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









