Les Caractères : lecture méthodique 3
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
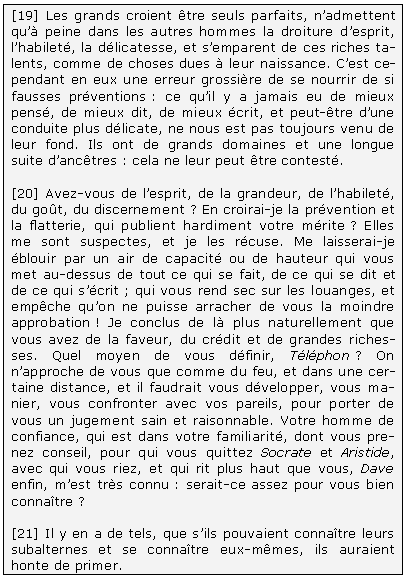
Les Caractères de La Bruyère s'inscrivent
dans cette tendance et connaissent d'ailleurs un succès
immédiat auprès d'un public mondain pourtant bien
malmené à travers les chapitres de cet ouvrage
hétéroclite, mêlant des maximes très
courtes et incisives et des portraits plus ou moins longs. Le
tour de force est d'avoir mêlé ces formes tout en
leur donnant une unité.
Les paragraphes 19 à 21 offrent finalement un
échantillon éloquent de l'art de La Bruyère.
La discontinuité s'y affiche dans la fragmentation du
discours, et pourtant, une véritable unité
régit ces paragraphes qui semblent s'articuler autour du
court portrait de Téléphon. La Bruyère y
illustre son principe « d'écrire ce qu'il
pense » tout en pratiquant « l'art de lier
des pensées et de faire des transitions »
(Préface au Discours à l'Académie).
La forme contribue très clairement à cerner peu à peu le sujet observé ici : les apparences éclatent littéralement et l'âme humaine apparaît par touches plus ou moins prononcées (de la notion abstraite à l'étude du spécimen).
Pris indépendamment des autres, le paragraphe se suffit à lui-même et fait sens ; mais dans cet extrait, le paragraphe est étroitement connecté à l'environnement par divers artifices (thématiques, stylistiques). C'est tout le paradoxe des Caractères.
On peut définir les paragraphes de notre extrait ainsi :
- Le § 19 est à mi-chemin entre la maxime et le caractère : le discours est généralisant comme la maxime et juxtapose finalement plusieurs paroles à portée générale (« Les grands croient être seuls parfaits... », « C'est cependant en eux une erreur grossière de se nourrir de si fausses préventions : ce qu'il y a jamais eu de mieux pensé... ») ; mais à la manière du caractère, on se détache peu à peu de la notion abstraite en cernant davantage la cible par le rappel de la 3e personne (« les grands », « eux », « leur », « ils ») et l'ajout d'informations (« la droiture d'esprit, l'habileté, la délicatesse, et s'emparent de ces riches talents, comme de choses dues à leur naissance »).
- Le § 20 relève clairement du caractère, forme plus longue et dans une certaine mesure descriptive ; généralement, le sujet est doté d'un nom (Téléphon) qui donne vie à la notion critiquée.
- Le § 21 relève de la sentence, définie comme « une parole universelle qui, même hors du sujet auquel elle est liée, peut être citée » (citation traduite de Quintilien citée par Alain Compagnon dans La Seconde main ou le travail de la citation, Seuil, 1979).
Jonction et disjonction entre les paragraphes
Du 1er au 3e paragraphe, la notion traitée est la même : le grand croit que sa naissance lui donne toutes les qualités et donc le droit de mépriser les plus petits.
Le lexique est repris d'un paragraphe à l'autre :
« prévention » apparaît aux
§ 19 et 20 ; «grands domaines » (19)
renvoie à « grandeur » (21),
« connaître » revient aux § 20
et 21 ; on retrouve ici volontiers un
procédé propre au discours dramatique :
l'enchaînement des répliques par le lexique.
Cependant, la forme discontinue s'ingénue à
éclater le discours en fragments : chaque texte
apparaît comme une structure close, qui se passerait
volontiers de l'entourage.
Charlotte Schapira (La Maxime et le discours
d'autorité, SEDES) explique ainsi
qu' « à l'intérieur d'un
même chapitre une maxime n'est pas complémentaire
de celle qui la précède ou lui
succède : elle ne prolonge pas la réflexion,
mais la recommence à l'infini. »
La forme discontinue naît d'un effet de mimétisme avec le sujet traité : La Bruyère décrit une société en pleine discordance, où des valeurs comme le mérite sont galvaudées et dévoyées.
Place centrale du personnage
Au milieu de ces maximes à la fois dépendantes mais étroitement liées, la place de Téléphon interroge. Il semble alors que le caractère permette d'illustrer, à la manière de l'étude d'un spécimen (« développer, manier, confronter »), les notions abstraites évoquées en 19 et 20. Téléphon prend à la fois la valeur d'exemple et de preuve de la véracité des paroles sentencieuses qui y gagnent en crédibilité. L'exemple est parlant et convaincant. Et il rend le texte d'autant plus divertissant que les contemporains n'ont eu de cesse de chercher quel personnage de l'époque se cachait derrière cette onomastique originale (Pamphile, Téléphon, Théobalde...).
Les pronoms de la 1re et de la 2e
personnes renvoient à la personne du locuteur et du
destinataire, présent ou absent. La 3e
personne désigne ici le sujet du discours.
Par ailleurs, les verbes sont au présent, temps par
excellence du discours direct dont relèvent les
répliques au théâtre. La ponctuation est
abondante, variée et très expressive. Elle
utilise les signes de ponctuation marquant la pause dans le
discours : le point, la virgule, le point virgule, les
deux points. Elle se substitue aux mots de liaison comme les
conjonctions de coordination et contribue donc à rendre
le discours plus fluide, plus lié, plus rapide (plus
direct, comme la parole ?) aussi puisqu'elle se passe de
mots encombrants.
Mais surtout, la ponctuation est ici
éminemment expressive par l'emploi qu'elle fait
des points d'interrogation et d'exclamation (§ 20). Ainsi,
les questions « Avez-vous de l'esprit, de la
grandeur, de l'habileté, du goût, du
discernement ? » ou « Quel moyen de
vous définir, Téléphon ? »
ne semblent pas appeler de réponse et sont comprises
comme questions rhétoriques. Le point d'exclamation
(après « approbation ») ponctue
une longue phrase accusatrice et montre l'indignation d'un
locuteur face aux pressions sociales qui confortent les grands
dans leur posture et soumettent les subalternes.
Une habile confusion dans les registres
Différents registres se côtoient ici habilement et montrent toute la diversité stylistique dont est capable La Bruyère :
- Le registre épique (grandeur exceptionnelle des personnages évoqués, profusion de qualités), ici détourné au profit de la critique (les grands deviennent alors des sortes de héros usurpateurs) : « Les grands croient être seuls parfaits, n'admettent qu'à peine dans les autres hommes la droiture d'esprit, l'habileté, la délicatesse », « Avez-vous de l'esprit, de la grandeur, de l'habileté, du goût, du discernement ? ».
- Le registre tragique (interrogations rhétoriques, exclamations) renvoie à nouveau au discours dramatique et montre tout le poids de la Fortune dans la valeur de l'homme (celui qui est bien né est voué à l'admiration, celui qui est mal né à la soumission) : « Me laisserai-je éblouir par un air de capacité ou de hauteur qui vous met au-dessus de tout ce qui se fait, de ce qui se dit et de ce qui s'écrit ; qui vous rend sec sur les louanges, et empêche qu'on ne puisse arracher de vous la moindre approbation ! Je conclus de là plus naturellement que vous avez de la faveur, du crédit et de grandes richesses. »
- Le registre argumentatif est le propre des maximes et des caractères, voués à dénoncer les travers de la société : il peut être très apparent (« Elles me sont suspectes, et je les récuse ») ou à peine caché dans tout l'appareil rhétorique des discours (lexique, tournures, articulation logique plus ou moins explicite ici...) et le vocabulaire lié à la critique (récuse, jugement).
La dimension monologique du passage
L'on a bien vu que le recours à la ponctuation
expressive contribue à émouvoir, indigner le
récepteur et rend donc le discours du locuteur plus
percutant puisqu'il touche à la sensibilité de
l'autre. De plus, ce discours semble s'adresser à un
absent nommé, Téléphon.
On sait que le monologue a dans le théâtre la
capacité de prendre le spectateur / lecteur directement
à partie puisque le personnage, seul en scène, ne
s'adresse pas à un autre personnage. Le destinataire
(nous) est donc directement impliqué. L'évocation
du personnage absent, Téléphon, établit
une connivence entre locuteur et récepteur, qui se
trouvent donc « unis » dans la critique.
L'énonciation repose tour à tour sur le flou de l'impersonnel, notamment avec les tournures présentatives (c'est, il y a), et sur la présence de la 1re personne du singulier et du pluriel par lesquelles perce la voix du moraliste (je, me, nous).
Par ailleurs, le présent est le temps dominant : il
est atemporel dans les paroles sentencieuses (§ 19 et 21)
et actualise avec vivacité le portrait du § 20.
Les thématiques sont caractéristiques du discours
moraliste, comme chez La Rochefoucauld ou Pascal : la
critique des grands, la remise en question de la
primauté de la naissance sur celle du mérite
personnel.
Une esthétique de l'accumulation
Maîtresses de la rhétorique de La Bruyère, les accumulations permettent d'amplifier les travers des grands, et donc de rendre la critique plus virulente : « n'admettent qu'à peine dans les autres hommes la droiture d'esprit, l'habileté, la délicatesse » ; « ce qu'il y a jamais eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et peut-être d'une conduite plus délicate » ; « Avez-vous de l'esprit, de la grandeur, de l'habileté, du goût, du discernement ? » ; « un air de capacité ou de hauteur qui vous met au-dessus de tout ce qui se fait, de ce qui se dit et de ce qui s'écrit. »
La surabondance des propositions relatives contribue aussi à surcharger l'énoncé et à rendre certains traits de la critique plus palpables, plus éloquents : « ce qu'il y a jamais eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et peut-être d'une conduite plus délicate » (vaste relative substantive sujet de « ne nous est pas toujours venu » et introduite par le pronom relatif complexe « ce que ») : la relative se développe pour mieux montrer tout ce qui n'est pas du fait des grands ; « qui publient hardiment votre mérite » complète « la prévention et la flatterie » et les personnifient au point de critiquer derrière ces notions ceux qui les pratiquent et vendent leur âme aux grands ; « qui vous met au-dessus de tout ce qui se fait, de ce qui se dit et de ce qui s'écrit ; qui vous rend sec sur les louanges, et empêche qu'on ne puisse arracher de vous la moindre approbation » : ces relatives adjectives complètent « un air de capacité ou de hauteur » et développent les travers des grands qui se permettent, au nom de la naissance, tous ces écarts de civilité.
Les cibles de la critique
La critique a plusieurs cibles ici, plus ou moins évidentes :
- les grands, c'est-à-dire à la fois le Roi (bien peu concerné par l'état et le devenir de ses sujets), les nobles qui ont leur naissance comme garant de leur mérite (« choses dues à leur naissance », « un air de capacité ou de hauteur ») et ceux qui bénéficient de faveurs et privilèges ;
- les courtisans, qui caressent l'ego des grands pour accéder à quelque privilège (« la prévention et la flatterie ») ;
- les plus petits, qui servent docilement l'orgueil des grands sans changer quoi que ce soit à cette condition, ne servant guère que de confident ou de faire-valoir (« leurs subalternes », « Votre homme de confiance, qui est dans votre familiarité »).
On trouve chez La Bruyère les ferments de la critique de la société et du pouvoir qui marqueront à peine quelques années plus tard la littérature du siècle des Lumières et auront les conséquences politiques que l'on sait : la Révolution et le renversement de la monarchie.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









