Les Caractères : lecture méthodique 2
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
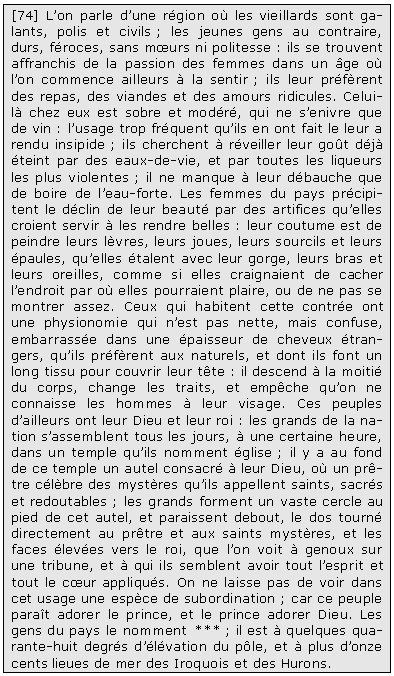
Si La Fontaine a transposé la peinture des moeurs de son temps dans le règne animal, La Bruyère s'essaie dans le caractère 74 (chapitre « De la cour ») à la transposition dans l'ailleurs, procédé cher au conte philosophique à l'honneur au siècle suivant (Candide, Micromégas, « Les Troglodytes » dans Les Lettres persanes). Dès lors, la critique avance masquée, projetée en d'autres lieux, en d'autres hommes.
Le chapitre « De la Cour » est sans doute l'un des plus représentatif de la critique des moeurs de la société de La Bruyère. Cet extrait surprend, en contexte, par ses différences avec les textes précédents. Soit les maximes sont courtes et plutôt incisives, soit les portraits cernent un personnage en particulier, montré pour ses travers ou la catégorie humaine qu'il représente (comme Théodote). Notre texte est bien plus long qu'une maxime, mais n'offre pas le portrait d'un personnage singulier.
La mise en scène nous transporte en un lieu aux contours à peine esquissés par l'adverbe « ailleurs » et les articles ou les adjectifs qui le déterminent (« une région, du pays, de la nation, cette contrée). Aucun nom n'est donné à ce mystérieux pays, pas plus qu'il n'est donné de nom à son roi ou au Dieu qu'honorent ses habitants. Rien n'est clairement décrit ou défini, pas même l'époque, et la référence aux Iroquois et aux Hurons, des Indiens d'Amérique, suffit à entraîner notre imagination vers l'inconnu, l'étranger, par-delà les mers, vers d'autres continents.
Des habitants aux moeurs peu définies
La présentation du peuple de ce pays inconnu suit une progression organisée : les hommes (les vieux puis les jeunes), les femmes, les grands, le roi, et Dieu. Cette hiérarchie reproduit la pyramide sociale traditionnelle : le peuple, la cour, le Roi et Dieu ; on retrouve donc ici le schéma connu des contemporains de La Bruyère et déjà, le charme de l'exotisme est presque rompu.
La description des habitants sollicite beaucoup
l'accumulation (d'adjectifs, de COD, de verbes) mais reste
pourtant très lacunaire et confine à la
caricature : les vieux sont sages, les jeunes sots, les
femmes tentatrices, la cour adore son roi et Dieu règne
sur tous.
Finalement, rien n'est précisé : Qui sont
ces gens ? A quoi ressemblent-ils ? Quelle est leur
religion ? Où habitent-ils ? Sont-ils
contemporains de la société de La
Bruyère ?
Pourquoi La Bruyère déploie-t-il tant de moyens (texte long, description organisée, accumulation d'informations) pour si peu d'informations ?
La syntaxe nous avertit très vite sur la face cachée du texte : plusieurs dizaines de lignes pour seulement sept phrases. Lorsque l'on vient de lire les maximes qui précèdent, il y a de quoi être surpris ! Parataxe et hypotaxe engloutissent les informations qu'elles contiennent, comme pour mieux déconstruire la référence que le moraliste s'évertuait à construire par l'ajout de détails. Ainsi concentrées, les données ne livrent qu'une vision très parcellaire du sujet, qu'il s'agisse des habitants, des dirigeants, des lieux ou des rituels décrits. A l'instar de la physionomie des autochtones, l'ensemble de ce texte « n'est pas net, mais confus », comme « embarrassé » de tout cet apanage stylistique.
D'ailleurs tout tend dans le style du texte à jeter le trouble : l'indéfini et l'impersonnel en régissent le système énonciatif, de même que le présent atemporel qui fait sombrer toute chance d'ancrage référentiel clair dans un temps donné. Et toute information un peu précise qui nous est donnée est aussitôt atténuée soit par l'accumulation de détails souvent peu utiles, soit par la rétention de l'information juste par le moraliste lui-même. C'est ainsi que l'église pourrait aussi bien être un temple, et la dévotion, une « espèce de subordination ».
Les cibles de la critique
Nul doute, la voix du moraliste se fait bien entendre et tout ici ramène à la société française et au public contemporain de La Bruyère généralement visés par les Caractères, comme par les Maximes de La Rochefoucauld.
Le peuple est critiqué pour ses travers et apparaît ici comme une société corrompue, dont les jeunes hommes sombrent dans l'ivresse et les femmes dans la luxure. Ce peuple, inapte à juger du bon et du mauvais, voue une confiance aveugle en son roi. Pourtant, un chiasme quasi final montre que ce prince voue lui aussi un véritable culte à un Dieu sans nom, qui pourrait tout aussi bien être quelque Veau d'Or. Quel aveuglement que celui du peuple qui s'en remet à un seul être !
Insidieusement, tout nous ramène à la société française. Louis XIV, représentant de Dieu sur terre, n'a-t-il pas fini son règne sous la totale domination de la religion ? S'est-il jamais réellement intéressé au sort de la masse populaire, lui qui vivait entouré d'une cour fervente et obséquieuse ?
En se référant à la structure générale des Caractères, on peut considérer que ce texte aurait eu sa place dans d'autres chapitres, comme « Du souverain ou de la république », « De l'homme », puisqu'il aborde des thématiques développées dans ces chapitres. De la même manière, son allusion aux femmes aurait pu figurer dans le chapitre « Des femmes ».

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









