Les Caractères : lecture méthodique 1
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
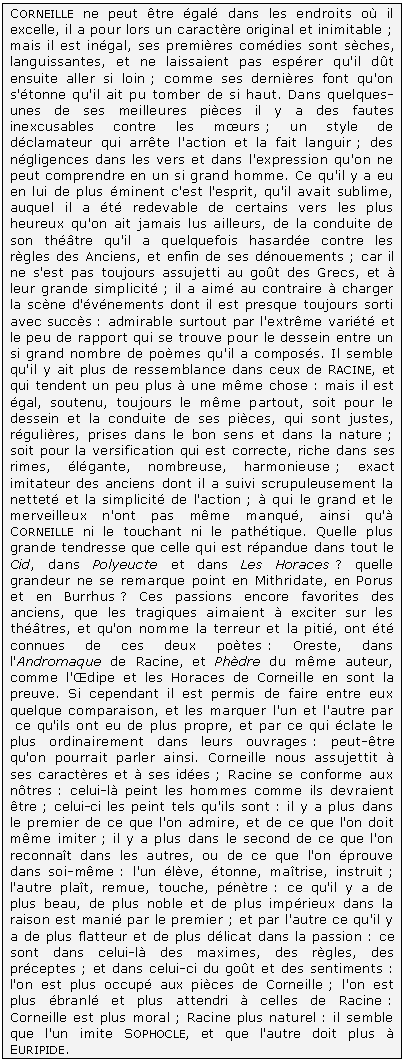
Bien entendu, La Bruyère considère comme des modèles Racine et Corneille, deux Titans de la littérature du XVIIe.
La Bruyère se positionne ici clairement du côté des Anciens dans la fameuse Querelle qui opposera, à la fin du siècle, les partisans de la modernité (Perrault, Fontenelle) à ceux de l'imitation des grands auteurs antiques (Boileau, La Fontaine).
Les tournures et le vocabulaire sont propices à vanter les qualités de Corneille et Racine et relèvent ainsi de la grandiloquence de l'éloge :
- les accumulations développent sans fin les qualités des auteurs (« mais il est égal, soutenu, toujours le même partout, soit pour le dessein et la conduite de ses pièces, qui sont justes, régulières, prises dans le bon sens et dans la nature, soit pour la versification qui est correcte, riche dans ses rimes, élégante, nombreuse, harmonieuse ») ;
- les relatives contribuent comme les accumulations à étendre les propos flatteurs (« c'est l'esprit, qu'il avait sublime, auquel il a été redevable de certains vers, les plus heureux qu'on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son théâtre, qu'il a quelquefois hasardée contre les règles des anciens ») ;
- le superlatif exacerbe les qualités, les grandit (« quelques-unes de ses meilleures pièces », « certains vers, les plus heureux », « ce qu'il y a eu en lui de plus éminent ») ;
- le vocabulaire est lui aussi mis au service de la flatterie ; il est essentiellement laudatif : « admirable », « élégante », « harmonieuse », « grand », « merveilleux », « délicat ».
Finalement, tous ces procédés relèvent de l'hyperbole : ils mettent en valeur et amplifient les qualités de ces deux grands dramaturges, pour justifier leur statut de modèles.
Opposition entre les deux auteurs
Racine se conforme très strictement aux règles fixées par les Anciens : « la conduite de ses pièces, qui sont justes, régulières », « exact imitateur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la simplicité de l'action » ; de plus, ses personnages sont directement inspirés de la nature humaine.
Corneille, lui, s'émancipe quelque peu des instructions : « il ne s'est pas toujours assujetti au goût des Grecs et à leur grande simplicité ».
Le parallélisme confronte les deux auteurs, ce qui les caractérise et les oppose, dans des constructions absolument similaires. Le parallélisme s'appuie sur le jeu de balance des noms, puis des pronoms comme l'un / l'autre, celui-là / celui-ci, le premier / le second : « Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se conforme aux nôtres ; celui-là peint les hommes comme ils devraient être, celui-ci les peint tels qu'ils sont. Il y a plus dans le premier de ce que l'on admire, et de ce que l'on doit même imiter ; il y a plus dans le second de ce que l'on reconnaît dans les autres, ou de ce que l'on éprouve dans soi-même. L'un élève, étonne, maîtrise, instruit ; l'autre plaît, remue, touche, pénètre... ».
Supériorité de l'un sur l'autre : parti-pris de La Bruyère ?
On peut dire que Corneille excelle dans l'action et Racine dans la psychologie.
Le premier a l'art de suspendre l'action pour mieux ensuite
déchaîner les événements, et il
cède volontiers à la surcharge, même dans
les caractères des personnages dont la grandeur s'impose
aux spectateurs comme un modèle inaccessible.
Racine, lui, offre une action plus monotone et approfondit
davantage la psychologie des personnages dont il fouille les
passions.
La Bruyère semble reprocher à Corneille ses écarts (« les endroits où il excelle » sous-entend qu'il n'excelle pas dans tout !). Racine, lui, est parfaitement conforme (« exact », « scrupuleusement ») aux règles en vigueur et La Bruyère y voit une marque de perfection et se range par là-même du côté des Anciens.
Racine et Corneille sont très fidèles aux modèles antiques et participent donc activement à la pérennité des normes. Leur style est identifiable mais largement inspiré des Anciens. Ils gagnent donc leur droit à être considérés comme des modèles et les siècles qui ont suivi n'ont cessé de le confirmer.
Les modèles évoqués ici sont Sophocle et Euripide essentiellement, mais aussi plus généralement les Grecs (à nous de lire en filigrane Homère et Virgile, probablement).
Homère et Virgile sont les pères de
l'épopée et de la versification à
vocation narrative ; les pièces de Racine et
Corneille sont écrites en vers, rappelons-le ; et
leurs grands héros appartiennent à
l'Antiquité.
Sophocle et Euripide sont, eux, les pères de
la tragédie.
L'idéal de l'art dramatique
L'art dramatique selon La Bruyère devrait suivre
scrupuleusement les règles dictées par les
Anciens : pureté et imitation.
On remarque que la tragédie, genre noble d'après
les Classiques, a la part belle ; en effet, Molière
est cité dans ce chapitre « Des ouvrages de
l'esprit », mais s'il a su bien imiter
Térence, il est beaucoup trop vulgaire au goût de
La Bruyère. Et pourtant, il y a beaucoup de similitudes
entre certains caractères de La Bruyère et
certains personnages de Molière !
La doctrine classique, un idéal esthétique ?
A travers le parallèle entre Racine et Corneille, La Bruyère révèle la conception classique du théâtre mais aussi plus globalement les préceptes élémentaires de la doctrine littéraire classique : expression juste et nécessitant goût et travail, respect de la morale et surtout l'imitation des Anciens, modèles inégalés. Les Anciens, d'ailleurs, sont largement évoqués dans ce texte et à travers eux, le poids du patrimoine littéraire.
On peut penser que La Bruyère prônerait tout aussi bien l'imitation des Anciens dans les autres arts que l'art dramatique ; seuls les contemporains qui les imitent bien sont jugés valables, et les plus audacieux, qui osent s'en émanciper, sont dénigrés. On est donc ici au coeur de la Querelle des Anciens et des Modernes. Rappelons que l'élection de La Bruyère à l'Académie française fut considérée comme une victoire des Anciens et son Discours de réception à l'Académie rend compte de cette victoire.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









