La mise en place des appareils reproducteurs- Seconde- SVT
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Expliquer comment sont mis en place l’appareil sexuel féminin et l’appareil sexuel masculin au cours du développement embryonnaire (déterminisme génétique et hormonal du sexe biologique).
- Le sexe est déterminé génétiquement, dès la fécondation. Les femmes possèdent deux chromosomes X, les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y.
- La mise en place de l’appareil sexuel se
réalise sur une longue période qui va de
la fécondation, au développement embryonnaire
puis fœtal. 3 stades se succèdent :
- le sexe génétique (gonades indifférenciées, appareil génital indifférencié) ;
- le sexe gonadique (gonades différenciées, appareil génital indifférencié) ;
- le sexe phénotypique (gonades différenciées, appareil génital différencié).
- Deux événements permettent de passer d'un
stade totalement indifférencié (sexe
génétique) à un stade totalement
différencié (sexe phénotypique) :
- la différenciation des gonades en testicules ou en ovaires ;
- la différenciation de l’appareil génital (maintien du canal de Wolff et régression du canal de Muller chez les hommes, régression du canal de Wolff et maintien du canal de Muller chez les femmes).
- La différenciation de l’appareil sexuel
est dépendante du patrimoine
génétique de l’individu :
- L’acquisition du sexe gonadique mâle puis du phénotype sexuel mâle nécessite la présence du gène sry (situé sur le chromosome Y). L’expression de ce gène déclenche l'expression d'autres gènes et induit la différenciation des gonades en testicules.
- En l'absence de gène sry, et en présence d'autres gènes (dont certains situés sur le chromosome X), les gonades deviennent des ovaires et il y a acquisition du sexe gonadique femelle.
- La différenciation est également sous
contrôle hormonal :
- Les testicules produisent deux hormones : la testostérone et l’AMH. La testostérone est à l’origine du développement des canaux de Wolff et des organes génitaux externes tandis que l’AMH entraîne parallèlement une régression des canaux de Müller.
- Chez la femelle, en absence de testostérone et d’AMH, les canaux de Wolff régressent et les canaux de Müller se maintiennent et forment l’appareil génital féminin.
- À la naissance, l’appareil génital est formé mais il n’est pas fonctionnel.
Au début du développement embryonnaire, il y a
mise en place d’un appareil génital ne
présentant aucune différence entre les embryons
mâles et les embryons femelles : c’est le premier
stade appelé le stade phénotypique
indifférencié.
Cet appareil est formé tout d’abord de gonades
indifférenciées qui pourront évoluer
soit vers un testicule soit vers un ovaire : on les appelle
gonades bipotentielles.
L’appareil génital comprend aussi deux paires de
canaux : les canaux de Müller et les canaux de Wolff.
Ces canaux vont évoluer différemment selon le
sexe : maintien du canal de Wolff et régression
du canal de Muller chez les hommes, régression du
canal de Wolff et maintien du canal de Muller chez les
femmes.
Parmi les 46 chromosomes présents dans la cellule œuf humaine, 2 déterminent le sexe : XX chez la fille et XY chez le garçon.
La paire de chromosomes sexuels se reconstitue au
moment de la fécondation. On connaît de
nombreuses anomalies du caryotype portant sur ces
chromosomes sexuels. de l’évolution de
la gonade bipotentielle en ovaire ou en testicule.
- certaines filles possèdent plus de deux
chromosomes X ou un seul X mais aucun chromosome Y.
- certains garçons ont un seul chromosome X et
deux chromosomes Y : ils ne présentent pas
d’anomalies. D’autres ont un seul Y et
plusieurs X : ils ont bien le type masculin.
| Caryotype | Sexe phénotypique | Gonades | Aspect clinique |
| 47, XXY | masculin | Testicules sans spermatogonies | syndrome de Klinefelter : stérilité |
| 47, XYY | masculin | Testicules normaux | phénotype normal : fertilité |
| 47, XXX | féminin | Ovaires normaux | phénotype normal : fertilité |
| 45, XO | féminin | Régression fœtale des ovaires, après leur différenciation | syndrome de Turner : stérilité |
Ainsi on constate l’importance de la
présence d’un chromosome Y pour la
détermination du sexe masculin. Le sexe
féminin semble être lié à
l’absence du chromosome Y quel que soit le nombre
de X.
Des observations complémentaires montrent
qu’une seule partie du chromosome Y est
nécessaire à la différenciation de
la gonade bipotentielle en testicule :
Protocole :
En 1991, des chercheurs isolent un petit fragment de la
partie 1 du chromosome Y qui comprend un gène
appelé sry. Ils réalisent une
expérience de transgénèse : ils
insèrent ce gène sry dans l’ADN
d’un embryon de souris de caryotype XX.
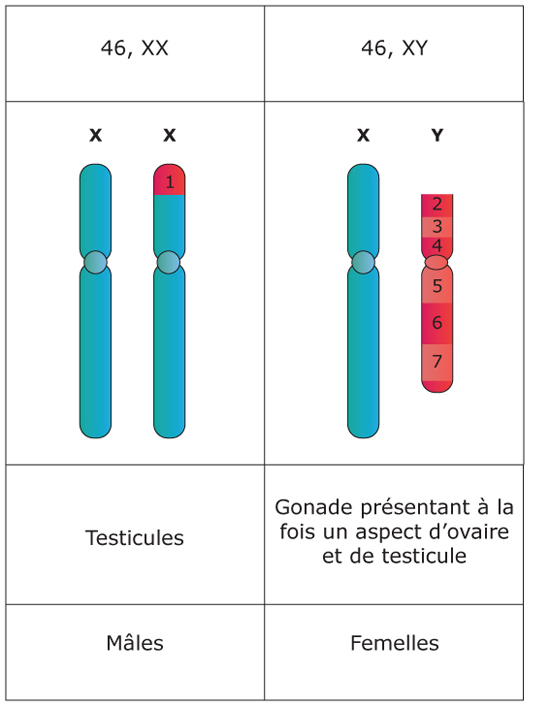
Résultats :
Cette souris transgénique acquiert au cours de son
développement embryonnaire des testicules.
Interprétation :
L’acquisition du sexe gonadique puis du
phénotype sexuel mâle implique donc tout
d’abord la présence du gène sry,
Sex-determining Region of Y.
L’expression du gène sry permet la
synthèse de la protéine SRY
appelée TDF = Testis Determining
Factor. Cette protéine est le signal de
développement des gonades en testicules,
c’est le signal de masculinisation.
La protéine SRY se lie à l’ADN et
active en cascade l’expression de nombreux
gènes.
En absence de protéine SRY, et sous l'effet de
gènes portés entre autre par le chromosome
X, les gonades deviennent des ovaires et il y a
acquisition du sexe gonadique femelle.
La différenciation de l’appareil sexuel est
donc dépendante du patrimoine
génétique de l’individu.
Dans l’espèce bovine, les gestations gémellaires sont assez fréquentes. Quand les deux fœtus sont de sexes différents, la femelle de caryotype XX, présente pourtant systématiquement des anomalies : elle est stérile, ses ovaires sont de très petite taille, les trompes utérines très peu développées ou absentes, certains organes masculins comme les vésicules séminales peuvent être présentes. On sait qu’une autre particularité de l’espèce bovine réside dans la fusion des vaisseaux sanguins des placentas des jumeaux, ce qui entraîne des échanges de sang entre les deux fœtus.
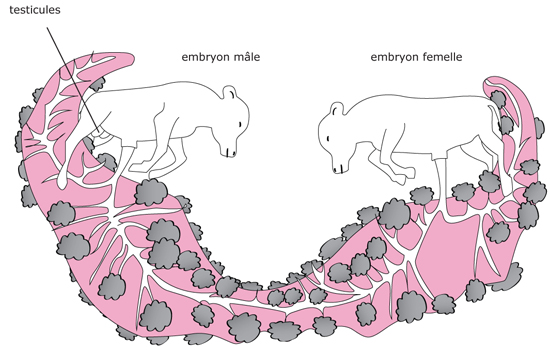
Ces observations faites au début du 20e
siècle ont permis de poser
l’hypothèse que le testicule fœtal du
jumeau mâle élabore une hormone
véhiculée par le sang et qui affecte le
développement des gonades chez le jumeau
femelle.
En 1947, le biologiste Alfred Jost met au point plusieurs
techniques d’intervention sur l’appareil
reproducteur du fœtus. Il réalise
grâce à celles-ci trois interventions sur le
lapin. Tout d’abord, la castration de fœtus
mâle et femelle au stade des gonades
indifférenciées, c’est-à-dire
avant 19 jours de développement. Il observe alors
que les canaux de Wolff disparaissent tandis que ceux de
Müller subsistent.
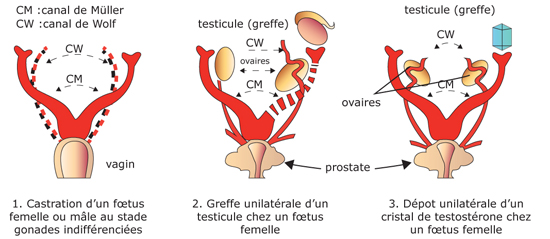
Puis il greffe unilatéralement un testicule chez
un fœtus femelle ; les résultats montrent
que du côté greffé, il y a
dégénérescence du canal de
Müller et la formation d’un
pseudo-épididyme qui résulte du maintien du
canal de Wolff. Aussi, il y a différenciation de
la prostate. De l’autre côté, il y a
féminisation des voies génitales comme
quand il n’y a pas de testicule.
Donc les testicules permettent la masculinisation
de l’appareil génital.
La dernière expérience
réalisée consiste à déposer
unilatéralement un cristal de testostérone
chez un fœtus femelle ; il y a alors maintien et
différenciation des canaux de Wolff et le
développement de la prostate. Donc le testicule
par ses sécrétions masculinise
l’appareil génital. Par contre, les canaux
de Müller subsistent : cette hormone permet donc le
maintien et la différenciation des canaux de Wolff
mais pas la régression des canaux de
Müller.
La régression des canaux de Müller est sous
contrôle d’une autre hormone elle aussi
fabriquée par les testicules : l’hormone
anti-Müllerienne ou AMH.
Les testicules produisent donc 2 hormones : la
testostérone et l’AMH, hormone
anti-müllérienne qui vont
dé-féminiser l’appareil
génital indifférencié et le faire
évoluer dans le sens mâle. La
testostérone est à l’origine du
développement des canaux de Wolff et des organes
génitaux externes tandis que l’AMH
entraîne parallèlement une régression
des canaux de Müller.
Chez la femelle, en absence de testostérone et d’AMH, les canaux de Wolff régressent et les canaux de Müller se maintiennent et forment l’appareil génital féminin.
À la naissance, les structures génitales sont en place mais ne sont pas fonctionnelles.
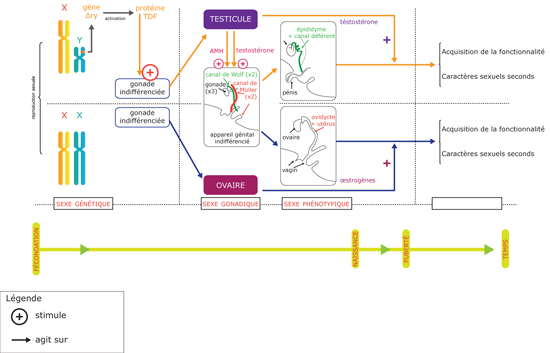

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









