La loi : prescrire et interdire
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
- D’après la Déclaration de 1789, la loi est « l’expression de la volonté générale ».
- La Constitution de 1958 définit la loi comme le texte que vote le Parlement (le pouvoir législatif) dans la limite de son domaine de compétences.
- La loi est l’ensemble des règles et des normes d’une société donnée, elle indique aux membres d’une société ce qu’ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire.
- Les lois sont des règles juridiques générales, formulées par écrit, des dispositions abstraites, émanant des autorités ayant le pouvoir législatif (Assemblée Nationale et Sénat).
• La loi est générale : elle s’applique sur tout le territoire national, on dit qu’elle est générale dans l’espace ;
• La loi est impersonnelle : elle est commune à tous, n’est pas faite pour un cas particulier mais une série de cas susceptibles de se présenter ;
• La loi est permanente, du jour de son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation ou son remplacement ;
• La loi est obligatoire : les règles de droit s’imposent à tous, des sanctions sont prévues lorsqu’elles ne sont pas respectées.
Cette règle est indispensable à la stabilité sociale : l’autorité du droit ne peut dépendre de circonstances propres à un individu (comme ses connaissances ou son ignorance).
Elle doit être adoptée par les deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.

|
| Doc. 1. Le Sénat, Paris |
La révision de la Constitution est définitive après approbation du Congrès du Parlement (réunion des deux chambres) ou après référendum.
Par exemple, au mois de septembre 2000, un référendum de révision de la Constitution pour la réduction du mandat présidentiel à 5 ans a été soumis aux citoyens français.
Elles sont adoptées après avoir respecté la navette parlementaire entre l’Assemblée et le Sénat.
Parmi elles on distingue : les lois de finance (qui déterminent les ressources et les charges de l’État), les lois de financement de la Sécurité sociale, les lois autorisant la ratification des traités internationaux, notamment.
Exemple :
Les grands principes du système éducatif français, tels que le droit à l’éducation et le droit à l’expression, sont formulés par la loi (et complétés par des règlements, des décrets et des circulaires).
Le Code de l’éducation réunit l’ensemble des dispositions relatives au système éducatif français.
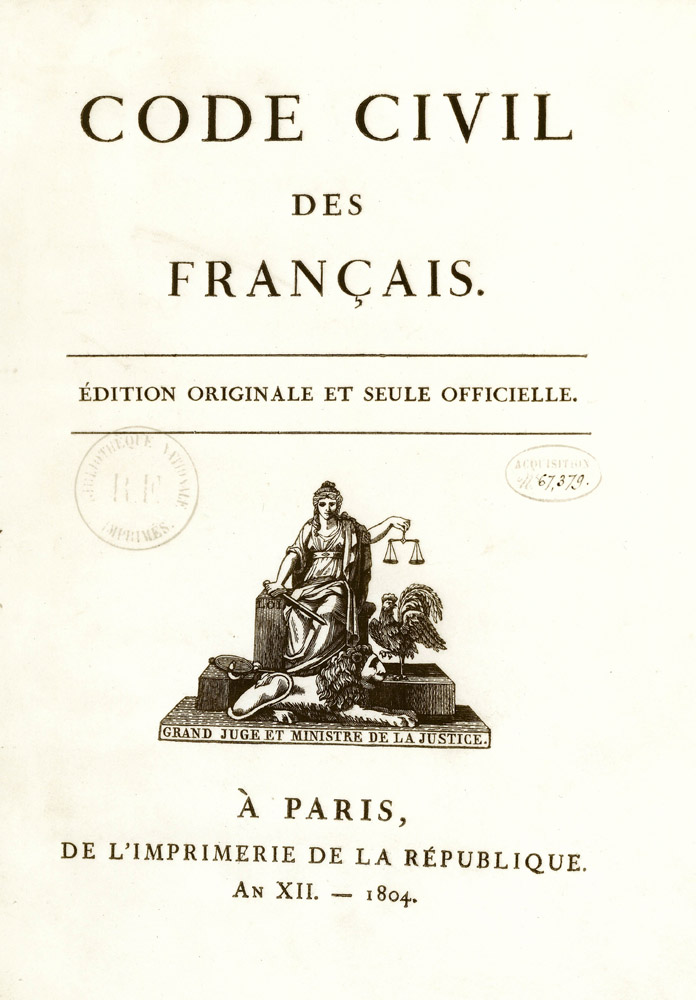
|
| Doc. 2. Couverture du Code civil, élaboré par Napoléon en 1804 |
Depuis Napoléon (le texte a été promulgué le 21 mars 1804), le Code civil a été largement modifié (on trouvait encore 1 120 articles en 2000 sur les 2 281 articles d’origine) ; cependant, il est encore le fondement du droit civil français et il a constitué une source d’inspiration pour de nombreux pays dans le monde.
Elle présente certains caractères : elle est générale, obligatoire, impersonnelle et permanente.
C’est une règle de conduite positive ou négative, donnant des droits, imposant des devoirs, formulant des interdictions, dont le respect est, si nécessaire, assuré au moyen d’une contrainte étatique, avec l’aide de la force publique et le recours possible à la justice.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









