L'Assommoir : lecture méthodique II
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Situation du
passage
Après avoir été abandonnée par
Lantier, Gervaise a trouvé du travail chez une
blanchisseuse, Madame Fauconier. Elle a fait la connaissance
d’un ouvrier zingueur Coupeau. Ils se rencontrent dans un
café, L’Assommoir, du père Colombe.
Dans l’établissement se trouve l’alambic.
Le
passage
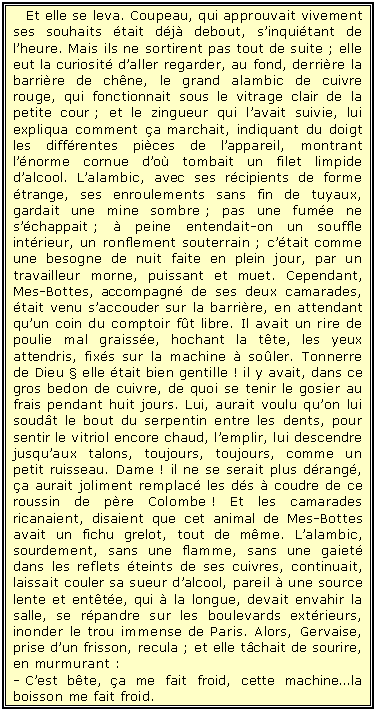
Le texte témoigne d’une volonté de l’auteur d’offrir selon les principes de la doctrine naturaliste, une image fidèle de la réalité. Mais le réalisme chez Zola est constamment dépassé par l’imaginaire, par l’introduction d’images qui font d’un simple réalisme un réalisme poétique.
Nous étudierons les marques du réalisme et les menaces qui pèsent sur les personnages puis l’étude de la description de l’alambic mettra en valeur sa fonction symbolique en tant que mythe narratif.
Les axes
Zola emploie le style indirect et un langage argotique pour produire un effet de réel et transcrire la verdeur des propos que tient ce personnage : « elle était bien gentille ! Dame ! il ne serait plus dérangé, ça aurait joliment remplacé les dés à coudre de ce roussin de père Colombe ! ». Zola le fait même jurer « Tonnerre de Dieu ! ».
Il retranscrit également au style indirect les propos des camarades de Mes-Bottes pour reproduire leur langage familier : « Et les camarades ricanaient, disaient que cet animal de Mes-Bottes avait un fichu grelot, tout de même ».
Outre l’écriture réaliste, ce qui caractérise cet extrait est le dépassement du réalisme au profit d’une écriture poétique à travers la description de l’alambic.
• Le stade symbolique va permettre ensuite de déboucher sur le stade épique de la description. Un registre épique est un registre présentant une vision amplifiée du réel où souvent les forces du bien et du mal se livrent un combat sans merci. Ce que l’on peut retenir d’épique dans cette description est l’exagération dans la description du pouvoir de l’alcool. Cette évolution se manifeste d’abord à travers la thématique de l’eau : au « petit ruisseau » de Mes-Bottes se substitue à la fin du texte « une source lente et entêtée ». Il est important de souligner la caractérisation adjectivale qui insiste sur la force, le pouvoir souterrain mais bien réel de cet alcool.
Dans ce passage, Zola installe un décor réaliste et populaire à travers lequel apparaissent des signes de menace pour les protagonistes. La description de l’alambic permet de dépasser une simple conception réaliste de l’écriture. En effet, il confère à l’alambic une portée épique, il devient une force monstrueuse et maléfique, symbole de l’alcoolisme qui touche un grand nombre de parisiens de cette époque, en particulier chez les ouvriers.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









