Les Lettres persanes : lecture méthodique IV
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
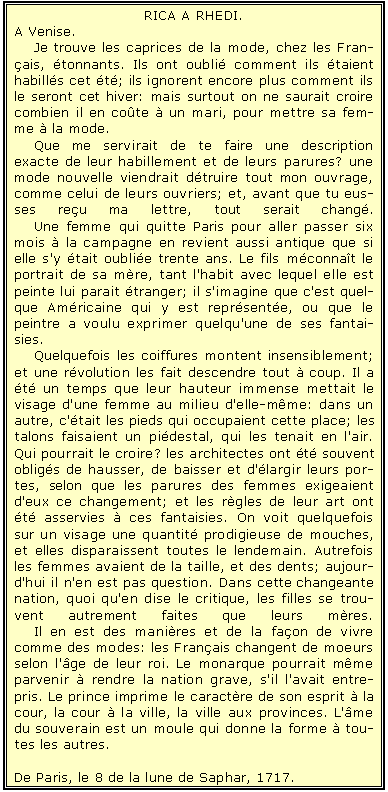
Rica et Usbek ne cessent de déplorer l’inconstance et la frivolité des Français (Lettre XCVIII : « Il n’y a point de pays au monde où la fortune soit si inconstante que dans celui-ci. »). Mais l’étonnement perpétuel du Persan rend cet amer constat toujours désopilant. La critique n’en passe que plus facilement auprès du public de l’époque.
Le lexique de la perception visuelle martèle la description : « description », « portrait », « peinte », « représentée », « on voit ».
Les images visuelles, certes amusantes, sont surtout marquées par l’exagération des formes, des mouvements, l’instabilité : « les coiffures » montent et descendent, « les mouches » apparaissent et disparaissent, les femmes sont complètement déformées (« autrefois, les femmes avaient de la taille et des dents ; aujourd’hui, il n’en est pas question ») par l’œil critique de l’étranger.
• Les oppositions jouent aussi sur les contrastes exagérés : « six mois » / « 30 ans », « quantité » / « disparaissent toutes ».
• Les images sont déroutantes et ridicules : « visage » et « pieds » d’une femme sens dessus dessous, si bien que les femmes s’en trouvent déformées, transformées en sorte de monstres auxquels les architectes doivent adapter les bâtisses (« les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d’élargir leurs portes… »).
Les changements sont aussi spectaculaires : « monter / descendre, présence / disparition ».
Les changements « étonnent » le Persan, verbe à nouveau à prendre au sens très fort de l’étymologie et renforcé par l’expression de la surprise, « qui pourrait le croire… ? »
Les « caprices » renvoient une image très négative de ce peuple instable, incapable de se fixer, capable de renier ce qu’il a adoré juste avant. Ces caprices sont renforcés par la répétition du terme « mode » qui renvoie à l’éphémère.
La comparaison ( « comme » ) permet de dévier des modes vestimentaires aux mœurs générales des Français et surtout au pouvoir royal et à ses humeurs. La versatilité du peuple épouse celle du Roi. Avec l’emploi du conditionnel « pourrait », l’auteur se gausse de cette versatilité avec beaucoup d’ironie et rend le peuple soumis à ce monarque facétieux extrêmement ridicule.
Le Roi est évoqué de manière très dépréciative, essentiellement grâce à la métaphore du « moule qui donne la forme à toutes les autres » : le terme de fabrication dépersonnalise le monarque et fait écho au verbe « imprimer » (« Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour » ).
Aussi peu de respect à l’égard (et notamment la boutade sur son âge !) du Roi ne peut que choquer le lecteur de l’époque.
Bien entendu, l’objectif de la lettre n’est pas tant de faire réfléchir les Français sur leurs habitudes vestimentaires, que de leur faire prendre conscience de l’instabilité de leurs mœurs. La critique du Roi est acerbe, et vaut pour la Cour et ses sujets. Le Persan peut se permettre de telles critiques grâce à son statut d’étranger un peu original mais on sent bien l’empreinte du philosophe éclairé derrière l’œil amusé de Rica.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









