Germinal : lecture méthodique II
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
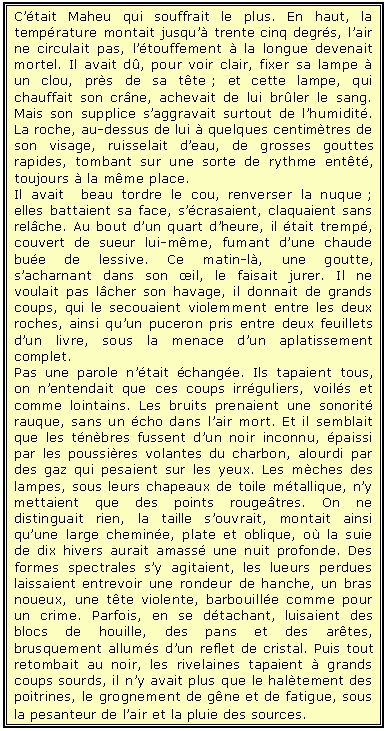
Ce texte se situe au début du chapitre 4 de la première partie consacrée à l’exposition des personnages et de leur situation. Etienne a été engagé à la mine dans l’équipe de Maheu.
A travers la description réaliste de Maheu, des mineurs et de la mine, Zola a su faire preuve de réalisme pour mieux dénoncer les conditions de travail.
Nous étudierons tout d’abord le personnage de Maheu dont le travail est dominé par la souffrance puis nous montrerons que la description du travail des mineurs offre une vision réaliste et révoltante de leurs conditions de travail.
• La difficulté du travail des mineurs est renforcée par plusieurs autres éléments. Il n’y pas d’air « l’étouffement à la longue devenait mortel » ce qui implique l’idée d’une véritable torture et renforce l’idée de souffrance.
La lampe de Maheu loin d’être un adjuvant à son travail apparaît comme un véritable opposant, un objet qui renforce l’idée de souffrance avec l’expression « cette lampe qui chauffait son crâne ». Zola emploie à la suite une métaphore hyperbolique « achevait de lui brûler le sang ». De plus, la position physique de Maheu renforce l’inconfort « il avait beau tordre le cou, renverser la nuque ». Et cette souffrance débute avec le travail « au bout d’un quart d’heure ».
• La construction de la phrase « La roche, au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisselait d’eau, de grosses gouttes continues et rapides, tombant sur une sorte de rythme entêté, toujours à la même place » rend compte de sa souffrance.
• En effet, cette longue phrase est composée d’une série d’énumérations mimant l’eau qui tombe inlassablement sur le personnage. De plus, l’eau est personnifiée à l’aide de trois verbes « battaient, s’écrasaient, claquaient ». De plus, il est à remarquer, dans cette phrase, l’importance des sonorités ou allitérations en [g], [t], [R] et [K] récurrentes avec les mots « grosses gouttes », « continues », « tombant », « rythme entêté », « toujours ». Ces sonorités renforcent l’acharnement de l’eau sur le mineur. De plus, Maheu n’est pas le sujet de la phrase, ce sont les éléments naturels, « la roche » et « les gouttes » qui ont fonction de sujet.
• Cependant Maheu apparaît comme un homme courageux, une série d’expressions marquent son obstination, sa résistance : « il ne voulait pas », « il avait beau », « il donnait de grands coups ». L’emploi de l’imparfait peut être considéré comme un imparfait d’habitude ce qui accentue le courage du mineur. Mais la fin du premier paragraphe marque l’infériorité du mineur puisqu’il est comparé à « un puceron pris entre deux feuillets d’un livre ». Il est relégué au rang d’animal.
Il n’y pas de repérage spatial possible dans la mine. Les seules annotations de lumière sont rares et insistent sur la faiblesse de la lumière, « les lueurs perdues, des formes spectrales ».
La parole humaine disparaît comme le montrent deux expressions comprenant des négations : « pas une parole n’étaient échangées », « on n’entendait que des coups irréguliers ». On entend seulement le bruit du travail des mineurs, toute humanité a disparu.
• L’évocation des mineurs insiste sur leur déshumanisation causée par le travail de façon réaliste. Le corps des mineurs apparaît comme par blason « une rondeur de hanche », « un bras noueux », « une tête violente, barbouillée ». Les hommes sont déshumanisés et réduits : « à des membres ». De plus, les bruits qu’ils émettent participent à cette déshumanisation : « halètement, grognement ». Les mineurs sont réduits à deux souffles.
Une comparaison avec l’animal se profile derrière ces deux notations auditives. Il est intéressant de remarquer que le mot mineur n’apparaît pas dans ce deuxième paragraphe et qu’il n’est pratiquement jamais sujet. L’emploi du pronom « tout » accentue l’anonymat des mineurs. Par opposition, la mine semble se nourrir et resplendir de la souffrance humaine « luisaient des blocs de houille (…) brusquement allumés d’un reflet de cristal. »
A travers ces deux paragraphes, Zola a su décrire avec réalisme les difficiles conditions de vie des mineurs. Implicitement, ce passage pratique la dénonciation. La comparaison de Maheu à un puceron laisse présager de la fin : le Voreux engloutira sa ration de mineurs.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









