Germinal : lecture méthodique III
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
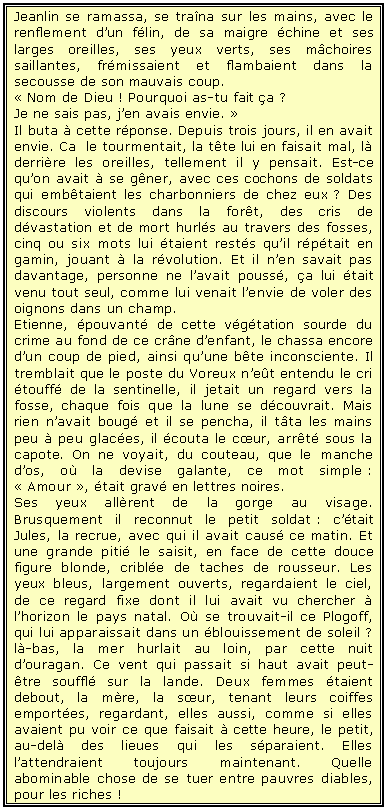
Ce passage se situe à la fin du livre. Nous sommes en pleine grève, l’armée a été réquisitionnée pour permettre aux mineurs belges de descendre. Une sentinelle vient d’être assassinée par Jeanlin, l’enfant infirme. A travers ce passage, nous montrerons que le personnage de Jeanlin illustre la thèse du déterminisme chère au romancier naturaliste. Nous prouverons que cette scène est pathétique. Enfin, ce passage marque une évolution du personnage d’Etienne.
L’emploi métaphorique du verbe « flambaient » souligne l’importance de la violence de Jeanlin. L’enfant a une posture qui le rapproche d’un animal : « Jeanlin se ramassa et se traîna sur les mains ». Jeanlin est traité par Etienne comme un animal : « Etienne le chassa encore d’un coup de pied ainsi qu’une bête inconsciente ». Jeanlin ne parvient pas à justifier la raison de son geste. Par deux fois est répété le fait qu’il en avait envie. Zola emploie le discours indirect libre pour nous faire pénétrer dans la conscience de Jeanlin. Le mauvais style marque l’absence d’éducation. Le passage au discours indirect libre « Est-ce qu’on avait à se gêner avec ses cochons de soldats qui embêtaient les charbonniers chez eux ? » renforce le sentiment de l’inexplicable puisque le lecteur découvre les pensées de Jeanlin ; cela accentue sa monstruosité.
Zola donne une explication plus rationnelle à ce geste : « Des discours violents dans la forêt, des cris de dévastation et de mort hurlés au travers des fosses, cinq ou six mots lui étaient restés qu’il répétait en gamin jouant à la révolution ». Jeanlin a été conditionné par des discours politiques entendus et surtout mal compris. De plus, Jeanlin vit sous terre comme un animal dans un terrier seul. Il ne peut devenir qu’un animal, un marginal. La vie sous terre (obscurité) évoque le côté symbolique de la noirceur de son âme et de ses pensées (comportement).
Jeanlin a une double dégénérescence physique et morale. Sa description physique contient des éléments d’animalité. De plus Jeanlin n’a plus aucun sens moral, il ne connaît plus d’interdit. Il obéit à une pulsion physique qui n’est pas indissociable des discours entendus.
Zola atténue de ce fait sa responsabilité. Il est représentatif de la thèse du déterminisme dans la mesure où il n’est pas entièrement responsable de son crime qui est le résultat d’une double influence, de son hérédité et du milieu social dans lequel il vit (où il a reçu une mauvaise éducation). Il est utilisé comme un argument par Zola pour montrer l’état d’abêtissement dans lequel les mineurs sont maintenus et qui ne peut que compromettre le succès de la grève.
Le couteau du soldat : « on ne voyait du couteau, que le manche d’os, où la devise galante, ce mot simple Amour était gravée en lettres noires ». Il y a une opposition entre la première destination du couteau, l’amour et l’usage qu’en a fait Jeanlin, donner la mort. Cette opposition est renforcée par le contraste visuel entre la couleur blanche du manche en os et les lettres noires.
Puis vient la reconnaissance par Etienne « C’était Jules, la recrue ». Enfin est employée l’expression « le petit » qui est un terme affectif. Le point de vue interne adopté progressivement souligne, amplifie l’émotion. On rentre dans le pathos (passion en grec). Le meurtre d’un innocent prouve que cette scène est pathétique.
Enfin la pitié d’Etienne s’exprime de deux façons. Elle est explicite : « une grande pitié le saisit ».
Elle apparaît également de façon implicite par le discours indirect libre qui révèle les pensées d’Etienne, plus exactement son imagination : « Deux femmes étaient debout, la mère, la sœur, tenant leur coiffes emportées, regardant elles aussi, comme si elles avaient pu voir ce que faisait à cette heure, le petit ». Zola donne une vision stéréotypée à travers les deux femmes qui attendent le retour du petit soldat, le stéréotype est accentué par les toques bretonnes.
Le passage se termine par une sorte d’enseignement moral : « Quelle abominable chose de se tuer entre pauvres diables, pour les riches ! »
Zola dénonce la violence sociale qui est reportée en un déchirement interne au sein d’un groupe d’opprimés. Il stigmatise la fatalité qui pousse les pauvres à reproduire sur eux la violence dont ils sont victimes. La mort d’un innocent annonce l’ambivalence de la fin du livre où les mineurs seront les premières victimes de la grève.
Zola illustre la thèse du déterminisme à travers le personnage de Jeanlin. Cette scène présente une tonalité pathétique qui vise à dénoncer une violence aveugle et mal contenue qui fait des victimes au sein d’un même groupe social. Ce passage marque également la désillusion d’Etienne et préfigure l’échec final de la grève.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









