Germinal : lecture méthodique I
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
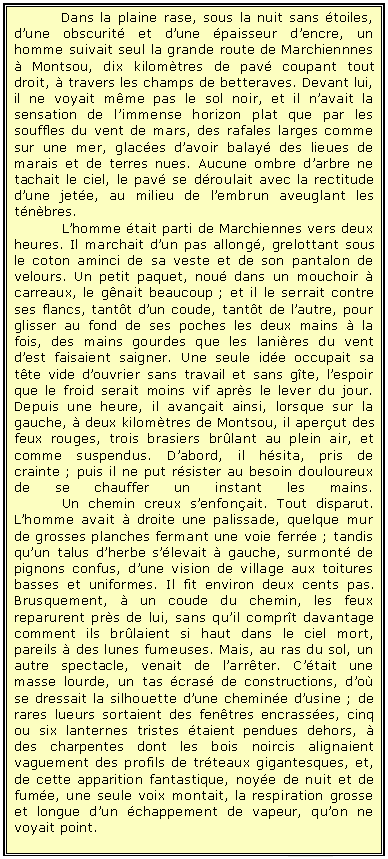
Ce texte est l’incipit (du latin incipio, je commence) du roman. Il doit présenter le cadre spatio-temporel, les personnages principaux et les thèmes du roman. C’est un moment important où se noue le pacte de lecture.
Nous dégageons ici trois axes de lecture. Nous allons prouver que cet extrait comprend un registre pathétique, que la marche d’Etienne est symbolique et qu’il existe une dimension fantastique.
La désolation du paysage est soulignée par la métaphore filée de la mer « le pavé se déroulait avec la rectitude d’une jetée, au milieu de l’embrun ».
• Il y a une insistance sur le froid « larges rafales (...) glacées » avec l’emploi métaphorique de l’expression « les lanières du vent ». L’omniprésence du vent accentue l’aspect lugubre du paysage. Ce sentiment est renforcé par la présence du champ lexical de l’obscurité « la nuit sans étoile d’une épaisseur et d’une obscurité d’encre » ; « il ne voyait même pas le sol noir » ; « aucune ombre » ; « les ténèbres ». Les circonstances climatiques renforcent l’impression d’un milieu hostile.
• De plus, il est seul et comme écrasé par l’immensité qui l’entoure « seul dans cette immensité ». Il erre comme perdu, sans travail et sans gîte.
• L’espace se rétrécit également. La grande route évoquée au paragraphe 1 se transforme au troisième paragraphe en « chemin creux ». Cela évoque également l’impression de perte de liberté du jeune homme. De plus le chemin creux conduit vers la fosse ce qui donne la sensation d’une descente aux enfers.
• Le lecteur adopte donc le point de vue d’un étranger ce qui renforce l’impression d’étrangeté. L’omniprésence de l’obscurité connote une espèce de descente aux enfers du personnage. On note un mélange des conceptions chrétiennes et mythologiques de l’enfer. Le chemin creux « qui s’enfonce » appuie l’impression de descente aux enfers. Il évolue dans les ténèbres et même les lumières qu’il aperçoit ne sont pas chaleureuses. La fosse est donc associée aux enfers où lors de l’accident seront enterrés vivants des milliers de mineurs.
• Le point de vue interne adopté dans le troisième paragraphe renforce l’étrangeté. En effet tout est décrit à travers son regard. Or il ne connaît pas le milieu qu’il découvre et fait partager au lecteur son sentiment de confusion. Il est à noter dans le troisième paragraphe des verbes et des expressions marquant une vision imprécise : « pignons confus, vision de village », « sans qu’il comprit », « vaguement », « apparition », « qu’on ne voyait point ».
• De plus le lieu est éclairé de manière curieuse : « les feux reparurent, près de lui, sans qu’il comprit davantage comment ils brûlaient si haut ». Les feux s’apparentent à des feux follets qui dans les croyances populaires sont des esprits maléfiques. La comparaison « pareils à des lunes fumeuses » renforce le sentiment d’un décor étrange.
• La fosse semble dominer le village par le fait qu’elle vit et que le village a l’air sans vie : « rares lueurs », « cinq ou six lanternes tristes », « noyé de nuit et de fumée ». Le Voreux, nom de la fosse, renvoie au verbe « dévorer », la mine serait donc un Minotaure moderne qui réclamerait sa ration journalière d’hommes. Le personnage paraît en proie à une hallucination, la campagne devient un paysage de cauchemar.
Cet extrait propose une vision triste et pathétique où l’homme pauvre égaré s’oppose à la force démesurée d’un paysage inhumain et effrayant.
Pour ménager l’intérêt du lecteur, Zola crée une impression d’étrangeté par la description lacunaire du personnage, par le choix d’adopter son point de vue pour décrire la fosse. La description fantastique du paysage semble présager du destin d’Etienne, dès son arrivée. Car le rétrécissement progressif et la prédominance de la verticalité suggèrent la perte de liberté. L’aliénation progressive que va subir le personnage marque le dépassement du simple réalisme.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









