Vers un vieillissement de la population française ?
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
C’est le « choc démographique ». Il faut le comprendre, en analyser les causes et en prévoir les conséquences afin de l’accompagner en sachant que les phénomènes démographiques sont lents, avec beaucoup d’inertie et par là ne doivent pas surprendre.
• les jeunes : de 1 à 19 ans,
• les adultes : de 20 à 59 ans .
Ce vieillissement est un phénomène qui touche la plupart des pays industrialisés, le Japon par exemple est particulièrement touché ; les Etats-Unis d’Amérique le sont moins grâce aux populations d’origine africaine ou latino américaine.
Dans les décennies à venir, cette modification de la structure de la population entraînera un certain nombre de problèmes dont on commence à prendre conscience. On appelle « choc démographique » l’ensemble des mutations qui sont attendues.
Parallèlement, la proportion de jeunes (les moins de 20 ans) diminue. Entre 1946, début du baby boom, et 2005, elle est passée de 29,5 % à 25,2 %.
Une proportion de jeunes qui diminue et un pourcentage de personnes âgées qui augmente : on a là les termes du choc qui prendra toute son ampleur à partir de 2030, lorsque les plus de 60 ans dépasseront les 30 %. Ce chiffre est annoncé avec une faible marge d’erreur par les démographes car les évolutions démographiques, lentes, sont assez faciles à prévoir.
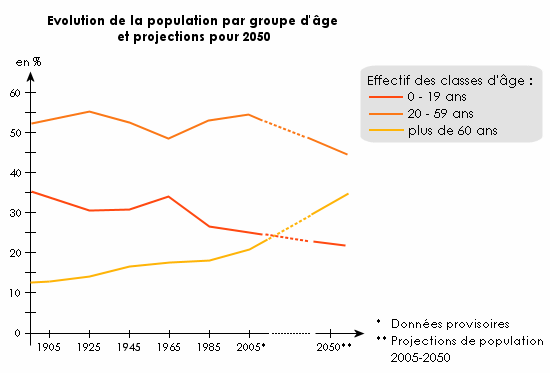
Ainsi, le Nord-Pas-de-Calais compte moins de personnes âgées et plus de jeunes que la moyenne nationale – 18 % de plus de 60 ans et 28,5 % de moins de 20 ans. De même, l’Ile-de-France, région la plus active économiquement, a seulement 16 % de plus de 60 ans et 26 % de moins de 20 ans.
A l’opposé, les régions rurales et le sud de la France ont une proportion de personnes âgées supérieure à la moyenne nationale. Le département de la Creuse comptabilise 35 % de plus de 60 ans et 18 % de moins de 20 ans. Pour la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA), ces chiffres sont respectivement de 28 % et 24 %.
Les départements et territoires d’Outre-mer sont moins touchés par ce phénomène car ils ont des taux de natalité et des indices de fécondité supérieurs à ceux de la métropole. La Guyane, par exemple, compte 43 % de moins de 20 ans. Dans ces TOM et DOM, l’espérance de vie est aussi plus faible.
La Première Guerre mondiale a fauché près d’un million d’hommes jeunes qui n’ont donc pas fondé de foyers et la Seconde Guerre a largement freiné le désir de procréer. Ces deux épisodes dramatiques ont donc renforcé le phénomène de dénatalité. Au lendemain de la Seconde Guerre la natalité reprend, c’est le « baby boom », avec un indice de fécondité (nombre d’enfants par femme en âge de procréer) qui passe à 3 en 1947 (contre 1,8 en 1940).
Aujourd’hui, l'indice de fécondité est retombé à 1,9. Bien que supérieur à celui de nombreux pays européens, un tel chiffre ne permet pas aux générations de se remplacer, 2 décès étant remplacés par 1,9 naissance. En effet, le remplacement des générations est assuré à partir d'un indice de fécondité de 2,1.
Toutefois la population française continue à augmenter : le taux d’accroissement naturel s’établit à 5 ‰ (taux de natalité, 13 ‰, moins taux de mortalité, 8 ‰). C’est parce que les personnes âgées vivent de plus en plus vieilles que la population s’accroît. On parle de « papy boom » avec l’arrivée massive à l’âge de la retraite des enfants du « baby boom » des années 1940-1970.
Ainsi s’explique le paradoxe apparent d’un indice de fécondité qui ne permet pas le remplacement des générations et d’une population qui augmente malgré tout.
L’augmentation de la durée de la vie est liée à plusieurs facteurs, parmi lesquels :
• l’amélioration des conditions d’hygiène,
• une alimentation plus équilibrée,
• la diminution de la pénibilité du travail,
• la hausse du niveau de vie,
• les progrès de la médecine, tant préventive que curative.
Notons ici que l’espérance de vie des femmes est plus importante que celle des hommes, de 6 ans, les personnes âgées sont donc majoritairement des femmes.
Quel sera « le coefficient de charge parentale », c’est-à-dire le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus par rapport à celui des 50 à 64 ans (il donne une indication du soutien que les familles seront amenées à fournir à leurs membres les plus âgés) ?
Quelle sera la place des plus de 60, 65, 70 ans et plus dans cette société en gestation ?
Quels seront les rapports entre les générations ? Conflictuels ou apaisés ?
Trois axes de réflexion se dessinent d’ores et déjà :
- tout d’abord, l’allongement de la durée du
travail rendue nécessaire par
un ratio actifs/inactifs de plus en plus défavorable.
D’ici 2050, le rapport actifs/inactifs de plus de
60 ans passera de 2,2 actifs pour un inactif
(situation de 2005) à 1,4. Dans cette situation, il
deviendra impossible de couvrir comme cela se fait
aujourd’hui les dépenses sociales.
L’Allemagne a déjà anticipé cette
évolution en repoussant l’âge de la retraite
à 67 ans pour certaines catégories
d’actifs et en généralisant la promotion du
travail des seniors. La France échappera difficilement
à de telles mesures qui deviennent possibles avec la
diminution de la pénibilité du travail et le bon
état de santé de la plupart des
sexagénaires.
- la mise en place de toute une gamme
d’emplois nouveaux
autour des services aux personnes
âgées. Il y a là
tout un gisement d’activités qui va se
développer pour accompagner le vieillissement et le
rendre supportable ; il faut que « les gens soient
en situation de vieillir avec sécurité et
dignité et de participer à la
société comme citoyens à part
entière » (Felipe Paolillo - Assemblée
mondiale sur le vieillissement - ONU - Madrid - 2002).
- l’apparition sur le marché de biens et de services spécifiques pour les personnes âgées. La plupart des seniors bénéficient pour l’instant d’un fort pouvoir d’achat grâce aux retraites et au patrimoine acquis pendant la durée de travail. Ils sont donc une cible privilégiée pour les entrepreneurs qui multiplient dés aujourd’hui des produits spécifiques. Sans entrer dans une énumération, pensons aux téléphones à grosses touches ou à reconnaissance vocale pour les mal voyants, aux voyages organisés médicalisés ou encore à la presse spécialisée.
Le vieillissement de la population n’est pas seulement un phénomène français, européen ou occidental ; c’est une mutation démographique qui va toucher toute l’humanité et telle que le monde n’en a jamais connue dans son histoire. Cette mutation est largement amorcée et même si en France les effets en sont encore peu visibles grâce notamment à un indice de fécondité plus élevé que chez nos voisins européens, nous devons nous préparer au gigantesque bouleversement que cela va engendre au point de vue de la consommation, de l’emploi, des relations sociales et des politiques de l’Etat.
Face à ce choc démographique inévitable mais lent car dilué sur au moins deux générations. il convient d’anticiper toutes les mesures voulues qui permettront de l’accompagner.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









