Les indépendances en Asie
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Un obstacle de taille surgit sous la forme de l'hostilité entre hindous et musulmans, les premiers voulant maintenir l'unité indienne, les seconds souhaitant la constitution d'un État musulman. Deux années sont nécessaires pour que les Britanniques parviennent à faire accepter la partition de l'Inde en deux États : l'Union indienne majoritairement hindouiste et le Pakistan musulman (lui-même divisé en deux parties : le Pakistan oriental – futur Bangladesh – et le Pakistan occidental).
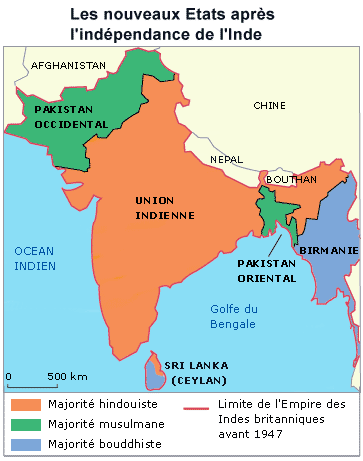
Durant des mois, toute une série de troubles opposent les deux communautés, causant des pertes humaines considérables ainsi que de gigantesques transferts de populations. A la suite de l'Inde, toutes les possessions asiatiques du Royaume-Uni acquièrent leur indépendance.
En métropole, l'opinion publique bascule tandis que l'ONU et les États-Unis font pression sur le gouvernement néerlandais pour le pousser à négocier. Les Pays-Bas sont contraints à la négociation qui aboutit, en décembre 1949, à un accord donnant la pleine souveraineté à un État fédéral indonésien. Dans un premier temps, ils tentent de maintenir une fragile union avec leur ancienne colonie, notamment sur le plan monétaire et financier. Mais, en 1954, les Indonésiens décident de rompre tout lien avec les Pays-Bas.
Le Viêt-Minh détient le Nord du pays, en particulier la région de Hanoi. Dans un premier temps, le général De Gaulle, qui exerce les fonctions de chef du GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française) et qui entend restaurer la souveraineté française en Indochine, décide de privilégier le dialogue. Il confie à Sainteny et Leclerc le soin de négocier un accord avec Ho Chi Minh finalement signé le 6 mars 1946. La France reconnaît le Viêt-nam comme un État libre mais membre de la fédération indochinoise soumise à la souveraineté française.
Le haut-commissaire Thierry d'Argenlieu, tenu à l'écart des négociations, décide de ne pas appliquer l'accord. Des troubles sanglants éclatent le 23 novembre 1946 à Haïphong, durant lesquels le croiseur français Suffren bombarde la ville, faisant 6 000 morts. Le Viêt-minh réplique le 19 décembre à Hanoï, en massacrant 200 Européens. C'est la faillite de la solution négociée et le début de la guerre d'Indochine.
Mais, en mai 1954, la défaite de Diên Biên Phu montre les limites de l'effort français, d'autant que les États-Unis penchent en faveur d'une solution négociée : la mort de Staline et la fin de la guerre de Corée annoncent une période d'apaisement des relations internationales. En juillet 1954, les accords de Genève sont signés : le Laos et le Cambodge accèdent à l'indépendance. Le Vietnam est divisé par une ligne d'armistice fixée au 17e parallèle, avec le Nord contrôlé par le Viêt-minh et le Sud par les nationalistes non communistes. Des élections générales sont prévues deux ans plus tard, en vue d'une unification du pays. Mais la situation dégénère en un nouveau conflit, la guerre du Vietnam.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









