Le Second Empire : la mise en place d'un nouveau régime
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
- Comprendre la fin de la Deuxième République (1848–1852) et la mise en place du Second Empire (1852–1870).
- Entre les traditions monarchique et républicaine, la France connaît au XIXe siècle un troisième régime politique original, qui tente la synthèse entre l'autorité, l'ordre et les principes révolutionnaires.
- Né d'un coup d'État en 1851, ce régime plébiscitaire essaie de trouver une légitimité dans la tradition bonapartiste et dans le lien direct entre l'empereur Napoléon III et le peuple français.
Le jour anniversaire de la Bataille d'Austerlitz et du couronnement de Napoléon Ier, son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, réalise un coup d'État. Il souhaite, en effet, conserver un pouvoir obtenu en 1848 lors des élections présidentielles, mais la constitution ne lui donne pas le droit de se présenter pour un deuxième mandat.
En juillet 1851, le refus de l'Assemblée de changer pour lui le texte constitutionnel le pousse à utiliser la manière forte.
S'appuyant sur l'armée, il décrète un couvre-feu, fait arrêter les principaux opposants et dissout l'Assemblée nationale.
Or, ce coup de force ne donne à Bonaparte qu'un pouvoir limité qui peut à tout moment être contesté, car il n'est pas légitime (c'est-à-dire légal et accepté par la population).
Le président de la République renoue donc le contact avec le peuple en se présentant comme le défenseur des intérêts de celui-ci : dès le 2 décembre 1851, il annonce la restauration du suffrage universel mis à mal par la loi de mai 1850.
Puis, le 20 décembre 1851, il consulte la population par un plébiscite, une question simple soumise aux électeurs et dans laquelle Louis Napoléon place toute son autorité et son prestige.
Le vote massif en sa faveur (7,4 millions de « Oui » contre 650 000 « Non ») permet à Bonaparte de s'octroyer tous les pouvoirs et un titre de prince-président pour 10 ans par la Constitution du 14 janvier 1852.
Le titre d'empereur lui est accordé en novembre 1852 par un second vote massif en sa faveur (7,8 millions de « Oui » contre 250 000 « Non »). Le Second Empire (1852-1870), régime autoritaire et héréditaire est proclamé le 2 décembre 1852.
La Constitution de janvier 1852 donne l'essentiel des pouvoirs au chef de l'État (prince-président puis empereur). Il exerce seul le pouvoir exécutif, nomme les personnels à tous les emplois civils et militaires (Sénat, préfets, etc.), surveille l'élection des maires qui est pourtant théoriquement libre. Il propose les lois et les promulgue (pouvoir législatif).
Le Corps législatif (l'Assemblée), élu au suffrage universel, vote les lois, mais ne peut rien imposer au chef de l'État. De plus, des candidats officiels sont désignés à chaque élection et favorisés par le régime, alors que les opposants sont brimés. Les préfets, relais du pouvoir central dans les départements, surveillent les électeurs. Les membres des deux autres chambres, Sénat et Conseil d'État sont désignés directement par Napoléon III, et le pouvoir législatif est divisé.
Pour Napoléon III, les pouvoirs intermédiaires (assemblées, maires, élus de toute sorte) n'ont ni d'importance ni de légitimité réelle. Ce qui compte, c'est le lien direct qu'il entretient avec le peuple lors des plébiscites ou des élections législatives lors desquelles l'emportent toujours ses candidats, et qui légitime son pouvoir. Il s'agit de réduire la démocratie à ce lien qui laisse les mains libres à l'empereur et entretient l'image d'un dirigeant soucieux des intérêts de la population.
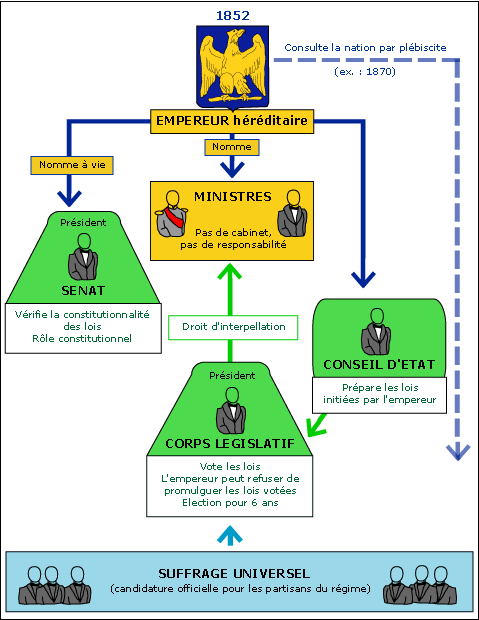
Jusqu'en 1860, l'Empire est autoritaire, attitude symbolisée par les principaux ministres de Napoléon III, le duc de Morny et Eugène Rouher. Favorable au développement économique et à la paix sociale, refusant les aventures militaires, défendant les valeurs morales traditionnelles et la religion, l'empereur est soutenu par la France conservatrice et catholique et par les milieux d'affaires.
Or, cet assentiment d'une majorité de la population ne doit pas masquer le contrôle étroit que le régime fait peser sur les sujets de l'empereur et sur les opposants qui continuent de revendiquer le retour à la République.
La société est étroitement surveillée. L'administration est épurée, on pourchasse les opposants républicains (Victor Hugo est en exil à Guernesey, 30 000 opposants sont arrêtés et 10 000 déportés en Algérie et en Guyane) et on empêche les débats d'idées (presse surveillée, censure des livres, des spectacles, etc.).
La population est contrôlée par l'administration impériale et par l'armée qui reste fidèle au chef de l'État.
Mais à partir de 1859, la majorité des Français n'accepte plus ce régime autoritaire et Napoléon III doit accepter de démocratiser le régime. Les opposants au régime profitent de cette libéralisation de la vie politique. Peu à peu, ils constituent un groupe de plus en plus influent au Corps législatif qui voit son rôle s'accroître à partir de 1860.
Thiers, dans l'opposition, réclame en 1864 les « libertés nécessaires » (liberté de pensée, des élections, du Corps législatif).

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









