Le budget de l'État- Première- SES
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
- Connaitre les recettes et les dépenses de l'État.
- Le budget de l'État repose sur des contributions publiques, aujourd'hui essentiellement indirectes : la TVA représente la première rentrée fiscale de l'État. Les impôts sont proportionnels ou progressifs, ces derniers étant réputés les plus équitables.
- Avec ce budget, l'État dispose de moyens d'action, en termes de fonctionnement ou d'investissement. Lors de la préparation de la loi de finance, chaque ministère se voit allouer un certain budget, qui traduit les orientations gouvernementales.
Les recettes de l'État représentent, en 2006, un peu moins de 300 milliards d'euros. Ces recettes proviennent essentiellement des contributions publiques des particuliers et des entreprises. Les impôts sont donc collectés sur l'ensemble des activités économiques, c'est-à-dire sur le revenu, le patrimoine, la consommation et la production.
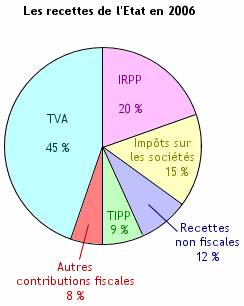
La structure des recettes de l'État repose
principalement sur la TVA (taxe sur la valeur
ajoutée) et l'impôt sur le revenu des
personnes physiques (IRPP). On s'aperçoit
par ailleurs que la part prise par les taxes
(TVA et taxe intérieure sur les produits
pétroliers, TIPP) est de plus en plus importante
depuis les années 1980 et avoisine aujourd'hui
les 50%.
Les recettes fiscales sont insuffisantes au regard
des dépenses publiques : l'État
doit donc emprunter pour financer son déficit.
La recherche d'un impôt juste reste une
gageure, une catégorie de contribuables
étant toujours défavorisée par
rapport aux autres, quel que soit le mode de calcul de
l'impôt. Cependant, les contributions indirectes
payées de manière proportionnelle comme
la TVA ou la taxe sur les produits pétroliers
pénalisent toujours plus fortement les
contribuables les plus modestes : ils paient alors
le même montant par unité de consommation
que les catégories aisées.
Au contraire, un impôt progressif,
c'est-à-dire assujettissant plus fortement
les riches, semble plus équitable. C'est le
cas de l'impôt sur le revenu en France,
qui fonctionne par tranche de revenus :
à chaque tranche est associé un
pourcentage d'impôt progressivement de plus en
plus élevé. Les faibles revenus ne le
paient donc pas, alors que les plus riches sont
taxés au maximum à un taux moyen de 40%.
C'est pourtant l'impôt qui cristallise les
critiques et que l'on a tendance à
réduire.
Au sens large, les dépenses publiques regroupent
les dépenses des administrations publiques
d'État, des administrations locales, et de la
Sécurité sociale.
Il faudrait aussi y ajouter celles des entreprises
publiques et des institutions européennes.
Cependant, les collectivités locales
possèdent des budgets autonomes avec une
fiscalité spécifique, alors que la
Sécurité sociale dispose, de son
côté, de ressources propres
assises sur les cotisations sociales.
Si l'on ne prend en compte que les seules dépenses des administrations publiques, la répartition par grands postes fonctionnels serait la suivante, par ordre d'importance :
- les frais de personnel ;
- les frais d'investissement ;
- le service de la dette ;
- le fonctionnement et l'équipement des administrations.
Les ministères disposent chacun d'une enveloppe annuelle, selon leur importance.
Depuis le début des années 1990,
certains ministères voient leur budget
augmenter. De la sorte, les budgets de
l'Éducation et de la Recherche, de l'Emploi et
de la Solidarité, de la Justice, de
l'Environnement, ou de l'Intérieur ont connu des
progressions importantes pour répondre aux
nouvelles attentes de la société.
L'augmentation des dépenses publiques a
été plus rapide en France que dans
d'autres pays européens.
Les dépenses au sens large représentent
désormais environ la moitié du PIB
national (produit intérieur brut). Ce
rapport donne cependant une vision
déformée de la réalité,
puisque la part de l'État central est bien
inférieure. L'augmentation est essentiellement
due à des dépenses de
Sécurité sociale de plus en plus
importantes. En outre, les dépenses publiques
sont désormais strictement encadrées par
le pacte de stabilité européen.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !








