La socialisation vue comme un processus d'interaction sociale- Première- SES
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
- Comprendre le rôle de l'individu dans sa socialisation.
- Certains sociologues pensent que les individus ne sont pas passifs dans le processus de socialisation mais participent activement, dès leur plus jeune âge, à la construction de leur personnalité.
- Les individus sont rationnels et développent des stratégies d’adaptation comme c’est le cas par exemple à l’école. Cela explique donc que la socialisation des individus, même influencée par des forces sociales, peut être assez différente.
La question qu’il convient de se poser ici est de savoir de quelle manière l’individu contribue à sa socialisation.
La socialisation, pour les sociologues
individualistes, ne se résume pas seulement
à l’apprentissage passif de normes et
de valeurs conditionnées par la
société, le milieu social ou le sexe.
Les individus sont rationnels
(c'est-à-dire que leurs actions ont un sens, ils
ont une « bonne raison »
d’agir ainsi) et vont donc développer des
stratégies pour s’adapter
à des situations données.
Bien sûr, la société produit des
contraintes mais les individus ne sont
pas passifs devant elles ;
ils les intègrent
et réinterprètent les
normes et les valeurs en fonction des différents
messages reçus.
Les instances de socialisation sont nombreuses, les
messages transmis peuvent être
complémentaires mais aussi de temps en temps
dissonants. C’est à l’individu de se
forger sa personnalité en
sélectionnant ces messages et en les adaptant au
contexte.
Par exemple, dans l’institution scolaire, les
messages véhiculés sont clairs :
il faut travailler, faire des efforts pour
réussir... Mais chez certains
élèves, ces comportements sont
stigmatisés par le groupe et il ne
faut pas « collaborer ». Certains
élèves tentent donc de concilier ces deux
attentes différentes : travailler sans trop
que les autres le remarque.
Dans cette perspective, l’individu est
donc très actif dans la construction de
sa personnalité.
Les enfants sont eux aussi
particulièrement actifs car les relations
qu’ils créent avec les autres, leur
permettent de participer à leur socialisation,
au travers de 3 comportements majeurs :
- l’imitation : l’enfant imite les adultes ou les autres enfants en transformant les rôles à sa manière ;
- l’intériorisation : l’enfant intègre petit à petit les règles ; il apprend à connaître les réactions des autres ;
- l’expérimentation : par une succession d’actes (en conformité ou en désaccord avec les normes), l’enfant teste son environnement ; il apprend ainsi ce qu’il peut faire ou non, quelles sont les limites en fonction des « autres ».
Les interactionnistes vont plus loin encore dans cette
analyse. Pour eux, la vie sociale est comme une
pièce de théâtre où chacun a
des rôles à jouer.
Les rôles sont les modèles de
conduite qui correspondent à des
comportements attendus par le reste de la
société. Un individu a donc
plusieurs rôles à jouer, par exemple celui
de salarié, de père,
de mari… Il aura
des comportements différents
à chaque fois.
Pour les interactionnistes, les individus sont
assez libres dans l’interprétation de
leurs rôles. Ainsi,
la société se construit
grâce aux relations qui se créent entre
les individus.
Par exemples, deux enfants éduqués dans
la même famille, de la même manière
pourront avoir deux personnalités
différentes, les mêmes façons
d’agir ou de penser.
Raymond Boudon explique, dans
L’Inégalité des chances
(1973), que les différences de
réussite scolaire s’expliquent non pas par
des forces qui font que des classes sociales sont
dominées (comme le dit
P. Bourdieu) mais par les
stratégies rationnelles des
familles. Ainsi, chaque famille désire que ses
enfants aient une meilleure position sociale (ou au
moins une position équivalente).
Un fils d’ouvrier qui devient professeur fera
donc la fierté de ses parents qui y verront une
ascension sociale. En revanche, ce ne sera pas le cas
pour une famille de cadres supérieurs. Ainsi,
les ambitions seront
différentes pour les familles qui
pousseront les enfants à faire des études
plus ou moins longues, les enfants des classes
populaires privilégiant les études plus
courtes (IUT, BTS par exemple).
Les enfants de professeurs sont ceux qui
réussissent le mieux car leurs parents
connaissent bien le système scolaire
(filières, options…) ce qui leur permet
de définir des stratégies optimales de
réussite. Ainsi, ce sont bien les relations
entre l’individu et son environnement qui
expliquent la réussite scolaire.
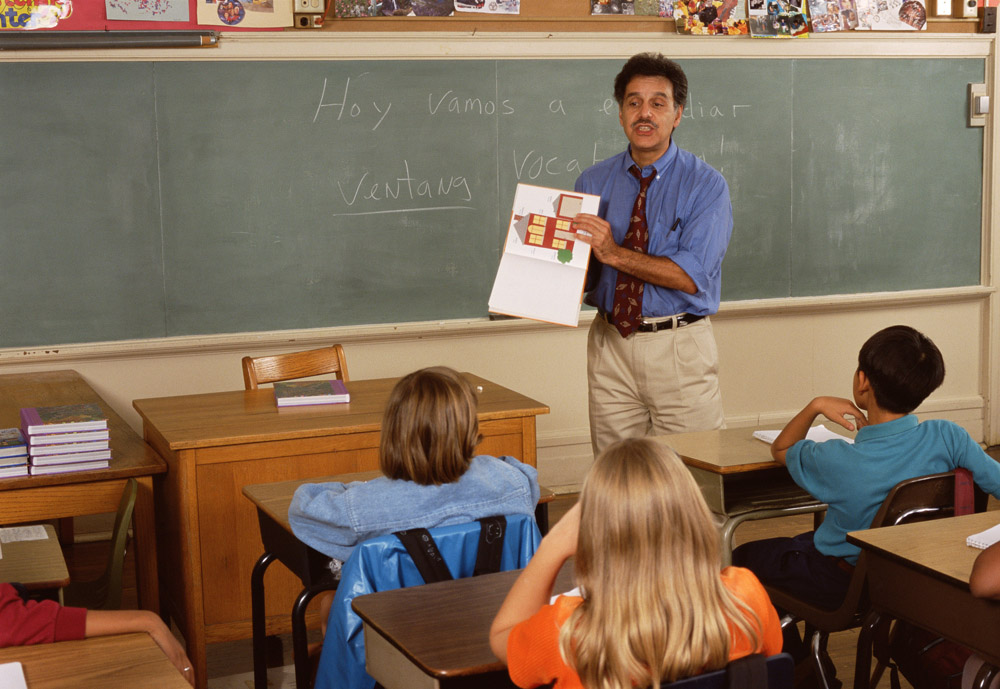
|
| Doc 1 : Les stratégies scolaires familiales influencent la réussite des enfants |
Les interactionnistes expliquent la réussite scolaire de manière différenciée. Chaque situation est particulière et dépend de nombreux phénomènes. Le point commun est que cela dépend des relations nouées entre les individus.
- Effet classe : un groupe d’élèves peut tirer le niveau vers le haut ou le bas selon le comportement de certains « leaders ». Il y a des classes qui « fonctionnent » mal et peuvent expliquer une baisse générale des résultats.
- Effet établissement : certains établissements ayant une mauvaise réputation (gestion des absences laxiste, comportements violents, mauvais résultats aux examens…) n’attireront pas les meilleurs élèves et cela favorisera certains comportements déviants.
- Effet professeur : certaines classes peuvent ne pas fonctionner correctement car les relations professeur-élèves ne sont pas bonnes. Aujourd’hui, beaucoup d’élèves sont plus motivés pour travailler quand ils nouent une relation de confiance avec leurs professeurs.
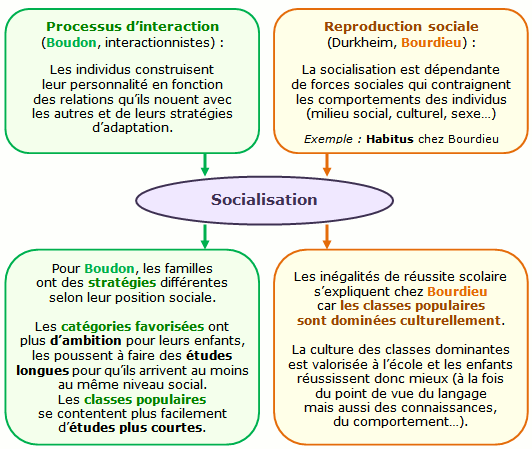

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !








