La seigneurie au Moyen Âge
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Quels étaient donc les liens entre ces seigneurs et ces paysans ?
- la réserve, la partie que le seigneur réservait à son usage propre et dont les revenus lui revenaient exclusivement ;
- la tenure, la partie qu'il accordait en location à des paysans (appelés tenanciers ou vilains).
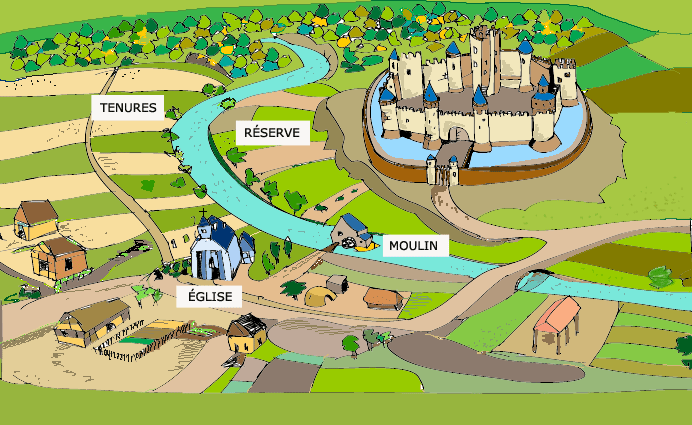
|
| Doc. 1. Représentation d'une seigneurie, composée d'un château et de ses terres |
|
« À la Saint-Jean (24 juin),
les paysans de Verson doivent faucher l'herbe
des prés du seigneur et porter le foin
au manoir. Après, ils doivent curer le
canal. En août, ils doivent moissonner
les blés du seigneur et les porter
à sa grange. Ils doivent le champart sur
leurs terres. Ils le chargent sur leurs
charrettes et le portent à la grange du
seigneur. Après, vient le début
septembre, où ils paient le
porçage : le vilain gardera deux
pourceaux sur trois. Et après vient la
Saint-Denis (9 octobre), où les vilains
sont tout étonnés qu'il leur
faille payer le cens. Après, ils doivent
encore la corvée : quand ils auront
labouré la terre du seigneur, ils iront
chercher le blé à son grenier et
ils devront le semer. À Noël, ils
doivent des poules. À Pâques, ils
doivent de nouveau la
corvée ».
(D'après la Complainte des Vilains de
Verson, 13e siècle).
|
Les paysans n'avaient pas le choix : toutes les terres appartenant à un seigneur, ils étaient bien obligés de vivre quelque part et de gagner leur vie en faisant ce qu'ils savaient faire : travailler la terre. Une terre qui ne leur appartenait pas et qu'ils n'étaient pas capables de protéger des attaques extérieures (soit venant d'une autre seigneurie, soit d'envahisseurs). Ils louaient donc une portion du territoire seigneurial pour avoir le droit de la cultiver et d'être protégés.
À cette époque, la société était divisée entre :
- ceux qui priaient, les clercs ;
- ceux qui combattaient, les nobles ;
-
ceux qui travaillaient.
En échange, les paysans devaient fournir des corvées (travaux non rémunérés et obligatoires qu'il s'agisse de travaux agricoles ou de l'entretien des bâtiments, des routes, des ponts, etc.) sur la réserve et payer des impôts à leurs seigneurs. Les taxes habituelles versées par les paysans étaient généralement le cens (payé en argent) et le champart (une partie de la récolte). Par exemple, le paysan de Verson devait donner un tiers des animaux qu'il élevait à son seigneur.
De plus, chaque seigneur avait un monopole sur l'utilisation d'équipements tels que le four à pain, le moulin à farine et le pressoir (à olive ou à raisin), ce qui signifiait que les paysans n'avaient pas le droit d'en posséder et qu'ils étaient obligés d'utiliser ceux fournis par le seigneur en échange de taxes appelées banalités.

|
| Doc. 2. Seigneurs contrôlant le travail des paysans sur leurs terres. |
De plus, à chaque seigneurie étaient attachés un certain nombre de descendants d'esclaves, les serfs qui n'avaient pas d'identité juridique et étaient la propriété privée du seigneur. Ils pouvaient être vendus et ne pouvaient rien faire sans l'accord de leur maître. Par exemple, s'ils voulaient se marier hors de la seigneurie, ils devaient verser une taxe, appelée le formariage.
Les paysans fournissaient donc une main d'œuvre gratuite en échange de quoi, le seigneur s'engageait à assurer leur protection et celle de leurs familles. En cas de danger, ils pouvaient se réfugier dans la cour du château-fort ou derrière les murs de l'abbaye. En cas de mauvaise récolte, et malgré la faim, les redevances aux seigneurs ne diminuaient pas forcément. Tout dépendait du bon vouloir et de la bienveillance du seigneur.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









