La crise de 1929
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Le 24 octobre 1929, « jeudi noir » et les jours suivants, les actions à Wall Street (la bourse de New York) s’effondrent ; des centaines de milliers d’actionnaires sont ruinés, les entreprises voient fondre leurs capitaux ; les banques font faillite.
Cette crise est un événement historique considérable. Elle va en effet entraîner tous les pays industriels dans une période de dépression durant plus de dix ans bouleversant souvent les structures économiques et sociales, favorisant la montée des régimes autoritaires et débouchant sur la seconde guerre mondiale.
Surtout, un véritable boom spéculatif s’était emparé de la population américaine (6 % en moyenne détenaient des actions en 1929). L’augmentation considérable des cours (quadruplés entre 1925 et 1939) attirait les boursicoteurs, des plus importants aux plus modestes.
Les actions étaient achetées souvent à crédit (4/5e des actions en 1929) et on espérait rembourser les prêts par les plus-values obtenues en vendant les titres, une fois que leur cours aurait augmenté.
Les entreprises engageaient aussi imprudemment en bourse leurs capitaux de réserve.
Les banques prêtaient à tous très facilement. La hausse appelant la hausse, le crédit soutenant la montée des cours, la Bourse américaine se mit rapidement à tourner à vide en 1928, en se déconnectant de toute réalité économique.
Des entreprises ayant investi en Bourse font faillite (23 000 en 1929 ; 30 000 en 1932).
Signe de ces difficultés, la production industrielle chute de 50 % entre octobre 1929 et août 1932.
Les agriculteurs sont touchés aussi. Confrontés à une baisse drastique des prix agricoles (57 % environ entre juin 1929 et décembre 1932) ils doivent contracter de nouveaux emprunts pour rembourser les anciens ; parfois les banques saisissent les terres de ceux qui ne peuvent plus payer les poussant à l’émigration vers l’Ouest, vu comme un eldorado (Cf. Steinbeck, Les raisins de la colère).
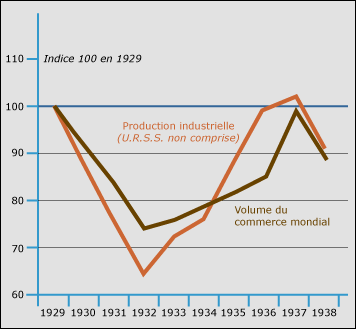
La baisse soudaine des importations américains met aussi en difficulté leurs fournisseurs de matière premières (souvent les pays « neufs » comme le Canada ou le Brésil ; le café brésilien par exemple perd les 2/3 de sa valeur et se retrouve tout juste bon à être utilisé comme combustible dans les locomotives).
Les conséquences sociales sont dramatiques : chômage, misère sont le lot de beaucoup de pays.
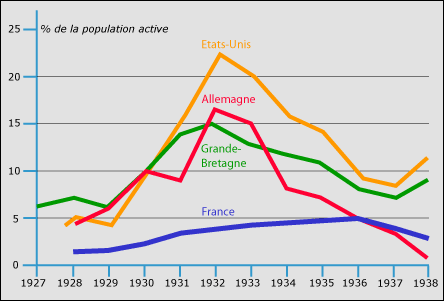
En 1935, 1/5e de la population britannique ne mange pas à sa faim ; un actif sur deux est au chômage en Allemagne en 1933 ! Cette situation sociale explosive constitue un terreau favorable pour des partis extrêmes ; le parti nazi obtient une bonne part de ses suffrages en 1933 parce qu’il promet « du pain et du travail » (Arbeit und Brot) aux chômeurs.
- la dévaluation de la monnaie, comme en Grande-Bretagne (où la livre sterling est dévaluée de 40 % en 1931) et dans la plupart des pays, ce qui permet de stimuler les exportations (les produits du pays coûtant moins cher).
- la déflation (réduction des salaires et des dépenses pour assainir l’économie) essayée en France par exemple en 1935 mais sans grand succès. Cette politique économique a même eu un effet pervers puisqu’en réduisant la consommation, elle a aggravé les effets de la crise.
Des économistes proposent aussi leurs solutions face à cette situation qui n’arrive pas, contrairement à ce que pensent les libéraux, à se résoudre d’elle-même. Keynes, un anglais, suggère ainsi de relancer l’économie par la consommation ; par une politique de grands travaux et d’aides sociales, l’état donne du travail et de l’argent, lequel est réinvesti dans l’achat de produits industriels, ce qui relance les industries et donc l’économie du pays.
Cette politique est initiée par le président Franklin Delano Roosevelt élu en 1932 ; c’est le New Deal (« nouvelle donne »). On construit ainsi des barrages (le barrage Hoover), des routes, des ponts (en 1933-34, 60 % du budget fédéral est consacré à ce type de dépenses); des aides financières sont distribuées aux entreprises et aux particuliers. L’économie américaine repart ainsi à la fin des années 30.
D’un point de vue général, tous les Etats rompent avec l’idéologie libérale et interviennent dans l’économie (règlementations, prix minimum, protectionnisme). Le maximum est atteint par les régimes fascistes qui prônent l’autarcie. La politique d’armement en vue de la seconde guerre mondiale sera pour certains (l’Allemagne notamment) un moyen de résoudre le chômage et de relancer la machine économique.
La crise de 1929 prend son origine dans un krach boursier à New York le 24 octobre à cause d’une spéculation trop forte.
Elle entraîne la ruine de centaines de milliers d’actionnaires américains et des faillites de banques et d’entreprises. Les banques américaines en rapatriant leurs capitaux placés à l’étranger vont propager cette crise. Le commerce mondial se rétracte fortement.
Partout, les conséquences sociales sont dramatiques : chômage, misère, mouvements migratoires. Ce contexte social favorise la montée de mouvements extrémistes.
Les états essayent de redresser leurs économies par la dévaluation et/ou la déflation. Keynes propose une relance de la consommation appliquée par Roosevelt aux Etats-Unis. La guerre (et sa préparation) sera pour certains pays la solution à ces difficultés économiques et sociales.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









