L'évolution des différentes formes d'emploi
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Depuis les années 80, on voit apparaître et se
développer des formes particulières d’emploi
notamment précaire, quel est le bilan aujourd’hui
?
Il y a les emplois à temps partiel mais aussi les formes précaires d’emploi, c'est-à-dire des emplois instables. On trouve notamment :
• le CDD (contrat à durée déterminée) : l’embauche se fait pour une période définie à l’avance, de 1 mois à 18 mois renouvelable une fois ;
• le travail intérimaire : les contrats sont de très courte durée, le salarié travaille pour une agence d’intérim qui lui fournit des « missions » dans des entreprises qui ont besoin ;
• les stages, l’apprentissage ;
• les contrats aidés : financés en partie et pendant un certain temps par la collectivité.
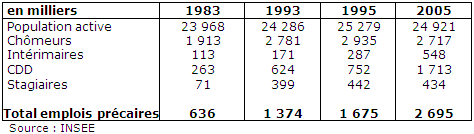
Comme on peut le voir ici, le nombre de contrats précaires a fortement augmenté depuis les années 80 notamment les CDD et l’intérim. De nouvelles formes de contrats apparaissent aussi, par exemple, le CNE (Contrat nouvelle embauche) réservé aux entreprises de moins de 20 salariés et qui prévoit une période d’essai de 2 ans (1 à 3 mois pour les CDI normalement). Mais le CNE est amené à être modifié ou supprimé.
L’emploi à temps partiel reste stable mais il est souvent réservé aux femmes qui ne demandent pas toujours à en bénéficier, 40 % environ des salariés à temps partiel aimeraient travailler plus.
La précarité n’est pas la norme cela reste le CDI mais la plupart des contrats pour les jeunes aujourd’hui sont d’abord des contrats précaires.
De plus, ces contrats permettent de remplacer la main-d’œuvre manquante, ces salariés sont aussi plus « dociles » car ils espèrent toujours se faire embaucher définitivement.
Enfin, pour les jeunes, ces contrats sont souvent utilisés pour les tester en dehors des périodes d’essais jugées trop courtes par les employeurs. Un contrat spécifique devait être crée pour les moins de 25 ans, le CPE (Contrat première embauche) qui prévoyait 2 ans de période d’essai sur le modèle du CNE. Mais devant l’hostilité des jeunes, ce projet a été supprimé.
Pour les salariés, les conséquences sont plus négatives, ces emplois précaires sont mal payés, instables donc ces salariés fréquentent régulièrement l’agence pour l’emploi car ils se retrouvent régulièrement au chômage. De plus, des revenus irréguliers ne permettent pas de vivre correctement, il y a des difficultés pour trouver un logement, faire un crédit ou des projets à long terme. Ces salariés sont mal intégrés dans l’entreprise, ont du mal à défendre leurs droits car ils veulent être embauchés définitivement.
Il existe malgré tout des effets positifs : ces emplois donnent une chance aux populations les plus fragiles (jeunes, immigrés, handicapés, peu qualifiés…) de trouver un emploi, d’avoir une chance de décrocher un emploi stable en faisant ses preuves.
Le marché du travail devient dual (le dualisme) ou segmenté, il y a deux parties entre le marché des emplois stables et celui des emplois précaires. Le problème est qu’il est de plus en plus difficile de passer du marché des emplois précaires au marché des emplois stables.
Les emplois précaires ont tendance à augmenter depuis les années 80, notamment les CDD et le travail intérimaire. L’emploi stable, le CDI reste la norme mais les nouveaux contrats signés par les jeunes sont essentiellement des emplois précaires notamment dans le but de tester la main d’œuvre en dehors des périodes d’essai légales. Ces emplois ont profité aux entreprises, leur permettant de faire baisser le coût de la main d’œuvre pour faire face à la concurrence mondiale.
Le bilan est plus négatif pour les salariés qui ont des emplois et donc des revenus instables et se retrouvent régulièrement sans emploi. Le marché du travail devient donc de plus en plus dual ou segmenté.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !








