L'émigration irlandaise au 19e siècle
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Jusqu'au début du 19e siècle l'émigration à l'échelle européenne domine, mais les progrès réalisés dans le domaine des transports rendent l'émigration vers le continent américain plus massive. La navigation à vapeur permet, dans la deuxième moitié du 19e siècle, de réduire la durée du voyage transatlantique: trois semaines suffisent, contre environ douze à bord d'un voilier.
Entre 1815 et 1845, plus de 500 000 Irlandais partent vers l'Angleterre travailler. Mais c'est surtout la Grande famine que subit l'Irlande entre 1845 et 1849 qui poussent les populations au départ. A l'origine de celle-ci, des méthodes agricoles inappropriées et le développement du mildiou sur l'île, un champignon qui anéantit les cultures locales de pommes de terre, aliments de base des paysans irlandais.
A partir de 1846, trois années successives de récoltes catastrophiques provoquent la famine, aggravée par des épidémies de choléra. La famine dure jusqu'en 1851 touchant particulièrement les populations de l'ouest du pays.
Paradoxalement, alors que la production chute de près de moitié, le pays continue à exporter vers la Grande-Bretagne sous la pression des négociants protestants. Le gouvernement britannique profite également de la situation pour expulser les paysans incapables de payer l'impôt sur leurs terres. Le bilan de cet évènement dramatique est lourd puisqu'il provoque la mort de de 500 000 à un million de personnes et force à l'émigration plus de deux millions d'Irlandais.
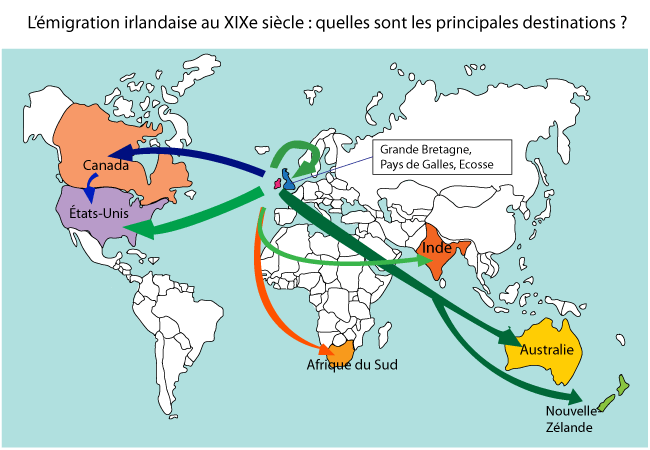
Séduits par l'American Dream, le rêve d'une vie meilleure et d'un nouveau départ possibles ou attirés par la ruée vers l'or, les EU attirent entre 70 et 75% des émigrants irlandais sur la période. Ils s'installent en particulier dans les grandes villes du nord-est atlantique : Boston, Chicago et surtout New-York qui est le principal port d'arrivée.
Depuis 1892 les nouveaux venus débarquent sur Ellis Island, petite île au sud-ouest de Manhattan. L'intégration dans ces villes est difficile. Les Irlandais y constituent un sous-prolétariat employé dans les tâches les plus pénibles et les moins rémunérées : emplois dans les mines, la construction de canaux, de lignes de chemins de fer ou dans les emplois urbains types comme livreurs, allumeurs de réverbères...
Les faibles salaires obligent les populations à se concentrer dans des quartiers populaires aux immeubles sordides où l'on loue une pièce pour loger la famille : ce sont les tenements. La difficile intégration est aussi liée à la langue, qui reste le gaélique et au mode de vie urbain qui n'est pas familier. Enfin, cette population reste fortement attachée au catholicisme.
En conséquence, se constituent parfois dans ces grandes villes des gangs ou bandes violentes qui se heurtent aux autres nationalités ou aux Américains d'origine.
A la fin du 19e siècle, la situation s'améliore. Le poids démographique permet à ces Irlandais, par la constitution de syndicats, de partis politiques, de faire pression sur les autorités municipales. Ils cherchent à s'emparer de charges électives, ce qui suscite parfois le ressentiment des Américains d'origine qui vivent mal cette ascension. Ainsi se développe le nativisme, mouvement qui s'oppose aux Irlandais catholiques et demande à ce que la naturalisation soit accordée aux immigrés après 21 ans de séjour aux Etats-Unis, au lieu des 5 ans prévus par la loi.
Malgré cette xénophobie, l'ascension sociale des Irlandais est réelle et au début du 20e siècle moins de 20 % de ceux-ci occupent dans le pays un emploi non-qualifié.
Les autres pays du Commonwealth, territoires unis à la couronne britannique, sont aussi privilégiés. Cette émigration a toujours été encouragée par le gouvernement britannique qui voyait ainsi la possibilité de peupler les colonies. L 'Australie est d'abord une colonie pénitentiaire (100 000 personnes déportées en un demi-siècle) puis attire les colons, à partir de 1851, pour ses mines d'or. Dans une moindre mesure, l'émigration se développe aussi vers la Nouvelle-Zélande, l'Inde ou l'Afrique du Sud.
Se constitue ainsi, à l'échelle mondiale, une diaspora irlandaise, c'est-à-dire une communauté installée à l'étranger, exportant ses coutumes et permettant de faire vivre les membres de la famille restée sur place grâce à l'argent envoyé.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









