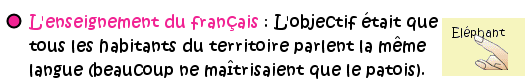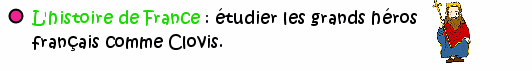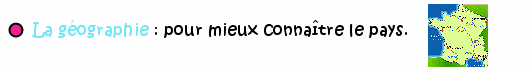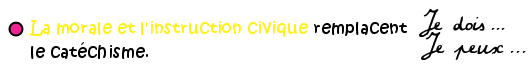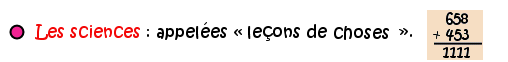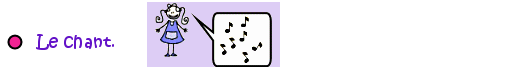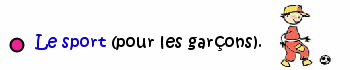L'école de la IIIe République
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts

 L'école, qui
est payante, est un privilège
réservé aux plus riches. Cette situation va
changer après la défaite contre la Prusse
et le début de la IIIe
République.
L'école, qui
est payante, est un privilège
réservé aux plus riches. Cette situation va
changer après la défaite contre la Prusse
et le début de la IIIe
République.
 Au XIXe
siècle, la France est encore un pays
majoritairement rural. Les
enfants commencent à travailler très
tôt (parfois 5 ans) et leurs parents n'ont pas les
moyens de les envoyer à l'école.
Au XIXe
siècle, la France est encore un pays
majoritairement rural. Les
enfants commencent à travailler très
tôt (parfois 5 ans) et leurs parents n'ont pas les
moyens de les envoyer à l'école.
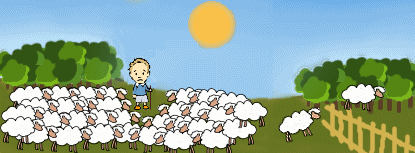
 Beaucoup ne savaient
ni lire, ni écrire. Seuls les
enfants des familles aisées (les plus riches)
avaient la chance d'être instruits. Ils allaient
à l'école qui était
payante et souvent tenue par des
religieux.
Beaucoup ne savaient
ni lire, ni écrire. Seuls les
enfants des familles aisées (les plus riches)
avaient la chance d'être instruits. Ils allaient
à l'école qui était
payante et souvent tenue par des
religieux.
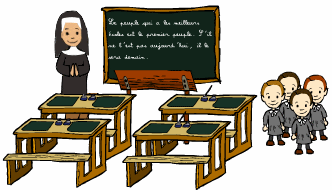
 En 1870,
après la défaite contre les
Prussiens, les nouveaux
dirigeants décident de changer le
système éducatif. L'objectif
était d'instruire la population
pour que la France puisse garder son statut de «
grand pays ». Certains considéraient
notamment que le manque d'instruction des soldats
français avait entraîné la
défaite contre la Prusse.
En 1870,
après la défaite contre les
Prussiens, les nouveaux
dirigeants décident de changer le
système éducatif. L'objectif
était d'instruire la population
pour que la France puisse garder son statut de «
grand pays ». Certains considéraient
notamment que le manque d'instruction des soldats
français avait entraîné la
défaite contre la Prusse.
 C'est Jules Ferry,
ministre de l'Instruction publique, qui lance la grande
réforme du système éducatif
français.
C'est Jules Ferry,
ministre de l'Instruction publique, qui lance la grande
réforme du système éducatif
français.

 Les « lois
Ferry » sont votées en 1880 et 1881
et mettent en place les grands principes du
système éducatif français :
Les « lois
Ferry » sont votées en 1880 et 1881
et mettent en place les grands principes du
système éducatif français :
 → L'enseignement
devient gratuit dans les
écoles publiques.
→ L'enseignement
devient gratuit dans les
écoles publiques.
 → L'instruction
devient obligatoire pour
tous les enfants, filles et garçons de 6
à 13 ans. Elle peut se faire à
l'école ou au sein de la famille.
→ L'instruction
devient obligatoire pour
tous les enfants, filles et garçons de 6
à 13 ans. Elle peut se faire à
l'école ou au sein de la famille.
 → L'école
devient laïque :
elle n'est plus contrôlée par les religieux.
Le catéchisme est retiré des programmes et
remplacé par la morale et l'instruction civique.
→ L'école
devient laïque :
elle n'est plus contrôlée par les religieux.
Le catéchisme est retiré des programmes et
remplacé par la morale et l'instruction civique.
 L'écolier se rend
à l'école 5 jours par
semaine : le jeudi et le
dimanche sont
les jours de repos.
L'écolier se rend
à l'école 5 jours par
semaine : le jeudi et le
dimanche sont
les jours de repos.
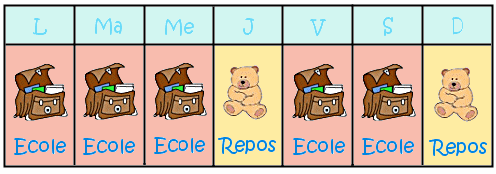
 Les
vacances sont bien moins
nombreuses et plus courtes que maintenant.
Les
vacances sont bien moins
nombreuses et plus courtes que maintenant.
Chaque écolier porte un tablier et l'école
n'est pas mixte : il existe des écoles de filles
et des écoles de garçons.

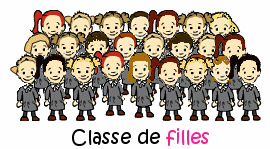
 Beaucoup
considéraient que l'enseignement des filles
était moins important et qu'il suffisait de les
préparer à devenir de bonnes femmes de
maison.
Beaucoup
considéraient que l'enseignement des filles
était moins important et qu'il suffisait de les
préparer à devenir de bonnes femmes de
maison.
 → ils mettaient sur la
tête des mauvais élèves le
bonnet
d'âne,
→ ils mettaient sur la
tête des mauvais élèves le
bonnet
d'âne,
 → ils pouvaient donner
de lourdes
punitions,
→ ils pouvaient donner
de lourdes
punitions,
 → ils
retenaient les
élèves
après la classe,
→ ils
retenaient les
élèves
après la classe,
 → ils faisaient aussi
subir des châtiments
corporels comme des coups de
bâtons aux élèves
indisciplinés.
→ ils faisaient aussi
subir des châtiments
corporels comme des coups de
bâtons aux élèves
indisciplinés.
 Avec les lois Ferry, on
observe une diversification des
enseignements : lire, écrire, compter
sont toujours une priorité mais on voit
également apparaître de nouvelles
matières :
Avec les lois Ferry, on
observe une diversification des
enseignements : lire, écrire, compter
sont toujours une priorité mais on voit
également apparaître de nouvelles
matières :
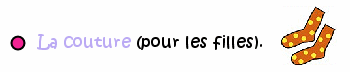
 La scolarité se
terminait avec un examen appelé le «
certificat
d'études »
passé entre 11 et 13 ans. Ce certificat faisait la
fierté des familles et garantissait de
trouver un travail.
La scolarité se
terminait avec un examen appelé le «
certificat
d'études »
passé entre 11 et 13 ans. Ce certificat faisait la
fierté des familles et garantissait de
trouver un travail.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !