Les objectifs et les instruments de la politique économique
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Aujourd’hui, le simple jeu du marché ne suffit plus à rétablir les équilibres fondamentaux des économies capitalistes. C’est pourquoi l’intervention de l’État devient nécessaire : on parle de régulation étatique. L’État élabore pour cela une « politique économique ».
La politique économique désigne l’ensemble des décisions prises par le gouvernement afin d’atteindre certains objectifs (relance de l’économie, diminution du chômage...). Pour atteindre ces objectifs, les pouvoirs publics disposent d’un certain nombre d’instruments.
• la croissance économique mesurée à partir du taux de croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) ;
• l’emploi évalué par le taux de chômage ;
• la stabilité des prix mesurée par le taux d’inflation (hausse des prix) ;
• l’équilibre extérieur évalué par le solde de la balance des paiements courants (exportations/importations).
La représentation graphique de ces quatre objectifs est appelée « carré magique ».
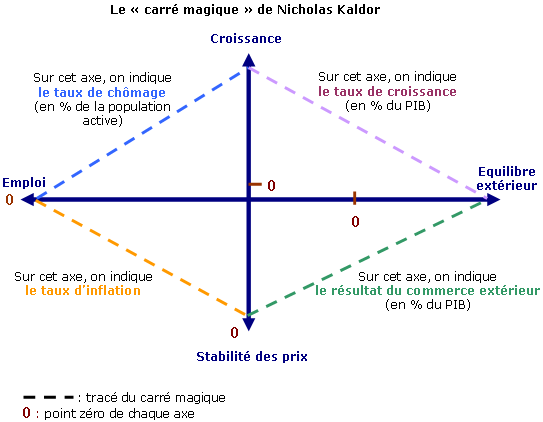
Le carré magique (tracé en pointillé) représente la situation idéale pour une économie : un taux de croissance le plus élevé possible ; un commerce extérieur excédentaire ; une situation proche du plein emploi (taux de chômage proche de zéro) et un taux d’inflation le plus faible possible (taux proche de zéro).
• Les politiques conjoncturelles visent à agir à court terme et à guider l’activité économique du pays ; elles se composent essentiellement des politiques budgétaire et monétaire. Elles ont souvent deux orientations possibles (mais antagonistes) : la priorité à l’emploi (on parlera de politique de relance ou « politique de Go »), la priorité à la lutte contre l’inflation (on parlera alors de politique de rigueur ou « politique de Stop »). Le gouvernement fera alors le choix entre l’une ou l’autre de ces deux priorités.
• Les politiques structurelles visent au contraire à agir sur le long terme en modifiant durablement les structures de l’économie. Il s’agit de préparer et d’accompagner l’économie aux changements économiques majeurs (industrialisation, mondialisation, délocalisations…). Elles comprennent des politiques telles que la politique de la concurrence, la politique industrielle, la politique de la recherche et du développement…
Remarque : depuis l’adhésion de la France au traité de Maastricht, l’État français doit respecter le pacte de stabilité (dans le cadre de sa politique budgétaire, un déficit budgétaire inférieur ou égal à 3 % du PIB et une dette publique inférieure ou égale à 60 % du PIB).
• Les orientations en matière de politique fiscale
La fixation des taux d’imposition (impôts sur les revenus, impôts sur la dépense…) n’est pas neutre. Elle peut provoquer un repli (si l’on augmente les taux d’imposition) ou au contraire une relance (si l’on abaisse les taux d’imposition) de l’activité économique.
- Exemples de politique de relance : une baisse de l’impôt sur les sociétés entraîne une relance des investissements des entreprises et de la production, qui engendre une hausse du PIB, donc une croissance économique, ce qui permet la création d’emplois donc une diminution du chômage.
Une baisse de l’impôt sur le revenu ou de la TVA entraîne une hausse du revenu disponible et donc de la consommation des ménages. La production des entreprises augmente alors, ce qui a pour conséquence une hausse du PIB, donc une croissance économique.
- Exemple de politique restrictive : une augmentation de l’impôt sur les revenus entraîne une baisse du revenu disponible et donc de la consommation des ménages. La production des entreprises diminue alors, ce qui a pour conséquence une baisse du PIB, donc récession et chômage.
• Les orientations en matière de dépenses publiques
- La politique de relance (ou politique expansive)
L’objectif est de favoriser le développement de l’activité économique ; une hausse des dépenses publiques pourra entraîner une hausse de la demande des ménages (consommation) et des entreprises (investissements) donc de la production ce qui permettra de réduire le chômage (accroissement d’activité pour les entreprises engendrant un besoin de main-d’œuvre supplémentaire).
Cette même hausse peut avoir des effets négatifs tels que l’accroissement des tensions inflationnistes (demande supérieure à l’offre) et surtout le creusement du déficit budgétaire (plus de dépenses publiques que de recettes) donc l’alourdissement de la dette de l’État.
- La politique restrictive
La réduction des dépenses publiques permet de réduire le déficit budgétaire, donc l’endettement étatique, mais elle restreint également le niveau de la consommation et les investissements des entreprises, donc le niveau d’activité de l’économie.
• un objectif de relance de l’activité économique
Une action positive sur les revenus distribués (hausse du SMIC, incitations à l’embauche…) peut permettre un accroissement de la demande globale, donc une relance de l’activité économique.
Toutefois, l’augmentation des revenus peut entraîner une hausse du coût du facteur travail ayant plusieurs conséquences négatives : une élévation possible du chômage, un risque d’inflation (les entreprises reportant la hausse du coût du travail sur les prix de vente)...
• un objectif de restriction de l’activité économique
Un gel ou un ralentissement dans la progression des revenus peut permettre de maîtriser des tensions inflationnistes. Toutefois, vont naître des tensions sociales (grèves) en raison de la stagnation du pouvoir d’achat (quantité de biens et de services qu’un revenu permet de se procurer).
En augmentant ou en diminuant les taux d’intérêt directeurs, les autorités monétaires (Banque centrale européenne principalement) influent sur la distribution de crédit, donc sur la demande des ménages et des entreprises.
La politique économique représente l’ensemble des décisions prises par le gouvernement pour agir sur l’activité économique du pays. En fonction des objectifs poursuivis (maîtrise de l’inflation, baisse du chômage, relance de la croissance économique, développement du commerce extérieur...), les instruments de politique économique privilégiés par le gouvernement seront différents : politique budgétaire, politique monétaire, politique des revenus principalement.
Les gouvernements complètent leur action par des politiques plus ciblées : politique agricole, politique industrielle, politique de l’environnement, politique énergétique, politique de la concurrence…
Deux orientations sont principalement choisies dans le cadre d’une politique économique :
- la politique de relance ou politique expansive, qui privilégie la lutte contre le chômage. Les moyens utilisés consistent à accroître la demande ;
- la politique de rigueur ou politique restrictive, qui privilégie la lutte contre la hausse du niveau général des prix. Les moyens utilisés consistent alors à restreindre le niveau de consommation.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !








