Les défis de la protection sociale- Première- SES
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
- Comprendre la crise de la protection sociale française et connaitre les solutions possibles.
- Le système de protection sociale français, basé sur la solidarité collective, est en crise. Cette crise est triple : financière, d’efficacité et de confiance.
- Les solutions appliquées depuis 20 ans sont insuffisantes et la tentation est forte de recourir à un système plus libéral, basé sur l’assurance individuelle. Mais les risques d’augmentation de la pauvreté et des inégalités sont grands et sans certitude sur l’efficacité globale.
La protection sociale française est en crise. Quelles sont ses perspectives ?
Le système de sécurité sociale connaît de forts déficits depuis les années 1990. Ce déficit a été de près de 12 milliards d’euros en 2007, notamment à cause des branches maladie et vieillesse. Ces déficits se creusent du fait de :
- la baisse des recettes : la progression du chômage et de la précarité au cours des années 1990 a réduit les cotisations sociales des salariés. De plus, les politiques libérales de baisse de l’imposition des entreprises (notamment des cotisations patronales) ont aggravé cette baisse des recettes ;
-
la hausse des dépenses : le
vieillissement de la population fait augmenter
les dépenses de retraite mais aussi les
dépenses de santé. Le
progrès technologique rend aussi les examens
plus coûteux. Un système largement
gratuit pour la santé encourage aussi certains
abus de prescription de la part des patients mais
aussi des médecins. La grosse
inquiétude concerne le système de
retraite par répartition. Le
vieillissement de la population,
l’arrivée massive de retraités
dès 2005 (enfants du baby-boom)
conjuguée avec une baisse des actifs font que
la charge des retraites va être beaucoup plus
lourde à porter pour les actifs.
De plus, le ralentissement économique vient aggraver ce phénomène (stagnation des emplois proposés et des salaires).
Malgré les dépenses de plus en plus
importantes, il y a une montée de la
pauvreté, des
inégalités et de
l’exclusion. Le régime
chômage comprend désormais une partie
solidarité notamment pour les chômeurs de
longue durée qui peuvent toucher
l’Allocation de Solidarité
Spécifique. Une partie de plus en plus forte
de la population ne vit qu’avec ces aides
sociales ou alors passe au travers des mailles de la
protection sociale et tombe dans la
marginalité.
Le RMI (Revenu minimum d’insertion) par
exemple prévoyait lors de sa création en
1988 de permettre à la fois d’avoir un
revenu minimum mais aussi une aide pour se
réinsérer socialement (suivi des
personnes, stages…). Or, force est de constater
que le versant « intégration » du
RMI est un échec : peu de Rmistes trouvent un
emploi, et beaucoup vivent seulement de cette
allocation. Leur nombre a plus que
décuplé pour atteindre aujourd’hui
environ 1,2 million d’allocataires.
Le RSA (Revenu de Solidarité Active) doit
permettre d’encourager les Rmistes à
reprendre une activité même peu
rémunérée en leur proposant un
complément de salaire. Mais est-ce à dire
que 1,2 million de personnes ne travaillent pas car
elles ne le souhaitent pas ?
Pour les libéraux, la redistribution encourage les individus à la paresse ; par exemple les allocations chômage n’incitent pas les travailleurs à chercher un emploi, il y a augmentation des chômeurs « volontaires ». De plus, le système de gratuité encourage les gaspillages en tout genre. Par exemple, pour les soins, les individus peuvent être tentés d’abuser des traitements et les médecins de prescrire beaucoup de soins. Chacun abuse donc de l’offre de services publics non marchands sans se soucier de l’intérêt collectif.

|
| Doc 1 : Dans les centres de soins, on constate des abus de traitements payés par la collectivité |
Moins efficace et plus coûteuse, la protection
sociale perd de sa légitimité aux
yeux de certaines parties de la population, notamment
les plus favorisées qui sont plus sensibles
à la protection individuelle à
l’anglo-saxonne. Le lien de solidarité est
ainsi remis en cause entre les jeunes et les vieux, les
biens portants et les malades… Le discours
ambiant est de plus en plus « anti-impôts
et cotisations sociales » à l’image
des États-Unis où, dès les
années 1980, la classe moyenne s’est
désolidarisée des classes
défavorisées, les considérant
comme des assistés.
Les nouvelles technologies amènent aussi des
questionnements sur les risques ; cela peut
remettre en question l’égalité de
tous devant la protection sociale ; par exemple, dans
le cas de risques volontairement courus (fumeurs,
personnes obèses…), certains
n’hésitent pas à préconiser
que la collectivité ne finance plus leurs soins.
Plusieurs réformes ont eu lieu depuis les
années 1990 pour pallier notamment les
déficits. Les solutions ont tout d’abord
été d’augmenter les cotisations en
créant de nouveaux prélèvements
comme la CSG (Contribution Sociale
Généralisée en 1989) ou le
RDS (Remboursement de la Dette Sociale en 1993).
Mais il est impossible de continuer à augmenter
les cotisations sociales sans créer un fort
mécontentement des salariés comme des
employeurs (les cotisations sociales
représentent 40 % du coût salarial en
France pour les entreprises). Il en est de même
pour les retraites.
Aujourd’hui, les solutions tournent donc autour
de la maîtrise des dépenses dans le
domaine de la santé. Contrôle des
prescriptions des médecins et des arrêts
maladie chez les patients, franchises médicales
non remboursées, moindres remboursements de
certains médicaments « de confort
»… sont censés diminuer le
recours à l’assurance maladie et
développer en partie
l’automédication comme dans les
pays anglo-saxons.
En ce qui concerne le financement des retraites, la
durée de cotisation minimale a été
reculée ; il faut aujourd’hui cotiser
40 ans (bientôt 41 ans) pour avoir le droit
à une retraite pleine (l’âge
légal de la retraite est resté
fixé à 60 ans). Le recours à des
retraites complémentaires, individuelles,
est encouragé.
Ces solutions mettent de plus en plus l’accent
sur le volet individualiste de la protection sociale
qui est d’inspiration libérale. La
protection sociale est de moins en moins
envisagée comme un problème collectif
où la solidarité doit être la
règle.
Ces solutions libérales ont été
mises en place notamment dans les pays anglo-saxons
(dès les années 1960 aux
États-Unis et les années 1980 en
Grande-Bretagne).
Les mesures prises aux États-Unis et en
Grande-Bretagne (réduction des impôts et
des cotisations sociales, développement de
systèmes d’assurances privées,
prestations chômage soumises à
l’obligation de fournir une contrepartie en
travail, suppression des minima sociaux…) ont
conduit à un fort développement des
inégalités sociales, et une
rupture du lien social avec le développement
important de la pauvreté et de
l’exclusion.
De plus, il y a une forte dégradation de la
protection sociale (soins médicaux de mauvaise
qualité en Grande-Bretagne, une médecine
à deux vitesses aux États-Unis où
1 américain sur 4 est dépourvu de
couverture maladie ce qui entraîne de fortes
inégalités et une dégradation de
l’état sanitaire global dans ces pays).
Enfin, le système n’est pas plus efficace
concrètement un américain coûte
beaucoup plus cher en dépenses médicales
qu’un français.
Le système français doit donc être
probablement rénové mais en tenant compte
des expériences menées et des risques qui
sont liés.
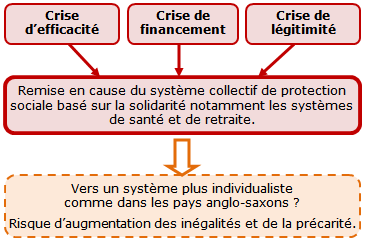

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !








