La diversité des entreprises- Première- SES
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
- Connaitre les caractéristiques des différents types d'entreprise.
- Il existe une grande diversité des entreprises selon leur taille, leur secteur d’activité ou encore leur forme juridique.
- Chacune d’elle détermine comment elle va réaliser sa production en combinant différemment ses facteurs de production pour maximiser sa rentabilité. Les quantités offertes sur le marché par les entreprises sont donc croissantes si le prix augmente.
Les prélèvements obligatoires ne sont pas qu’une ressource pour l’État. Ils peuvent servir à modifier certains comportements. Mais cette politique est-elle efficace ?
Les entreprises ont des tailles très différentes, de l’entreprise individuelle au groupe qui emploie des milliers de personnes dans le monde entier, on distingue en général :
- Les entreprises individuelles : une seule personne (le créateur) en fait partie.
- Les Très Petites Entreprises (TPE) qui comptent en général moins de 10 salariés. Elles représentent néanmoins plus de 9 entreprises sur 10 en France (document 1).
- Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui comptent moins de 500 salariés.
- Les grandes entreprises qui comptent plus de 500 salariés et sont souvent internationalisées. Elles ne représentent que 0,1 % des entreprises françaises mais emploient près d’un tiers des salariés (document 2).

|

|
| Doc. 1. Très petite entreprise (TPE) | Doc. 2. Grande entreprise |
Les entreprises produisent des biens ou des services
marchands. Cette production détermine le secteur
d’activité :
- Primaire : l’agriculture, la pêche et les mines.
- Secondaire : l’industrie et le bâtiment.
- Tertiaire : les services (commerce, transports…).
Le statut juridique est la forme légale selon
laquelle s’organise l’entreprise. Elle
dépend de sa taille mais aussi des risques
engagés.
L’entreprise individuelle : dans ce cas
là seule une personne crée
l’entreprise et en est responsable. Elle peut
donc être responsable sur ses biens personnels en
cas de faillite de l’entreprise. C’est dans
ce cadre là que l’on trouve le statut
d’auto entrepreneur mais il est
limité à un certain chiffre
d’affaires annuel. Certaines formes
d’entreprises individuelles permettent de limiter
la responsabilité aux biens de
l’entreprise, telles que les EURL (Entreprise
unipersonnelle à responsabilité
limitée), encore faut-il que les actifs de
l’entreprise soient au moins égaux
à 30 000 euros.
La société : dans ce cas
là plusieurs personnes sont à
l’origine de l’entreprise et se partagent
le pouvoir. On peut trouver deux formes principales :
- La SARL (Société A Responsabilité Limitée) : elle est créée par 2 à 50 associés qui se partagent le pouvoir et les risques. En cas de faillite seuls les capitaux professionnels peuvent être saisis.
- La SA (Société Anonyme) : dans ce cadre le capital de la société est introduit en Bourse et les actions vendues à au moins 7 actionnaires différents. Ce statut permet de trouver de fortes sommes d’argent pour le capital de l’entreprise. Les actionnaires ne sont responsables que sur le montant des actions détenues, ils sont donc les propriétaires de l’entreprise (à concurrence du nombre d’actions détenues).
En ce qui concerne le contrôle du capital on peut trouver une distinction importante entre les entreprises privées (qui appartiennent à des particuliers comme Peugeot-Citroën) ou publiques (qui appartiennent tout ou en grande partie à l’État).
On trouve deux grandes familles de facteurs de
production qui sont le travail et le
capital.
En ce qui concerne le travail l’entreprise va
devoir recruter de la main-d’œuvre pour
pouvoir produire. Le travail peut être
qualifié ou non-qualifié,
d’exécution, de conception
ou de direction. Il y a différents
niveaux de hiérarchie mais aussi de
responsabilités.
L’ensemble des biens et services utilisés
pour produire forme le capital technique. En ce
qui concerne le capital, les différences sont
essentielles, on distingue le capital :
- Matériel (machines, bâtiments, outils…) ou immatériel (énergie, logiciel).
- Fixe : ce sont tous les biens qui vont servir plusieurs fois, pour une durée supérieure à un an (machines, outils, logiciel).
- Circulant : ce sont les biens ou les services qui vont être détruits ou transformés durant le processus de production, ou qui vont durer moins d’un an (matières premières, énergie…).
L’achat de capital fixe par une entreprise est appelé investissement productif, lorsqu’elle achète du capital circulant, l’entreprise fait une consommation intermédiaire.
L’entreprise va devoir combiner ces facteurs de
production pour pouvoir produire au moindre coût.
Si son coût de production est minimal, le
bénéfice lui sera maximal.
La combinaison optimale dépend donc du prix
des facteurs de production, s’ils changent
l’entreprise peut faire évoluer sa
combinaison.
Dans les pays développés, le prix du
travail est élevé (du fait des salaires
mais aussi surtout des cotisations sociales),
l’entreprise choisit donc de remplacer du travail
par du capital, on dit qu’il y a substitution
du capital au travail. Par exemple, une usine
automobile qui robotise ses chaînes de
production.
Aujourd’hui, l’entreprise peut aussi avoir
le choix de délocaliser sa production
dans les pays où les coûts de la main
d’œuvre sont moins élevés. On
utilisera alors des combinaisons qui utilisent
relativement plus de travail bon marché que de
capital.
Dans certains cas les facteurs de production ne sont
pas substituables, par exemple dans les transports, on
a besoin d’un chauffeur de bus et d’un bus,
on ne peut pas remplacer les chauffeurs trop chers par
des bus, qui les conduirait ? Dans ce cas les facteurs
de production sont dits complémentaires.
Les entreprises vont produire leurs biens pour les vendre
à un prix supérieur à leur
coût de production. L’entreprise
n’a aucune prise sur le prix du marché dans
le cadre de la concurrence pure et parfaite, elle va donc
uniquement déterminer les quantités
à produire en fonction de ce prix.
Si le prix augmente, alors certaines entreprises (qui
avaient un coût de production plus
élevé) vont devenir rentables ce qui va les
encourager à entrer sur le marché. Les
quantités produites vont donc augmenter. Cela
donne donc une forme croissante à la fonction
d’offre qui se détermine selon le prix.
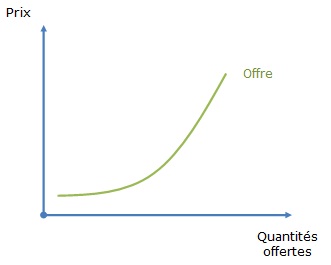
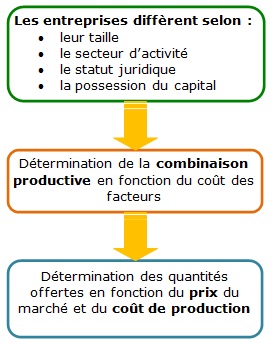

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !








