La conservation des aliments
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Savoir ce qu’est un micro-organisme et comment il se développe.
Connaître les principales méthodes de conservation.
Appréhender les risques pour la santé.
Certains aliments (comme les fruits ou le jambon) « ternissent » sous l'action du dioxygène contenu dans l'air. On dit qu'ils subissent une oxydation ou se sont oxydés.
Remarque : ce phénomène peut être accéléré lorsque la température ambiante s'élève.
La lumière joue également un rôle dans la dégradation des aliments, car elle permet la formation de radicaux libres qui sont à l'origine de la dégradation des corps gras.
Un radical libre est un intermédiaire réactionnel qui comporte un électron libre et qui intervient dans une suite de réactions comprenant plusieurs phases (initiation, propagation et terminaison).
Sous l'action de la lumière, une molécule de dichlore, Cl2, peut se scinder en deux radicaux identiques.
Cette dégradation est limitée si l'on verse du jus de citron, de la vitamine C ou du vinaigre sur l'aliment. La réaction d'oxydation, responsable de la coloration, ne se produit pas. En effet, ces composés contiennent des substances antioxydantes appelées aussi antioxygènes.
Le choix de nos aliments est notamment lié au goût et aux différentes saveurs perçues par les papilles de la langue. Néanmoins, les autres fonctions sensorielles entrent également en jeu dans ce choix.
À cela il faut aussi ajouter l'apprentissage de chacun, lié aux habitudes, à la religion et à la culture, avec leurs interdits et leurs libertés. Toutefois, une part de comportement inné existe : chacun possède ses propres préférences, comme le mettent en évidence les tests de saveur et de goût.
La conservation des aliments permet de reculer la date de péremption tout en préservant leur comestibilité et leurs qualités nutritives et gustatives.
Exemples d'antioxygènes : vitamine C (acide ascorbique), vitamine E (huile d'olive vierge).
Remarque : les enzymes, produites par l'organisme, contrôlées par certains oligo-éléments (magnésium, cuivre, ...), permettent de lutter contre les radicaux libres et de stopper ainsi le processus de dégradation.
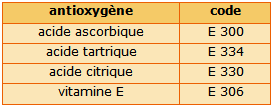
|
|
Doc. 1 : Exemples de codes
d'antioxygènes rencontrés dans les aliments |
Selon le mécanisme de conversion de l’énergie en énergie chimique qu’ils mettent en œuvre, les micro-organismes peuvent être séparés en deux types :
• ceux qui utilisent l’énergie électromagnétique (lumière) comme source d’énergie pour la croissance.
• ceux qui transforment l’énergie par réactions d’oxydo-réduction de substrats organiques ou inorganiques.
Les micro-organismes utilisent également des glucides, lipides et protéines et l’eau est indispensable à leur survie. Ils absorbent les nutriments par transport passif ou actif ou endocytose.
L’industrie agro-alimentaire utilise plusieurs procédés :
– La pasteurisation : traitement thermique à très haute température puis refroidissement pour éliminer les micro-organismes et agents pathogènes. Aliments à conserver par la suite au frais à 4°C.
– La stérilisation pour éliminer les microbes.
– L’appertisation : stérilisation des aliments puis conservation dans des boites hermétiques (métalliques ou bocaux).
– L’UHT : traitement à Ultra Haute Température, essentiellement pour les produits liquides chauffés à 150°C pendant 1 à 5 secondes.
– La réfrigération : le froid permet de ralentir le développement des micro-organismes et l’activité cellulaire. Attention contrairement à la chaleur, elle ne détruit pas les microbes.
– La congélation : stoppe l’activité microbienne et enzymatique.
– La déshydratation : l’absence totale ou partielle d’eau diminue le développement microbien et stoppe l’activité enzymatique.
– Les conservateurs chimiques ou organiques : pour stopper le développement microbien.
– Conditionnement sous vide : réduit le taux d’oxygène dans l’emballage et empêche ainsi l’oxydation des aliments.
Des mesures d’hygiènes très strictes doivent être prises pour prévenir les risques d’intoxication.
La période d’incubation est le délai entre la consommation de l’aliment et les premiers symptômes de la maladie, elle peut varier de quelques heures à plusieurs jours, temps nécessaire à l’agent infectieux pour rejoindre les intestins et s’y développer.
Exemple de bactéries pathogènes : Salmonelles, Escherichia coli.
Exotoxines : toxine sécrétée par une cellule suite à une infection par un agent pathogène.
Exemple : le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) produit une toxine qui provoque de violents vomissements et des diarrhées 3 heures environ après ingestion de l'aliment. La toxine botulique est une puissante toxine paralysante sécrétée suite à une infection par la bactérie Clostridium botulinum. Les aliments le plus souvent incriminés sont les jambons crus et les conserves mal stérilisées.
Virus : représentent le tiers des intoxications alimentaires avec une période d’incubation de 2-3 jours.
Exemples : hépatite A et E, Norovirus, Rotavirus.
Parasites : la plupart de ces intoxications sont des zoonoses, c'est-à-dire des parasites transmissibles à l’homme par l’animal.
Exemple : ténia ou vers solitaire, ascaris (vers ronds), toxoplasma gondii qui provoque la toxoplasmose.
Le dioxygène contenu dans l'air exerce une action néfaste (odeur et goût peu agréables) sur les aliments.
Les anti-oxygènes sont des substances chimiques généralement acides. Elles sont produites par l'organisme ou apportées par l'alimentation. Elles permettent de conserver les aliments et de lutter contre l'action du dioxygène de l'air.
Les agents antioxygènes ou conservateurs sont repérés sur les emballages alimentaires par le code E 3 – – .
Les micro-organsimes sont des agents pathogènes pouvant provoquer diverses intoxications alimentaires.
Pour conserver un aliment, plusieurs procédés peuvent être employés pour limiter l’oxydation et donc les activités enzymatiques ou le développement des micro-organismes.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









