Faut-il réduire les coûts salariaux ?
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
L'équilibre naturel du marché du travail ne pourrait alors être atteint, particulièrement pour les salariés dont la productivité est la plus faible : les employeurs sont donc contraints de réaliser une flexibilité par les quantités (en n'embauchant pas ou en débauchant), puisqu'on leur refuse une flexibilité des niveaux de salaires.
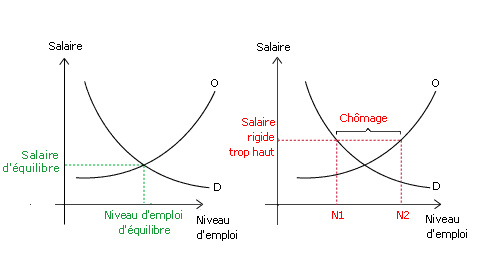
D = Demande de travail (émanant des employeurs).
En effet, le coût salarial total comprend, outre le salaire net et les cotisations sociales, les cotisations patronales et les charges professionnelles. Les politiques d'emplois visant à réduire le chômage font d'ailleurs partiellement référence à ces analyses théoriques : les pouvoirs publics proposent ainsi des aides spécifiques à l'embauche pour certaines catégories de personnes (chômeurs de longue durée par exemple ou jeunes sans qualification) dont profitent les employeurs sous forme d'allègement de charges sociales.
Le coût d'opportunité du travail est aussi évoqué : du fait des allocations et des revenus sociaux de transfert, les chômeurs ne seraient pas incités à retrouver une activité, puisque le différentiel entre le revenu du travail et les revenus sociaux est assez faible. Il faudrait donc limiter les durées et les montants des aides sociales, pour éviter ces trappes à chômage.
Pour limiter ce chômage keynésien, il faut jouer sur les variables déterminant la demande effective : le niveau de consommation et le niveau d'investissement. Il semble donc peu efficace de vouloir baisser les coûts salariaux, bien au contraire.
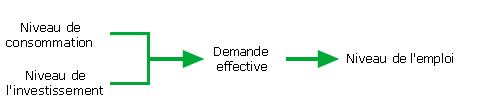

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !








