Modification de la biodiversité par l'activité humaine
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Au travers d’exemples précis, il s’agira d’identifier les différentes actions de l’Homme conduisant aujourd’hui à la modification de la biodiversité.
Les cinq causes majeures de la perte de biodiversité sont :
- La destruction et perte de l'habitat,
- L'introduction d'espèces invasives,
- La surexploitation des ressources,
- La pollution par l’utilisation de pesticides et d’herbicides en agriculture,
- Le dérèglement climatique.
Par la construction de routes et d'habitations, l'Homme morcelle le paysage et fragmente ainsi les habitats naturels.

Les espèces qui vivaient alors en équilibre subissent une forte perturbation. Toutes n'ont pas les capacités pour survivre à ces perturbations et certaines disparaissent.
L’exemple le plus cité est celui de la forêt amazonienne qui est incendiée et détruite au profit de grandes surfaces agricoles permettant de cultiver de façon intensive du soja ou des palmiers permettant la production de l’huile de palme. Malheureusement nécessaire au développement économique du pays et à la consommation mondiale.
L’assèchement des zones humides et la modification des cours d’eau conduisent à la disparition des frayères, zones de reproduction des poissons (ex : esturgeon sauvage en France) et perturbent les zones de reproduction de certains oiseaux (11% d’espèces d’oiseaux sont menacées aujourd’hui de disparition) dépendant des milieux aquatiques.
Les amphibiens sont un exemple d'espèces principalement menacées par la fragmentation de leur habitat par les routes. En effet, lorsqu'une route coupe le passage entre la foret (lieu de vie) et un milieu aquatique (lieu de reproduction), la survie de la population est gravement menacée.

Des solutions existent pour remédier à ce genre de problèmes comme la mise en place de corridors biologiques sur les autoroutes ou l'utilisation de crapauduc.


L'Homme en est le principal vecteur soit de manière intentionnelle soit accidentelle.
Exemple d'introduction intentionnelle et commerciale : la Tortue de Floride.
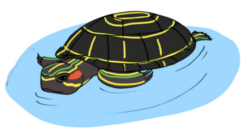
Exemple d'introduction accidentelle : Caulerpa taxifolia.

C'est une algue tropicale utilisée dans les aquarium comme plante d'ornement. Elle fut libérée accidentellement en Méditerranée par l'aquarium de Monaco en 1984. De part sa très grande résistance et une forte reproduction végétative, elle colonise très vite tous les espaces marins et menace la flore marine (comme les herbiers de posidonie) et par conséquent la faune marine.

Attention, toute espèce introduite ne devient pas automatiquement invasive, il faut pour cela qu'elle remplisse plusieurs critères et qu'elle cause de réels dommages évalués scientifiquement. On estime qu'environ 1 espèce introduite sur 1000 devient invasive.
La disparition de la Tortue de Bourbon (sur l'île de la réunion) est un exemple de surexploitation par l'Homme.
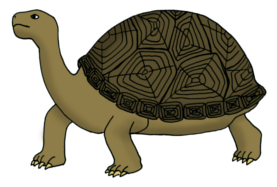
Au 18e siècle, c'est l’ectopiste migrateur, un pigeon qui s’attaque aux cultures aux Etats-Unis qui disparait.

Aujourd’hui se sont des espèces comme le thon rouge, ou certaines espèces de requins qui sont en danger. En effet, les rythmes de pêche sont trop rapides par rapport aux rythmes de renouvellement de l’espèce. Ainsi, le nombre de représentants diminue de plus en plus.

De même, la chasse est réglementée dans certains pays afin de préserver au maximum l’équilibre des écosystèmes.
La surexploitation provoque un déséquilibre dans le fonctionnement des écosystèmes parfois irréversible, qui peut conduire à des changements à l'échelle planétaire.
Il est souvent difficile de gérer des problèmes liés à la surexploitation des ressources car bien souvent elles sont liées aux besoins économiques du pays.
C’est l’activité humaine qui est responsable de cette érosion de la biodiversité :
- La destruction et perte de l'habitat,
- L'introduction d'espèces invasives,
- La surexploitation des ressources,
- La pollution par l’utilisation de pesticides et d’herbicides en agriculture,
- Le dérèglement climatique.
Ces différentes actions répondent aux besoins de la population mondiale qui ne cesse de s’accroître. L’Homme prend aujourd’hui conscience de l’importance de préserver la biodiversité dont sa propre survie dépend. Les politiques doivent donc prendre des décisions permettant d’exploiter à long terme les ressources naturelles de la planète tout en les préservant (principe du Développement Durable).

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









