« Madame Bovary », Gustave Flaubert : Les thèmes
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
À l’époque de la parution de ce livre, le réalisme, qui est un nouveau courant de pensée littéraire et picturale, en est à ses prémices. Ce roman de Flaubert présente des aspects à la fois du réalisme naissant mais également quelques éléments romantiques, ce que revendique Gustave Flaubert dans sa correspondance avec Louise Colet :
| « Il y a en moi, littérairement parlant, deux bonshommes distincts : un qui est pétri de gueulades, de lyrisme, de grands vols d’aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l’idée ; un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu’il peut. » |
| Gustave Flaubert, 16 janvier 1852 |
Lors de son mariage avec Charles, on note l’opposition irréductible entre son désir d’une cérémonie nocturne aux flambeaux et le matérialisme de son père qui pense seulement à la nourriture et aux plaisirs. On appelle « bovarysme » ce désir forcené d’une autre existence plus exaltante. Emma cherche à s’échapper sans cesse de ce monde ennuyeux qui l’étouffe.
• Les émois de la passion : la conversation entre Emma et Léon, l’amour platonique pour Léon, le passage où Rodolphe séduit Emma aux Comices, la balade à cheval…
• Le goût de la rêverie : les lectures d’Emma au couvent, le rêve de lune de miel, le coucher de soleil à Tostes, Emma qui lit des vers de Lamartine à Charles, le bal à la Vaubyessard…
• Une fatalité romantique : un échec qui met définitivement un terme à toute tentative d’évasion, avec le suicide d’Emma.
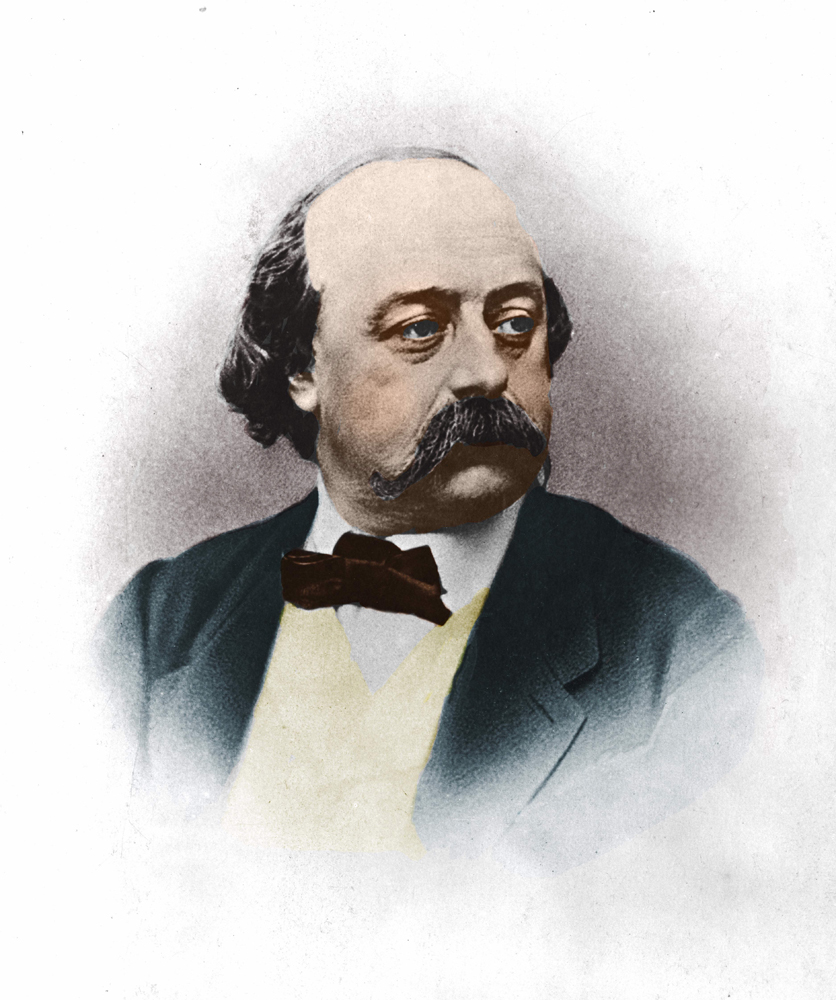
|
| Doc.1. Portrait de Gustave Flaubert |
Cette exclamation de Flaubert « Madame Bovary, c’est moi ! » montre les traits romantiques communs de l’auteur et de son personnage :
• Flaubert a éprouvé un goût démesuré pour la lecture, notamment pour René de Chateaubriand.
• Le goût de la rêverie, ce qu’il appelait son « infini besoin de sensations intenses. »
• Les émois de la passion : Flaubert a éprouvé lui-même, pour Élisa Schlésinger notamment, cette passion romantique qu’il entend condamner.
• La révolte : Flaubert partage le dégoût d’Emma, même s’il s’en défend : « Croyez-vous donc que cette ignoble réalité, dont la reproduction vous dégoûte, ne me fasse tout autant qu’à vous sauter le cœur ? Si vous me connaissiez davantage, vous sauriez que j’ai la vie ordinaire en exécration. Je m’en suis toujours personnellement écarté autant que j’ai pu », écrit-il dans sa correspondance.
À la différence d’Emma toutefois, il ne fuira pas dans un rêve éveillé mais cherchera à sublimer la réalité par le travail artistique.
→ les paysages : montagne, cascade, glacier, précipice, soleil couchant, clair de lune, tombeau, ruine, etc.
→ le cœur et l'esprit : inspiration, génie, infini, idéal, passion, etc.
→ l'exotisme : bayadère, sopha, etc.
• dans les discours amoureux de Rodolphe qui sont une réutilisation des poncifs romantiques.
Or, Rodolphe cherche à manipuler Emma ;
• dans les conversations de Léon et Emma qui sont teintées par leurs lectures, dans lesquelles ils multiplient les lieux communs du romantisme (allusions à Lamartine) ;
• par les personnages masculins de Madame Bovary qui ne sont pas des héros courageux, exaltés, lyriques mais petits et médiocres, des anti-héros du quotidien ;
• dans l'inadéquation cruelle des idéaux romantiques avec la société bourgeoise.
• Il s’est appuyé sur des faits réels pour écrire son récit.
En 1851, l’attention de Flaubert est attirée par un fait divers : en 1848, Eugène Delamare, un médecin habitant le village de Ry en Haute-Normandie, se remarie avec une femme assez belle d’environ 17 ans. Celle-ci contracte des dettes, a une fille, une aventure amoureuse et meurt empoisonnée.
• Il enquête sur place afin de mieux comprendre les personnages de son roman et pour coller à la réalité, il collecte et lit de nombreux documents tels que des traités de médecine.
• Il évoque les mutations économiques : cette société vit une mutation économique avec le développement de l’industrie, du progrès technique, des voies de communication (la visite sur le chantier de la filature de lin, les Comices…).
• Il brosse un tableau sociologique de la province. Flaubert inscrit ses personnages dans une réalité sociale, ils possèdent tous une identité bien définie. Il présente toutes les strates de la société : les aristocrates (la Vaubyessard), les notables terriens (Rodolphe de la Huchette), les notables de la culture (la science avec Homais, Bovary, le droit avec maître Guillaumin…), la notabilité des affaires (Lheureux), politique (M. Tuvache, le marquis d’Andervilliers…), la petite bourgeoisie villageoise (Madame Lefrançois), le petit peuple villageois (la nourrice, Hippolyte, Félicité…), les paysans (la clientèle de Charles, le père Rouault, les paysans pauvres…), et même l’aveugle-vagabond.
• Il met en scène la bêtise : il a dépeint deux personnages, Homais et Bournisien, qu’il caricature, montrant leurs préoccupations toutes matérielles.
• Chaque personnage possède le langage de sa classe sociale, en accord avec sa psychologie.
Emma Bovary, jeune femme rêveuse nourrie de littérature sentimentale, qui idéalise la vie et l’amour, est la représentation du romantisme. Tout le reste, c’est du réalisme : le mari ennuyeux, l’enfant la réclamant sans cesse, les problèmes matériels et financiers, le comportement des voisins, l’étouffement de la société…
Ces deux aspects opposés sont également réunis dans la même personne de Flaubert qui avait pleinement conscience de l’existence de ces deux tendances fondamentales :
« Il y a en moi deux bonshommes distincts, un qui est épris de gueulades, de lyrisme, de grands vols d’aigle […] ; un autre qui creuse et qui fouille dans le vrai tant qu’il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu’il reproduit. »
Ainsi la réalité est laide, le romantisme destructeur : aucun des deux termes ne triomphe de l’autre, Flaubert réfute l’un et l’autre.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









