La démocratie athénienne en débats
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
- Connaitre les principales critiques faites à la démocratie athénienne.
- La démocratie a suscité de vives critiques de ses adversaires.
- Ces adversaires craignaient l’incompétence et le danger de la masse, et le règne de l’intérêt personnel.
- L’opposition de certains aristocrates, de philosophes, n’a cependant pas empêché le régime de devenir un modèle de fonctionnement politique.
La démocratie, née à Athènes au Ve siècle avant J.-C., n’est pas un régime qui s’impose à la cité sans donner lieu à débats et prêter à interrogations. Loin de rallier l’adhésion de tous les citoyens, elle suscite de vives critiques.
L’institution dominante dans l’exercice de
la démocratie est
l’Ecclésia. Il s’agit
de l’assemblée de tous les citoyens
d’Athènes, une assemblée
nombreuse, passionnée, qui discute parfois
longuement sur des détails ou au contraire passe
rapidement sur des questions importantes, engageant
l’avenir de la cité.
La psychologie de groupe influe sur les
décisions : on suit le plus grand nombre
sans oser prendre la parole et s’opposer. La
foule, changeant souvent d’avis, est inconstante.
Thucydide, grand historien et homme politique
athénien, condamne cette
instabilité :
« Cet engouement du plus grand nombre faisait que ceux-là mêmes qui n’approuvaient pas, craignaient, en votant contre, de passer pour mauvais patriotes et se tenaient cois. »
L’un des reproches les plus fréquents des adversaires de la démocratie se porte sur l’incompétence supposée du peuple. La masse, peu éduquée, est ignorante et de ce fait incapable de prendre les bonnes décisions.
Aristote, philosophe du IVe siècle avant J.-C., disciple de Platon, dénonce cette incompétence populaire : il propose de refuser aux masses l’exercice des hautes charges mais de lui laisser le pouvoir de délibérer et de juger comme l’avait fait Solon.
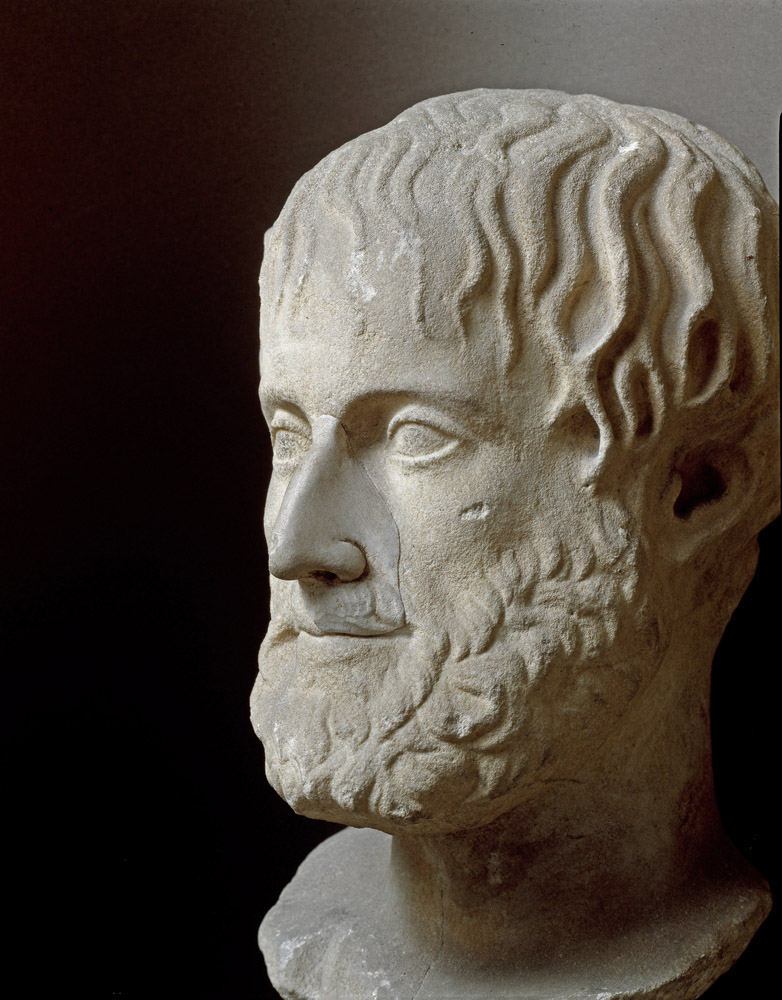
Buste d'Aristote
Les assemblées sont également des lieux privilégiés pour chercher à régler des conflits privés et se débarrasser d’ennemis potentiels. La démagogie est alors l’attitude adoptée pour flatter le plus grand nombre, satisfaire ses intérêts. L’arme utilisée est le discours, qui se doit d’être habile pour mieux manipuler. L’intérêt de la cité passe alors au second plan.
Ces critiques du système et les interrogations sur la nature du régime politique sont très présentes dans les œuvres théâtrales. Le théâtre est le reflet de la vie démocratique de la cité, il doit inculquer les valeurs morales aux citoyens et dénoncer ces travers de l’exercice de la vie politique.
L’œuvre d’Aristophane axe beaucoup sur ces règles démocratiques : il dénonce, dans Les Guêpes, la manie des procès organisés, les dysfonctionnements de la justice.
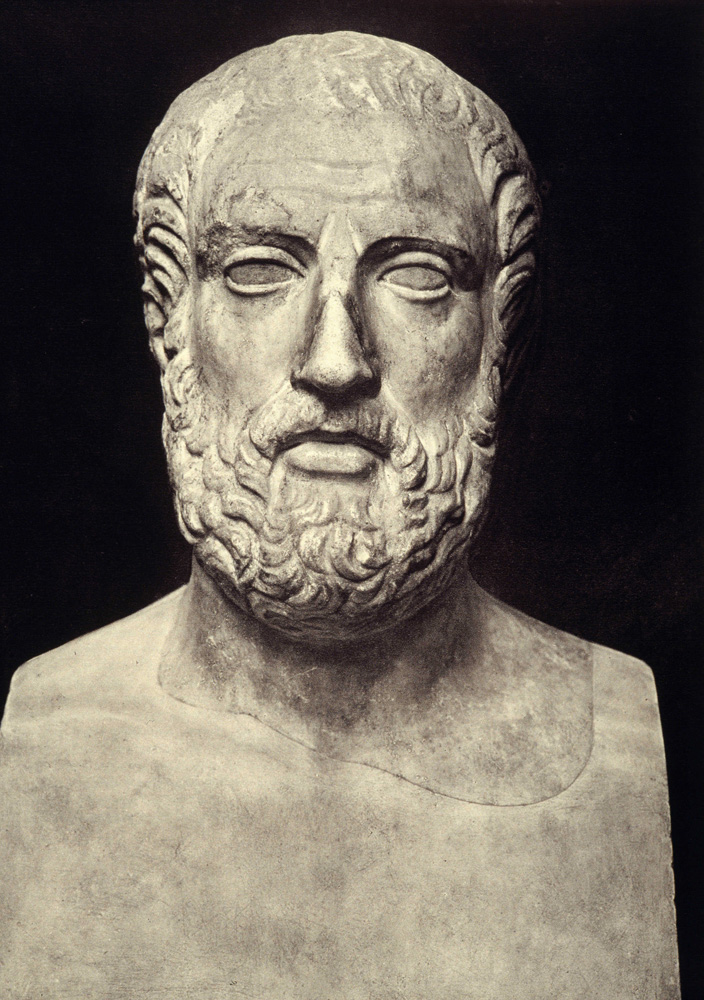
Buste d'AristophaneLa
comédie L’Assemblée des
femmes offre symboliquement la parole à
ces exclues de la vie politique et permet
d’ouvrir les yeux sur les excès des
orateurs lors des débats à
l’Ecclésia.
Le poète Euripide offre également,
grâce au théâtre, la parole aux
femmes, dans sa pièce Médée
:
« Nous sommes, nous autres femmes, la
créature la plus misérable. (…)
Ils disent que nous vivons une vie sans danger à
la maison, tandis qu’ils combattent avec la
lance. Piètre raisonnement : je
préfèrerais (dit Médée,
l’héroïne éponyme) lutter
trois fois sous un bouclier que d’accoucher
seule ».
L’aristocratie, dans la grèce
antique, est un régime politique dans
lequel le gouvernement est confié à une
élite, littéralement les
meilleurs. L’excellence est fondée sur
le mérite, le degré
d’éducation. Les aristocrates semblent
pour certains s’imposer comme les plus aptes
à diriger la cité, car eux seuls,
disent-ils, peuvent diriger la masse. Ils cherchent
avant tout à assurer le bon ordre et
la discipline pour garantir la
sécurité de la cité. Ils
regrettent le désordre populaire et les
fragilités de la démocratie dans sa
capacité à maintenir l’ordre et
l’unité.
L’oligarchie est le gouvernement
de quelques uns, le plus souvent riches. Les
oligarques critiquent eux-aussi
l’incapacité de la masse et
présentent la démocratie comme un
régime pervers. Pour eux, le pouvoir doit
être confié à ceux qui ont les
moyens de conduire la politique de la cité.
À l’égalité
démocratique, ils opposent le principe de
l’égalité proportionnelle à
la richesse et au rang social. À la
différence des aristocrates, plus soucieux du
droit, ils n’hésitent pas à
tenter des coups de force pour accéder au
pouvoir.
En 411-410 avant J.-C., ils essayent sans succès
de mettre fin à la démocratie. Durant
la guerre du Péloponnèse qui oppose
Sparte à Athènes, un groupe
d’oligarques s’empare du pouvoir et
prend des mesures radicales.
Les fonctions de bouleutes (membres du Conseil de la
Boulê) et d’héliastes (membre des
tribunaux grecs) ne sont plus
rémunérées, ce qui permet
d’exclure les citoyens les plus pauvres. Le coup
de force ne dure pas et la constitution
démocratique est rétablie en 410 avant
J.-C.
En 404 avant J.-C., un nouveau coup d’État
est tenté par un groupe de trente oligarques
mené par Critias, l’oncle de
Platon : on parle de la tyrannie des
Trente. Les mesures prises sont encore plus
réactionnaires : suppression de
l’Ecclésia et de
l’Héliée (le tribunal populaire),
ce qui révèle le mépris de la
démocratie.
Les sophistes ont développé
l’art de raisonner grâce à la
rhétorique, l’art de parler en
public et de défendre un point de vue. Il
s’agit, par la dialectique, de s’opposer
par l’argument à l’adversaire. Leur
méthode vise à développer
l’esprit critique et doit favoriser
l’esprit raisonné.
Certains philosophes, comme Platon, critiquent
les dérives de cet enseignement car il laisse
place davantage à la force de persuasion,
à l’émotion, qu’à la
raison. Ces philosophes quant à eux ne
s’opposent pas systématiquement à
la démocratie, mais Platon, par exemple,
s’interroge sur la compatibilité de la
démocratie avec le nécessaire ordre moral
devant guider la cité. Il dénonce
l’anarchie morale et politique favorisée
par ce type de régime.

Platon
Les jeunes aristocrates sont impatients de gloire politique alors que les Anciens sont plus soucieux de la tradition, dans la mesure où ils sont toujours honorés du peuple.
Les habitudes politiques accordent plus de place à ces Anciens, c’est pourquoi les jeunes se méfient de la démocratie : ils appuient d’ailleurs le coup de force des oligarques en 411 et en 404 avant J.-C.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









