Les anomalies de la méiose
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
- Connaitre les anomalies de la méiose, leurs apparitions et leurs conséquences.
- Comprendre le fonctionnement des gènes des familles multigéniques.
- La non-séparation des chromosomes au cours des deux divisions de la méiose lors de la formation des gamètes peut amener à des anomalies chromosomiques, dont la plupart sont non viables. Elles sont source de troubles dans le génome humain : trisomies, monosomies, etc.
- Chaque espèce possède des gènes
similaires, dits apparentés, qui résultent
d'un seul et unique gène ancestral : ils codent pour
des protéines aux séquences semblables, mais
aux fonctions spécifiques.
L'étude des séquences en acides aminés de telles protéines et des séquences en nucléotides des gènes permet de déterminer le degré de parenté entre les molécules. - L'accumulation de mutations dans un gène fait
apparaitre de nouvelles fonctions.
Les innovations génétiques sont à l'origine du polymorphisme actuel. Ces innovations génétiques sont aléatoires, leur évolution dépend de la sélection naturelle.
Le caryotype caractérise chaque
espèce : la méiose et la
fécondation sont à l'origine de la
variabilité des individus, mais elles assurent la
stabilité du stock chromosomique.
Toutefois, certaines erreurs peuvent se produire au cours
de la méiose et entrainer des anomalies
chromosomiques.
En anaphase I, il y a absence de
disjonction d'une paire de chromosomes
homologues.
Les conséquences sont qu'à l'issue de la
méiose, on obtient deux gamètes avec
un chromosome surnuméraire (une paire
complète) et deux gamètes avec un
chromosome en moins.
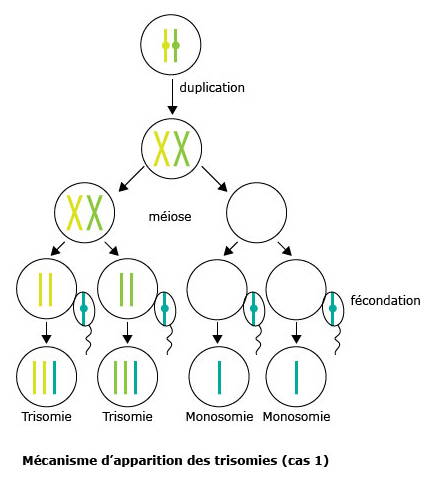
Chez l'homme, on obtiendrait 2 gamètes avec 24 chromosomes et 2 gamètes avec 22 chromosomes, au lieu des 23 chromosomes habituels.
Les résultats de la fécondation sont les suivants :
- un gamète à 24 chromosomes et un gamète normal amènent à un cas de trisomie, avec un chromosome en 3 exemplaires ;
- un gamète à 22 chromosomes et un gamète normal amènent à un cas de monosomie, avec un chromosome en 1 exemplaire seulement.
En anaphase II, après une division des centromères, les 2 chromatides sœurs migrent vers le même pôle : on obtient alors des gamètes anormaux avec un chromosome surnuméraire et un déficitaire.
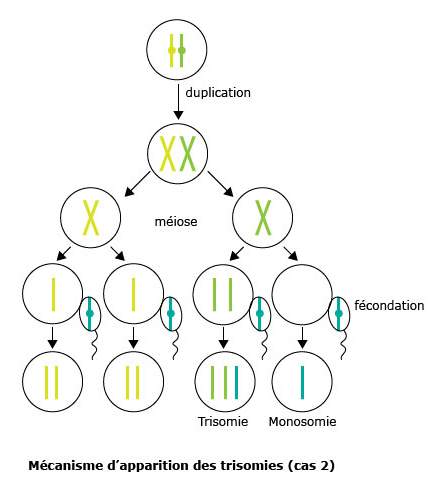
Les conséquences sont identiques à celles
citées précédemment.
Toutes ces erreurs affectent aussi bien les autosomes
que les gonosomes.
Dans le cas d'une cellule œuf anormale viable,
toutes les anomalies seront transmises aux cellules
filles lors des divisions par mitoses.
Les gonosomes et tous les autosomes sont concernés, mais certaines trisomies sont plus fréquentes.
La trisomie 21 ou syndrome de Down.
Sa fréquence est de un nouveau-né sur 700. Elle affecte la 21e paire de chromosomes, qui comprend 3 chromosomes au lieu de 2. La personne atteinte de trisomie 21 a des traits caractéristiques, un handicap mental, des malformations internes, etc.
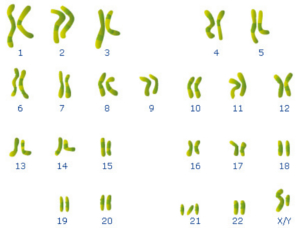
La trisomie XXY ou syndrome de Klinefelter
(caryotype : 47, XXY).
Sa fréquence est de 1 sur 700. Le syndrome
touche les personnes de sexe masculin. L'homme est
stérile et sa pilosité peu
développée. Il a des caractères
physiques féminins (seins...). Son
intelligence est normale (les cas de
débilité mentale profonde sont rares).
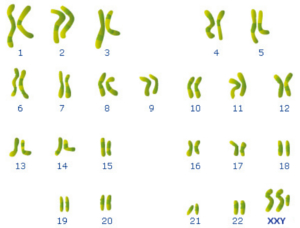
Les monosomies
Les monosomies se traduisent par la perte d'un
chromosome.
Seule la monosomie X est viable chez l'homme. Toutes
celles qui affectent les autosomes sont non viables.
La monosomie X ou syndrôme de Turner (caryotype : 45, XO).
Sa fréquence est de 1 sur 2700. Le caryotype ne présente qu'un chromosome sexuel, X, donc 45 chromosomes en tout. Cette monosomie affecte les femmes. Elles sont stériles, impubères et de taille anormale (nanisme).
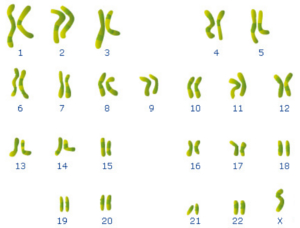
La cellule œuf possède 3n chromosomes. Le caryotype est non viable.
Les scientifiques ont constaté, au sein d'une
espèce donnée, que de nombreuses
protéines possèdent des séquences en
acides aminés très comparables et
très voisines : cela ne peut pas être
le fruit du hasard.
Il existe, chez l'homme, de nombreuses protéines
possédant des séquences très
voisines, avec seulement quelques acides aminés
qui diffèrent. Les protéines étant
des macromolécules qui résultent de
l'expression des gènes, cela signifie qu'elles
proviennent de gènes eux-mêmes très
proches, avec des séquences parfaitement
homologues : ces ensembles de gènes
très apparentés et similaires constituent
une famille multigénique.
Ces gènes apparentés occupent des loci
différents au niveau du génome et ne
doivent pas être confondus avec les allèles
qui, eux, sont situés au même locus (les
différents allèles d'un même
gène sont toujours au même emplacement sur
un chromosome : le locus).
Tous ces gènes dérivent d'un seul et unique
gène ancestral, qui aurait subi de nombreuses
duplications (= copies) et des mutations
indépendantes : on obtient finalement des
gènes différents, mais très
similaires.
On admet que 20 % au moins de similitude entre deux
protéines indique une origine commune. De plus, le
degré de similitude entre deux gènes
renseigne sur le temps écoulé depuis la
copie du gène ancestral, si on admet que les
mutations se produisent avec une fréquence faible,
mais régulière, et qu'elles s'accumulent au
fil du temps : plus les gènes sont
semblables, plus la duplication dont ils sont issus est
récente.
Grâce aux duplications de gènes, le
génome de l'espèce humaine s'est
très nettement enrichi et les phénotypes se
sont diversifiés. Le nombre de gènes a
considérablement augmenté au cours de
l'évolution, avec production de protéines
aux séquences en acides aminés similaires,
mais aux fonctions très différentes :
ces molécules sont homologues.
L'accumulation de mutations dans un gène fait
apparaitre de nouvelles fonctions.
Les innovations génétiques sont à
l'origine du polymorphisme actuel. Ces innovations
génétiques sont aléatoires, leur
évolution dépend de la sélection
naturelle.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









