Les agents et les mécanismes de l'immunité adaptative
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
- Connaitre les cellules en charge de l'immunité.
- Connaitre les mécanismes de l’immunité adaptative.
- Pour se défendre contre une infection,
l’organisme développe deux formes
d’immunité :
- l’immunité innée, première barrière de défense et commune à toutes les espèces ;
- l’immunité adaptative, seconde barrière de défense et propre aux vertébrés.
- L’immunité adaptative est spécifique de l’antigène et est variable d’un individu à l’autre.
- Les acteurs principaux de l’immunité adaptative sont les lymphocytes B et T. Ils sont issus de la lignée myéloïde qui se différencie dans la moelle osseuse.
- Lors d’un contact avec un agent pathogène, les cellules dendritiques, sentinelles de l’organisme, acheminent les antigènes jusqu’aux organes lymphoïdes secondaires. Elles présentent aux lymphocytes T ces antigènes sous la forme de peptides associés à deux types de complexes protéiques : le complexe majeur d’histocompatibilité de type I ou de type II.
- Les lymphocytes T CD4 vont reconnaître les
complexes CMHII / peptide antigénique alors que les
lymphocytes T CD8, les complexes CMHI/peptide
antigénique.
Les lymphocytes T CD4 sécrètent des cytokines qui participent à l’activation de la réponse adaptative tandis que les lymphocytes T CD8 acquièrent la capacité de reconnaître spécifiquement les cellules infectées afin de les détruire par lyse. - Les lymphocytes B spécifiques de l’antigène sont sélectionnés par l’intermédiaire d’immunoglobulines membranaires de type IgM. Le lymphocyte B est alors capable de présenter l’antigène au lymphocyte T CD4 via un complexe CMHII / peptide antigénique.
- Le lymphocyte T CD4 sécrète des cytokines
qui vont permettre l’activation des lymphocytes B et
leur différenciation en plasmocytes, cellules
spécialisées dans la production
d’immunoglobulines. Les lymphocytes T CD4 jouent donc
un rôle central dans la stimulation de la
réponse adaptative. La nature du pathogène va
orienter le type de réponse :
- une réponse à médiation cellulaire dans le cas d’une infection par un virus ou un micro-organisme intracellulaire ;
- une réponse à médiation humorale dans le cas d’allergènes ou de parasites extracellulaires.
L’immunité adaptative est la seconde ligne de
défense de l’organisme.
Sa mise en place est retardée puisqu’elle
survient seulement 4 jours après le contact avec
l’agent pathogène.
Elle fait intervenir les lymphocytes B et T qui jouent un
rôle central dans cette immunité.
Les lymphocytes B produisent des anticorps ; ils sont
responsables de la réponse humorale.
Les lymphocytes T sont responsables de la réponse
cellulaire. Ils sont de deux types : les lymphocytes T
auxiliaires (ou helper Th) et les lymphocytes T
cytotoxiques.
Les cytokines vont servir de médiateurs entre ces
différents lymphocytes et permettre la coordination de
la réponse immunitaire qui est spécifique de
l’agent infectieux ; on parle de coopération
cellulaire.
Les cellules impliquées dans la défense
de l’organisme sont toutes issues de cellules
souches pluripotentes localisées dans la moelle
osseuse.
Sous l’effet de différentes cytokines, ces
cellules souches vont se différencier en
précurseurs lymphoïdes ou
précurseurs myéloïdes.
Les précurseurs myéloïdes vont
donner naissance aux cellules de la lignée
phagocytaire (polynucléaires neutrophiles -PNN-,
monocytes, macrophages, cellules dendritiques) tandis
que les précurseurs lymphoïdes vont donner
naissance aux lymphocytes B, T et « natural
killer ».
Les cellules de la lignée myéloïde
qui se retrouvent au premier rang lors d’une
réponse immunitaire vont migrer par voie
sanguine jusqu’aux tissus alors que les cellules
de la lignée lymphoïde vont gagner les
organes lymphoïdes où va avoir lieu la
maturation des lymphocytes.
Les lymphocytes T immatures (pro-thymocytes) migrent jusqu’au thymus. Là, ils vont subir une première sélection qui va permettre d’éliminer les lymphocytes capables de reconnaître spécifiquement les antigènes du soi. Ils gagnent ensuite les organes lymphoïdes secondaires où aura lieu la maturation de la réponse adaptative.
Les organes lymphoïdes secondaires sont
répartis partout dans l’organisme. On
compte les amygdales, les végétations,
les ganglions lymphatiques, la rate et les plaques de
Peyer au niveau de l’intestin grêle. Ils
sont reliés entre eux par le système
lymphatique.
C’est dans les organes lymphoïdes
secondaires qu’a lieu la rencontre entre
l’antigène et les lymphocytes. Les
lymphocytes naïfs sont véhiculés par
le sang jusqu’aux organes lymphoïdes
secondaires alors que les antigènes provenant du
site infectieux circulent par les vaisseaux
lymphatiques.
Dans le tissu infecté, la réaction inflammatoire a été induite. Des macrophages sécrètent des chimiokines et cytokines qui vont permettre aux cellules dendritiques de venir sur le site. Là elles internalisent l’agent infectieux puis regagnent la circulation sanguine pour rejoindre les organes lymphoïdes secondaires.
Les cellules dendritiques sont capables de
présenter à leur surface les
antigènes étrangers par
l’intermédiaire de complexes
protéiques : le complexe majeur
d’histocompatibilité de type II.
Ce complexe associé à un peptide
antigénique va être reconnu par les
récepteurs T (TCR) présents
à la surface des lymphocytes T
auxiliaires caractérisés par la
molécule CD4 (Cluster Differenciation
4).
Lorsque le recepteur TCR présente une
affinité suffisante pour le complexe
CMHII / peptide antigénique, le
lymphocyte T est activé.
Il se multiplie activement et se différencie en
lymphocyte T auxiliaire mature. On parle de
sélection clonale.
Les lymphocytes T CD4 ainsi activés vont
sécréter des cytokines qui vont
intervenir dans l’activation et le maintien de
la réponse adaptative (Document 1 et 2).
La majorité des types cellulaires expriment
à leur surface le complexe majeur
d’histocompatibilité de type I.
Ce dernier permet la présentation de peptides
antigéniques à la surface des
cellules.
Le complexe CMHI / peptide antigénique est
reconnu spécifiquement par le recepteur TCR des
lymphocytes T cytotoxiques caractérisés
par la molécule CD8.
De la même façon, les lymphocytes T CD8
présentant une affinité suffisante pour
le complexe CMHI / peptide antigénique sont
activés et se multiplient selon un mode de
sélection clonale (Document 2).
Ils ont la capacité de se lier aux cellules
présentatrices de l’antigène et
d’induire leur lyse. Ils sont très
efficaces dans l’élimination des cellules
infectées par un virus.
Les lymphocytes B immatures expriment à leur
surface des immunoglobulines membranaires de type
IgM.
Elles sont capables de reconnaître les
antigènes solubles et de se fixer à la
surface des micro-organismes. La liaison IgM
membranaire / antigène induit un signal
d’activation intracellulaire qui va conduire
à la prolifération clonale du lymphocyte
B et à la maturation de l’affinité
des anticorps (Document 1).
Les anticorps deviennent alors solubles et sont de type
IgG. Les lymphocytes B se différencient en
cellules productrices d’anticorps à forte
affinité : les plasmocytes.
Les anticorps vont intervenir en renforçant
l’action des acteurs de l’immunité
innée par opsonisation. Les IgG se fixent
à la surface des microorganismes ou des
molécules étrangères solubles. Ils
sont ensuite reconnus par des récepteurs
spécifiques des IgG présents à la
surface des phagocytes ce qui va conduire à
l’ingestion puis la digestion des agents
pathogènes.
Quand les lymphocytes T et B sont activés lors
d’un premier contact avec
l’antigène, une fraction des cellules va
évoluer en lymphocytes mémoire.
Ces lymphocytes sont de type B mémoire et T CD8
mémoire. Ils ont acquis la capacité de
reconnaître l’antigène
rencontré avec une forte affinité.
Ils vont jouer un rôle important si
l’organisme rencontre de nouveau le
micro-organisme pathogène.
Ils circulent en permanence dans l’organisme et
sont capables de s’activer au contact de
l’agent pathogène. Ainsi, la
réponse adaptative est plus rapide pour
éliminer spécifiquement l’agent
infectieux.
La vaccination repose sur ce principe. Elle permet
d'avoir une réponse immunitaire
spécifique plus rapide lors d’un contact
avec l’agent pathogène.
La coopération cellulaire est indispensable pour
l’activation de la réponse adaptative.
Les lymphocytes T auxiliaires jouent un rôle
central dans ce processus. Elle a lieu dans les organes
lymphoïdes secondaires.
- Étape 1 : les lymphocytes T CD4 sont activés après avoir reconnu le complexe CMHII / Peptide antigénique à la surface des cellules dendritiques.
- Étape 2 : les lymphocytes B immatures reconnaissent l’antigène par l’intermédiaire des IgM membranaires et l’internalisent (signal 1). Ils deviennent alors capables de le présenter au sein du complexe CMHII à leur surface, aux lymphocytes T CD4 (signal 2).
- Étape 3 : les lymphocytes T CD4 s’activent au contact des lymphocytes B et sécrètent des cytokines qui vont activer spécifiquement les lymphocytes B et permettre la production d’IgG solubles spécifiques de l’antigène (signal 3).
- Étape 4 : les IgG sont libérées dans la circulation sanguine et vont agir au site infecté (opsonisation).
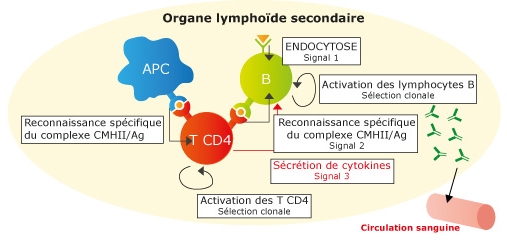
Les cellules présentatrices
d’antigène (APC) sont au centre de ce
processus. Elles vont présenter les peptides
antigéniques d’une part aux lymphocytes T
CD4 par l’intermédiaire d’un
complexe CMHII et d’autre part, aux lymphocytes T
CD8 par l’intermédiaire d’un
complexe CMHI.
Ces interactions conduisent à la
sécrétion de cytokines par l’APC
qui vont activer respectivement le lymphocyte T CD4 et
le lymphocyte T CD8.
Une fois activé, le lymphocyte T CD4 va produire
lui aussi des cytokines qui vont activer le lymphocyte
T CD8 qui va se différencier en lymphocyte T
cytotoxique capable de détruire
spécifiquement les cellules infectées par
le pathogène.
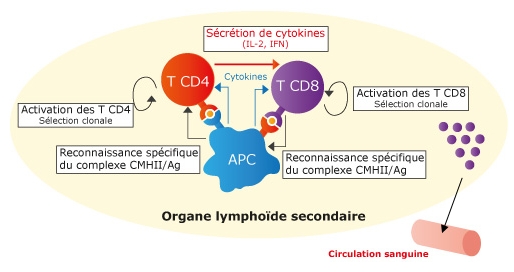
Il existe deux voies possibles de réponse adaptative :
- La voie à médiation humorale qui implique l’activation des lymphocytes B et l’action des leucocytes type mastocytes ou éosinophiles.
- La voie à médiation cellulaire qui stimule préférentiellement les lymphocytes T cytotoxiques et les macrophages.
La nature de l’agent infectieux est
déterminante pour le choix de l’une ou de
l’autre des voies.
Les infections virales et microbiennes intracellulaires
stimulent la voie à médiation cellulaire,
facilitant l’élimination des cellules
infectées.
Les allergènes et les parasites extracellulaires
stimulent la voie à médiation humorale
qui va favoriser l’élimination des agents
pathogènes par phagocytose. Cette
dernière voie est celle impliquée dans
les réactions allergiques.
Il existe deux types de lymphocytes T CD4 :
- les lymphocytes Th1 qui sécrètent de l’interleukine 12 et de l’interféron g lorsqu’ils sont activés par les APC ;
- et les lymphocytes Th2 qui sécrètent l’interleukine 4.
Les lymphocytes Th1 vont produire des cytokines stimulant la voie à médiation cellulaire tandis que les lymphocytes Th2 produisent les cytokines impliquées dans la voie à médiation humorale.
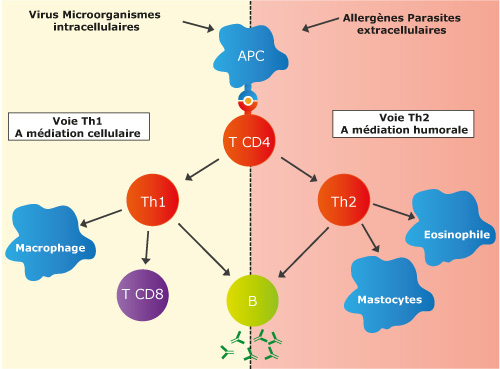
Pour se défendre contre une infection,
l’organisme développe deux formes
d’immunité :
(i) l’immunité innée,
première barrière de défense et
commune à toutes les espèces,
(ii) l’immunité adaptative, seconde
barrière de défense et propre aux
vertébrés.
L’immunité adaptative est spécifique
de l’antigène et est variable d’un
individu à l’autre.
Les acteurs principaux de l’immunité
adaptative sont les lymphocytes B et T. Ils sont issus
de la lignée myéloïde qui se
différencie dans la moelle osseuse.
Lors d’un contact avec un agent
pathogène, les cellules dendritiques,
sentinelles de l’organisme, acheminent les
antigènes jusqu’aux organes lymphoïdes
secondaires. Elles présentent aux lymphocytes
T ces antigènes sous la forme de peptides
associés à deux types de complexes
protéiques : le complexe majeur
d’histocompatibilité de type I ou de type
II.
Les lymphocytes T CD4 vont reconnaître les
complexes CMHII / peptide antigénique alors que
les lymphocytes T CD8, les complexes CMHI/peptide
antigénique.
Les lymphocytes T CD4 sécrètent des
cytokines qui participent à
l’activation de la réponse adaptative
tandis que les lymphocytes T CD8 acquièrent la
capacité de reconnaître spécifiquement
les cellules infectées afin de les
détruire par lyse.
Les lymphocytes B spécifiques de
l’antigène sont sélectionnés
par l’intermédiaire
d’immunoglobulines membranaires de type IgM.
Le lymphocyte B est alors capable de
présenter l’antigène au lymphocyte T
CD4 via un complexe CMHII / peptide
antigénique. Le lymphocyte T CD4
sécrète des cytokines qui vont permettre
l’activation des lymphocytes B et leur
différenciation en plasmocytes, cellules
spécialisées dans la production
d’immunoglobulines.
Les lymphocytes T CD4 jouent donc un rôle
central dans la stimulation de la réponse
adaptative. La nature du pathogène va
orienter le type de réponse :
(i) une réponse à médiation
cellulaire dans le cas d’une infection par un
virus ou un micro-organisme intracellulaire
;
(ii) une réponse à médiation
humorale dans le cas d’allergènes
ou de parasites extracellulaires.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !









