La débâcle française et la résistance britannique
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
L’effet sur le moral des soldats français est désastreux, ils ne comprennent pas le maintien de leur mobilisation. Ce n’est que le 10 mai 1940, que les Allemands passent à l’attaque et font rapidement la différence avec leurs 140 divisions contre 100 pour les Alliés ainsi que leur aviation plus performante.
L’offensive allemande prend alors deux directions :
- vers le Nord : les Allemands encerclent les Alliés et font capituler l’armée belge provoquant l'évacuation par Dunkerque de 350 000 soldats anglais et français vers le Royaume-Uni ;
- vers le Sud : la bataille de France s'engage et en un mois, le 14 juin, Paris tombe aux mains des Allemands : c’est la débâcle qui jette des millions de Français sur le chemin de l’exode.
• occupation des trois quarts du territoire français par l'Allemagne ;
• entretien des troupes allemandes d’occupation ;
• Maintien en détention des prisonniers français (environ 1,5 millions).
La défaite provoque la chute de la IIIe République. Le 10 juillet 1940, Pétain obtient les pleins pouvoirs et organise l’État français qui s’installe à Vichy. Le 18 juin, le général de Gaulle lance depuis Londres, un appel à la résistance. Mais son audience reste dans un premier temps très limitée.
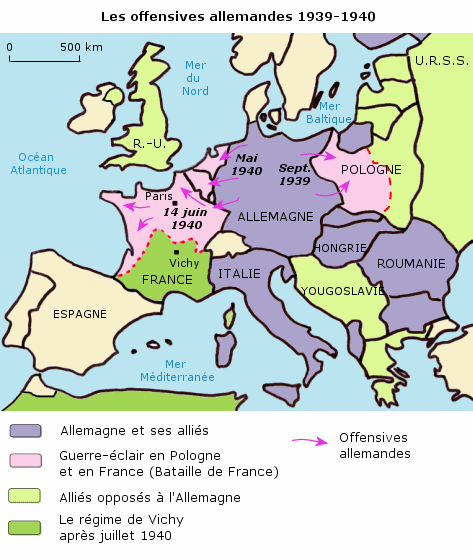
Le 16 juillet 1940, Hitler projette un débarquement en Angleterre qu'il précède d’une offensive aérienne à partir du 8 août. La Luftwaffe profite de l'affaiblissement de la R.A.F (Royal Air Force) pour bombarder jour et nuit Londres et les agglomérations industrielles.
Mais la "bataille d’Angleterre" se solde par un échec et la résistance britannique éprouve si durement l’aviation allemande que Hitler doit ajourner l’ordre de débarquement.
Le conflit se transforme alors en guerre d’usure car l’Axe pense affaiblir la Grande-Bretagne en paralysant ses approvisionnements par le blocage des voies maritimes.
Hitler manœuvre pour entraîner l’Espagne et la France de Vichy dans sa lutte contre l'Angleterre, mais en vain. Pourtant, la France aurait pu intervenir au lendemain de la destruction par les Anglais, de sa flotte de Mers-el-Kébir en juillet 1940.
Dès la fin de 1940, le théâtre des opérations en Méditerranée s'élargit à la rive sud. L’Angleterre parvient toutefois à maintenir sa présence au Moyen-Orient et sur le canal de Suez, mais ses navires ne peuvent plus emprunter la Méditerranée et doivent contourner l’Afrique par le sud.
Les Américains, persuadés qu’une victoire de l’Axe peut mettre en péril les Etats-Unis, sont décidés à soutenir la Grande-Bretagne. En mars 1941, le président Roosevelt fait adopter la loi prêt-bail, qui autorise le gouvernement américain à mettre à la disposition des Alliés tous les produits nécessaires à la guerre.
En août 1941, la solidarité anglo-américaine s’affirme : Churchill et Roosevelt se rencontrent et signent la Charte de l’Atlantique qui énonce les principes démocratiques sur lesquels le monde d’après-guerre doit se reconstruire.
Après l’invasion de la Pologne en septembre 1939 et une période de "drôle de guerre" de plusieurs mois, les Allemands passent à l’offensive sur le front occidentale.
Tandis que la France subit la guerre-éclair et est défaite en un mois, son allié britannique résiste et tient tête malgré la supériorité incontestable de cette dernière.
La France vaincue décide de signer un armistice avec l’Allemagne le 22 juin 1940, armistice qui divise le camp des Alliés mais une poignée de Français conduite par le général de Gaulle entre alors en résistance.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !







