L'organisation de la justice
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
• L’ordre judiciaire est l’ordre de droit commun appelé à régler les litiges entre les justiciables. La justice pénale lui est rattachée.
Les juridictions civiles et les juridictions pénales appartiennent toutes deux à l'ordre judiciaire. Elles connaissent l'ensemble des litiges de droit privé. Les juridictions civiles ont compétence générale alors que les juridictions pénales sont spécialisées dans la répression des auteurs d'infractions et dans l'indemnisation des victimes.
• L’ordre administratif a vocation à régler les litiges entre l’Administration et les administrés.
Selon le principe du double degré de juridiction, la plupart des affaires sont susceptibles d'être jugées par deux degrés de juridiction.
En matière criminelle comme en matière civile, la juridiction du second degré est la cour d'appel. En matière administrative, il s’agit de la cour administrative d’appel.
Il est possible de contester également la décision rendue par une cour d’appel, cela s’appelle « se pourvoir en cassation ». Cependant, le pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel ne constitue pas un troisième degré de juridiction en France, car le pourvoi en cassation (pour le civil et le pénal) ou son équivalent devant le Conseil d’État (pour les litiges administratifs) ne permet pas de juger une troisième fois l’affaire.
Le pourvoi permet d’examiner si les juges de la cour d’appel ont bien appliqué le droit, les textes. Ce ne sont pas les faits qui sont examinés, mais le droit. C’est la décision des juges d’appel qui est jugée à son tour. Si elle a violé le droit, il y a cassation (d’où le nom de la cour du côté judiciaire), si ce n’est pas le cas, il y a rejet du pourvoi.
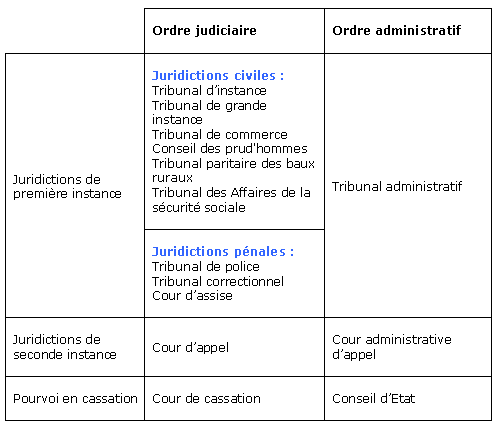
Le jugement est le nom donné aux décisions rendues par les magistrats de première instance (ex : décisions du tribunal de grande instance, du tribunal d’instance, tribunal correctionnel, conseil des prud’hommes…)
L’arrêt est le nom donné aux décisions rendues par les cours d’appel et la Cour de cassation.
Ainsi, pour éviter que le pouvoir judiciaire ne prenne l'ascendant sur le pouvoir exécutif, la loi des 16 et 24 août 1790 a consacré le principe selon lequel les membres du corps exécutif (l'Administration) ne pouvaient faire l'objet de poursuites devant les juridictions judiciaires.
Le système français respecte depuis l'époque révolutionnaire le principe de séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire :
• le législateur (l'Assemblée nationale et le Sénat) vote les lois,
• l'exécutif est chargé de leur exécution,
• l'institution judiciaire veille à leur application.
C’est au XIXe siècle que va émerger l'ordre juridictionnel administratif, propre aux litiges relevant du droit public.
Il n’est pas toujours évident de déterminer si c’est l'ordre judiciaire ou administratif qui est compétent en certains domaines. C’est pourquoi au sommet des deux ordres juridictionnels se trouve le Tribunal des conflits qui est chargé de trancher les conflits qui pourraient survenir entre les deux ordres de juridiction, qu'il s'agisse d'un conflit positif (chaque ordre revendique de juger un litige) ou d'un conflit négatif (chaque ordre renvoie le litige devant l’autre).
Le droit communautaire et la Convention européenne des droits de l’homme sont directement applicables par le juge français. Le juge statue aussi bien en faisant référence au droit national qu’au droit communautaire, il s’assure ainsi de la compatibilité de la Loi nationale avec le droit européen.
Les magistrats du siège
Ce sont les juges qui restent assis au cours de l’audience. Ces magistrats prononcent des jugements, sont inamovibles et indépendants. Ils sont susceptibles d’être sanctionnés en cas de manquements à leurs obligations professionnelles.
Les magistrats du parquet
Ce sont des magistrats qui prennent la parole debout pendant l’audience. Ils constituent la catégorie de la magistrature debout et exercent le ministère public. En effet, ils ne jugent pas, mais requièrent au nom de la Loi, pour protéger les intérêts généraux. Ils sont soumis à l’autorité de leur ministre de tutelle, le garde des Sceaux.
Les greffiers
Les greffiers s’occupent de l’administration des juridictions (appelée le greffe). Ils sont recrutés sur concours, ce sont des fonctionnaires. Leur rôle est déterminant lors du procès car ils prennent en note tous les événements pouvant survenir. Ce sont des spécialistes en matière de formalités, de procédures.
Les huissiers
Ce sont des officiers ministériels titulaires d’un office qui leur est conféré par l’autorité publique. Ils ont pour fonction d’authentifier les actes, de notifier les actes de procédures aux parties, de faire appliquer les décisions de justice, par la force si nécessaire.
Les avocats
Les avocats sont des auxilliaires de justice. C'est une profession libérale organisée en ordres professionnels appelés barreaux. Leur rôle est multiple : ils conseillent leurs clients, les représentent à l’audience, etc.
Les actes qu’ils rédigent en vue du procès sont appelés « conclusions ». Dans ces conclusions, ils exposent leurs demandes ou leurs défenses, en argumentant. Pendant l’audience, ils parlent pour leurs clients, c’est la plaidoirie.
Les experts
Les experts sont des professionnels réputés, qui sont susceptibles d’être consultés par les magistrats. Ces professionnels figurent sur des listes agréées. Sollicités par les magistrats, ils rendent un rapport d’expertise et peuvent être conviés à s’exprimer à l’audience.
En matière civile, ils peuvent intervenir pour des affaires dont les enjeux financiers ne dépassent pas les 1 500 euros. En matière pénale, ils ne peuvent prononcer de peines d’emprisonnement.
Parmi les juges adminstratifs, un rapporteur et un commissaire du gouvernement sont désignés afin de mener le procès jusqu’à l’audience.
• Le juge rapporteur instruit et transmet le dossier.
• Le commissaire du gouvernement est chargé de formuler ses conclusions sur le fond de chaque affaire.
Pendant l’audience, les juges entendent le juge rapporteur, les parties, les avocats et le commissaire du gouvernement.
Spécialistes de la cassation, ils évaluent les chances du pourvoi et ont le statut d’officier ministériel.
La justice française s’intègre dorénavant dans l’ordre juridictionnel européen. Les magistrats doivent rendre des décisions compatibles avec l’Europe. Le développement de l’Union européenne a abouti à créer à côté des deux ordres traditionnels que sont l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, un nouvel ordre supranational. La justice communautaire prend de plus en plus de place dans la vie judiciaire française.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !







