L'analyse logique
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Un texte est fait de phrases, elles-mêmes composées de propositions, à leur tour constituées de mots.
L'analyse grammaticale sert à définir la nature et la fonction des mots contenus dans une phrase, alors que l'analyse logique s'intéresse à la nature et à la fonction des propositions qui constituent la phrase.
Exception : un verbe à l'infinitif ( c'est-à-dire non conjugué) peut être le noyau d'une proposition s'il possède un sujet qui lui est propre.
Exemple 1 : Le professeur regarde les élèves entrer dans la classe.
Dans cette phrase il y a 2 verbes, dont le premier est conjugué et le second à l'infinitif. Ils sont le noyau de 2 propositions distinctes car ils ont chacun un sujet propre :
> [le professeur regarde] = 1 proposition principale,
> [les élèves entrer dans la classe] = 1 proposition infinitive. Le verbe « entrer » est à l'infinitif mais il a un sujet qui lui est propre « les élèves ». Il est le noyau de la proposition infinitive.
Exemple 2 : Il se laisse gagner par l'inquiétude.
Dans cet exemple, il y a également 2 verbes dont un seul est conjugué, mais il n'y a qu'une seule proposition (indépendante) : en effet, le sujet du verbe à l'infinitif « gagner » est aussi celui du verbe conjugué « se laisse ». Il ne faut donc pas le compter comme noyau d'une proposition distincte.
Même si elle parait imprécise, la proposition principale a un sens quand on l'isole du reste de la phrase.
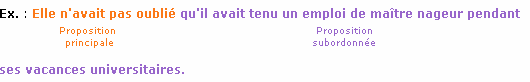
Remarque :
Il peut y avoir plusieurs propositions principales dans une même phrase, qui sont :
• soit juxtaposées :

• soit coordonnées :

Si elles complètent le verbe de la proposition principale, elles sont appelées propositions subordonnées complétives ou conjonctives, selon qu'elles sont compléments circonstanciels ou compléments d'objet.
Il ne faut pas confondre :
• la proposition subordonnée relative :
Ex. : Jean avait la volonté que sa vie lui avait forgée.
Dans cette phrase, « que » est un pronom relatif, ayant pour antécédant « volonté » et introduisant la proposition subordonnée relative.
• la proposition subordonnée complétive :
Ex. : Jean avait la volonté que son fils lui succède à la ferme.
Dans cette phrase, « que » est une conjonction de subordination qui introduit la proposition complétive en complétant le verbe de la proposition principale.
• Phrase 1 : Depuis qu'il est ici, mon collègue a remarqué qu'il a moins de travail.
Cette phrase est constituée de 3 propositions :
• mon collègue a remarqué : proposition principale ;
• depuis qu'il est ici : proposition subordonnée circonstancielle, introduite par la conjonction de subordination « depuis que », complément circonstanciel de temps du verbe « a remarqué » ;
• qu'il a moins de travail : proposition subordonnée complétive, introduite par la conjonction de subordination « que », complément d'objet direct du verbe « a remarqué ».
• Phrase 2 : Le chien a perdu la balle que son maître lui a lancée.
Cette phrase est composée de 2 propositions :
• le chien a perdu la balle : proposition principale ;
• que son maître lui a lancée : proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif « que », complément de l'antécédent « balle ».
• Phrase 3 : Nous sommes partis tard mais j'ai eu mon avion parce que le taxi a roulé très vite.
Cette phrase compte 3 propositions :
• nous sommes partis tard : proposition indépendante
• mais j'ai eu mon avion : proposition principale, coordonnée à la précédente par la conjonction de coordination « mais » ;
• parce que le taxi a roulé très vite : proposition subordonnée circonstancielle, introduite par la conjonction de subordination « parce que », complément circonstanciel de cause du verbe « ai eu ».

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !







