Le système colonial
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
Comment le système colonial exerce-t-il sa mainmise sur les pays colonisés ?
En dépit de leur variété, tous ces statuts assoient l’ordre colonial et la domination européenne.
L’administration directe : Les colonies sont administrées par la métropole, représentée sur place par des fonctionnaires européens très puissants et des gouverneurs dans les colonies françaises. Dans le cas de l’Algérie, l’administration du territoire est calquée sur celle des départements français.
La métropole (État européen possédant des colonies) crée parfois de vastes regroupements :
• l'Union indochinoise qui comprend une colonie (Cochinchine), des protectorats (Laos, Cambodge, Annam, …),
• l'Afrique occidentale française (AOF) créée en 1904,
• l'Afrique équatoriale française (AEF) créée en 1910.
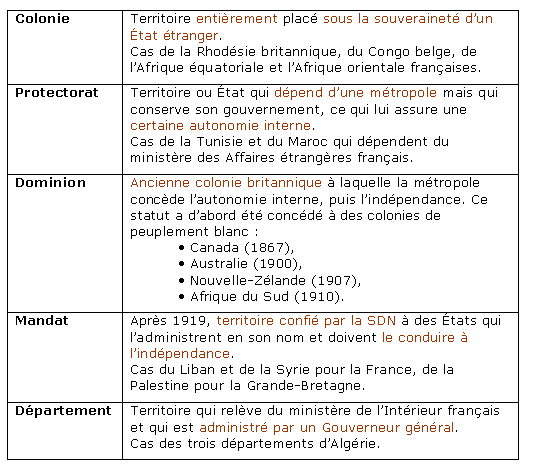
Cette administration directe ou indirecte (à l’exception des dominions) assujettit partout les populations colonisées.
Certains pays ne peuvent être placés sous tutelle, du fait de leur taille, de leur histoire ou de l’âpreté des rivalités qu’ils suscitent : c’est le cas de l’Empire ottoman, de la Chine ou de l’Amérique latine. Les Européens profitent alors d’une supériorité technique et financière pour obtenir une influence déterminante. Cet impérialisme conduit à la mainmise étrangère sur la Chine par exemple, partagée en véritables zones d’influence (Break up of China, 1894).
• L’assimilation, politique officielle de la France, prétend assimiler les indigènes à la métropole, c'est-à-dire leur donner à terme le statut de citoyens. C’est une doctrine généreuse qui a été, en réalité, rarement mise en œuvre. Les indigènes restent soumis à un statut d'inférieurs.
• L’association, politique la plus souvent adoptée par le Royaume-Uni, associe les autorités indigènes à la gestion du territoire. La métropole se contente d’une administration indirecte (Indirect Rule), tandis que le pouvoir est en partie confié aux élites locales. Assistées de conseillers britanniques, celles-ci sont formées le plus souvent dans la métropole, pour gérer la société, lever l’impôt et alléger le coût de l’administration. En apparence plus souple, cette politique repose toutefois sur le postulat que la civilisation britannique est inaccessible aux colonisés.
Si les différences demeurent entre une administration française plus centralisatrice et une administration britannique plus souple, les territoires sont tous soumis à la métropole, qui cherche surtout à exercer une domination économique.
Le développement économique s’appuie sur l’extension des plantations et des cultures commerciales : théiers en Asie, vins en Algérie, cacao et café en Afrique noire, etc. alimentent les exportations.
Les colonies sont aussi d’inépuisables
réservoirs de matières premières.
En 1937-1938, l’Indonésie hollandaise fournit
35 % de la production mondiale de caoutchouc. Dès
1911, la Gold Coast (Ghana actuel) est le premier
producteur mondial de cacao.
L’industrie locale, développée tardivement,
est fondée sur la transformation de ces richesses :
huileries, raffineries, filatures de coton, …
Conséquence majeure : les besoins en main-d’œuvre engendrent des formes de travail forcé.
Ce système suppose des moyens de transports efficaces.
Les Européens développent
donc les infrastructures qui permettent les
échanges (chemins de fer, ports). Leur
construction mobilise l’essentiel des investissements. Le
réseau ferré des Indes britanniques passe de
moins de 800 km en 1870 à 51 500 km en
1910.
En conséquence, des déséquilibres
spatiaux apparaissent : les régions
littorales sont privilégiées au détriment
de l’hinterland (arrière-pays),
délaissé.
Un marché privilégié : en 1938, les exportations du Royaume-Uni vers son empire représentent 47 % de ses exportations. Même si ce pourcentage est plus faible pour la France (34 % des exportations en 1934), le débouché colonial est essentiel pour certaines branches comme les industries cotonnière, automobile, …
Pour protéger ce marché, une loi
douanière, le tarif Méline,
établit, en 1892, l’assimilation entre les
colonies et la métropole. Les produits
métropolitains sont admis sans droit de douane dans les
colonies, qui doivent en revanche imposer des tarifs
protecteurs aux marchandises étrangères.
La préférence coloniale,
politique commerciale d’une métropole qui
privilégie les échanges avec ses colonies, est
également adoptée par les Britanniques vers 1920.
Ce contrôle autoritaire des marchés et des prix, imposé par les Européens, aboutit à la division internationale du travail et des échanges, qui entrave la modernisation des colonies et désorganise les économies indigènes. Celles-ci sont totalement dépendantes.
• Les empires, zone de repli en cas de crise ?
Mais cette dépression provoque un rapprochement des métropoles avec le marché colonial, encouragé par des mesures douanières comme les tarifs prohibitifs (tarifs douaniers si élevés qu’ils interdisent pratiquement les importations). Ce repli sur les colonies favorise les investissements dans celles-ci, orientation confirmée durant la Seconde Guerre mondiale.
Alimenté par le capitalisme et les rivalités entre les nations, l’impérialisme économique est fondé sur l’exploitation des colonies et des territoires sous influence.
Les médecins favorisent le progrès de l’hygiène et de la médecine (campagnes de vaccination contre les maladies tropicales et les épidémies), ce qui contribue à la baisse du taux de mortalité et l’accroissement de la population.
Médecins et missionnaires jouent aussi un rôle social : rachat d’esclaves ; émancipation de la femmes par exemple.
Les enseignants ont également une mission : celle d’alphabétiser les populations. L’enseignement se fait dans la langue indigène dans les petites classes, puis dans la langue du colonisateur pour le secondaire et le supérieur.
Enfin, ingénieurs et techniciens contribuent à la modernisation des infrastructures.
Les sociétés indigènes sont ainsi bouleversées par la « modernité » européenne qui raie la culture des peuples dominés en brisant les cadres traditionnels et en transformant les habitudes. Les missions religieuses ébranlent les croyances traditionnelles et le culte des ancêtres ; l’enseignement crée des classes « d’évolués » tiraillés entre l’influence occidentale et l’attachement à la tradition. On parle dès lors d’acculturation des indigènes.
• La société coloniale est hiérarchisée et cloisonnée, ce qui ne favorise pas la mixité. L’enseignement et les missions ouvrent d’autres formes de contacts, ressentis comme des facteurs de progrès et d’ascension sociale, ou au contraire, de domination culturelle. Toutefois, des échanges existent : la gastronomie par exemple emprunte aux goûts de l’outre-mer ; les arts décoratifs reproduisent les formes exotiques des arts premiers (ex. le peintre Van Dongen puise son inspiration dans l’exotisme colonial).
• Si la présence européenne peut être émancipatrice en apportant le progrès, elle est aussi destructrice, puisque l’œuvre civilisatrice passe par la soumission et parfois même la violence à l’égard des autochtones.
• L’inégalité sociale, politique, économique et culturelle demeure le socle du système colonial : les Européens, minoritaires, occupent le sommet de la hiérarchie tandis que les indigènes, souvent méprisés, sont considérés comme des sujets.
• En voulant civiliser les colonies, l’Europe a favorisé l’émergence de nouvelles élites formées en Europe à ses idées et qui vont les retourner contre les métropoles pour demander l’indépendance (cf. Ghandi, nombreux instituteurs devenus leaders de leur cause).
Ces ambiguïtés sont accentuées par la Première Guerre mondiale qui ébranle le prestige de l’Europe.
Le système colonial n’a pas eu que des aspects négatifs pour les peuples colonisés mais il n’a pas su ou voulu assurer leur développement et leur émancipation. Il a donc provoqué des rejets inéluctables et parfois violents.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer
Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !
Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct
Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.
myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment
Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.
Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions
La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.
Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image
Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !







